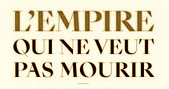Francophonie : quand la France déploie
son empire linguistique
son empire linguistique
par Khadim Ndiaye
Extrait de L’empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, (2021), pages 945 à 955.
Publié par Afrique XXI, le 22 novembre 2022. Source
Khadim Ndiaye est historien (UdeS, Québec), diplômé en philosophie. Ses principaux champs de recherche portent sur l’histoire de la colonisation, la problématique culturelle en Afrique, l’histoire des Afro-Américains et le panafricanisme.

Une histoire coloniale
« Je veux une francophonie forte, rayonnante, qui illumine, qui conquiert [!], tambourine le président Emmanuel Macron lors de son discours de Ouagadougou, en novembre 2017. [Le] français d’Afrique, des Caraïbes, de Pacifique, ce français au pluriel que vous avez fait vivre, c’est celui-là que je veux voir rayonner, portez-le avec fierté, ne cédez à aucun discours qui voudrait en quelque sorte renfermer le français dans une langue morte ou combattre le français comme une langue trop chargée par un passé qui n’est pas à la hauteur du nôtre ! » Régulièrement brandie dans la bouche des chefs d’État français comme un symbole de fraternité et d’ouverture aux autres, la francophonie est en réalité étroitement associée à l’histoire coloniale.
Le mot est employé pour la première fois par le géographe français Onésime Reclus à la fin du XIXe siècle. Promoteur de l’aventure coloniale française, dans son ouvrage Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique, Reclus formule deux interrogations : « Où renaître ? Et comment durer ? » Les réponses apportées par l’auteur s’inscrivent en droite ligne des théories expansionnistes développées à la même époque par les partisans de la colonisation, au rang desquels figurent l’homme politique Léon Gambetta et l’économiste Paul Leroy-Beaulieu. Reclus annonce le « grand destin » qui attend la France après ses déboires militaires face à la Prusse (1870 -1871). Pour lui, il ne fait aucun doute que la renaissance française doit se faire « à moins de deux cents lieues de nous », en Afrique1. Et, l’instrument qui permettra d’y assurer une présence durable n’est autre que la langue.
Telle la Rome antique au temps de sa splendeur qui « triompha des peuples en subtilisant leur âme », la France doit conquérir les peuples africains par sa langue, théorise le géographe. Il s’agit précisément, écrit-il, d’« assimiler nos Africains, de quelque race qu’ils soient, en un peuple ayant notre langue pour langue commune. Car l’unité du langage entraîne peu à peu l’union des volontés. Nous avons tout simplement à imiter Rome qui sut latiniser, méditerranéiser nos ancêtres, après les avoir domptés par le fer.2 »
Si, au départ, Reclus entend décrire la communauté linguistique et géographique des « gens parlant français », le concept de francophonie finit par sous-entendre chez lui une idéologie de domination. La politique coloniale d’assimilation par la langue devient le préalable à l’extension de la présence française hors de l’Europe. Cette volonté de rayonnement par la langue n’est pas un dérivé de l’idéologie coloniale : elle est au cœur de son projet hégémonique. Elle persiste aujourd’hui comme toile de fond de la francophonie moderne, en dépit des dénégations de ses promoteurs.
La base d’une « indestructible influence »
Le 7 mars 1817, la première école française est ouverte en Afrique subsaharienne à Saint-Louis du Sénégal avec à sa tête Jean Dard. Partisan de l’instruction des indigènes dans leur langue maternelle et militant de la production de « livres écrits en leurs langages naturels », Dard initie un bilinguisme français-wolof pour faire face à la difficulté de compréhension du français de ses élèves. Une initiative couronnée de succès. Il doit toutefois subir les attaques véhémentes du préfet apostolique du Sénégal, l’abbé Guidicelli, qui l’accuse d’instruire ses élèves dans un « jargon informe »3 au lieu de la langue française.
Ses thèses étant en déphasage avec l’idéologie coloniale, Dard est vite évincé tandis que le français est imposé comme langue unique d’enseignement. Dans une lettre du 23 mars 1829 adressée au ministre de la Marine, le gouverneur de la colonie Jean Jubelin donne le ton du « nouvel établissement », qui a désormais pour mission l’instruction et la formation d’une élite éduquée à l’européenne. Il s’agit, écrit-il, d’« amener les habitants indigènes à la connaissance et à l’habitude du français et associer pour eux à l’étude de notre langue celle des notions les plus indispensables. Leur inspirer le goût de nos biens et de nos industries. Enfin, créer chaque année parmi eux une pépinière de jeunes sujets propres à devenir l’élite de leurs concitoyens, à éclairer à leur tour et à propager insensiblement les premiers éléments de civilisation européenne chez les peuples de l’intérieur.4 »

Un projet « éducatif » appliqué par les gouverneurs coloniaux qui vont se succéder. Louis Faidherbe, grand idéologue de l’occupation de l’Afrique occidentale, comprend que la « mise en valeur » des colonies de l’AOF passe par l’instruction en français. En créant l’École des otages et en y faisant inscrire les fils de chefs et de notables ramenés de campagnes militaires, il associe au contrôle des corps et des territoires un modelage strict des esprits.
Dans l’ouvrage qu’il consacre à Faidherbe en 1947, Georges Hardy, inspecteur de l’éducation, précise les intentions de l’ancien gouverneur du Sénégal : « L’école, à ses yeux, n’est pas seulement cette banale officine pédagogique où l’on enseigne le b.a.-ba et les quatre règles sans trop se demander où cela conduit, c’est essentiellement un instrument de formation morale, destiné à faire comprendre les intentions du peuple tuteur, à ouvrir pour l’influence française des voies larges et sûres d’où la contrainte est exclue. » Ainsi peut-on procéder à la « conquête morale » de l’Africain et en faire l’« auxiliaire de l’Européen », indique Hardy.
Le vecteur qui diffuse le projet de conquête
Quelques années avant sa mort et alors qu’il n’est plus en poste dans les colonies, Faidherbe voit en 1883 son intérêt pour l’éducation coloniale se raviver lors de la création de l’Alliance française dont il devient un des présidents d’honneur. Il en précise l’objectif – « étendre l’influence de la France en facilitant ses relations sociales et ses rapports commerciaux avec les différents peuples par la propagation de sa langue » – et lui fournit en 1884 une série d’observations et de conseils pour une meilleure diffusion de la langue au sein des masses indigènes africaines. Il préside même une réunion des diverses sections africaines de l’Alliance le 21 novembre 1884, à la grande Chancellerie de la Légion d’honneur à Paris, à laquelle prend part l’explorateur Paul Soleillet, auteur en 1876 d’un ouvrage au titre prometteur : Avenir de la France en Afrique5.
La langue devient sous le régime colonial le vecteur qui diffuse le projet de conquête dans l’esprit des indigènes parallèle à celui de la répression des corps. Le lieutenant Paulhiac, membre de la Société de géographie de Paris et auteur de Promenades lointaines : Sahara, Niger, Tombouctou, Touareg, résume bien en 1905 la préoccupation de cette période : « C’est dans notre langue que résidera notre force, comme elle sera, plus tard, la base de notre indestructible influence dans les pays que nous aurons façonnés à notre image.6 »
En 1920, la création du Service des œuvres françaises à l’étranger (SOFE) sert aussi cet objectif, mais il faudra attendre les indépendances africaines pour que soient vraiment créées les premières institutions de la Francophonie.
Contrairement au mythe destiné à les légitimer, la mise en place d’institutions de promotion de la francophonie ne naît pas d’une initiative africaine. Corollaire de la colonisation, elle mûrit dans l’esprit d’officiels français, du général de Gaulle en particulier. « Maintenant que nous avons décolonisé, notre rang dans le monde repose sur notre force de rayonnement, c’est-à-dire avant tout sur notre puissance culturelle. La francophonie prendra un jour le relais de la colonisation ; mais les choses ne sont pas encore mûres », explique le Général à Alain Peyrefitte le 11 septembre 1966.7
« Opération francophonie »
Obnubilé par le rôle que la France doit jouer dans un monde marqué par la réalité des deux grands blocs de l’Ouest et de l’Est, de Gaulle mesure l’enjeu que les pays francophones représentent pour la France. Dans les années 1960, un débat est lancé sur le concept de « francophonie »8. S’agit-il d’un simple patrimoine linguistique commun ? Faut-il rassembler les pays qui utilisent le français dans une organisation commune ? D’abord réticent à l’idée d’institutionnaliser la francophonie, le Général a conscience du potentiel de puissance que la langue peut offrir à la France. C’est ce qu’illustre l’intérêt qu’il porte au Québec, bastion francophone au cœur de l’Amérique.
Mais, alors qu’il se montre volubile sur la position de la France concernant les francophones du Canada, le Général reste évasif lorsqu’il s’agit des territoires de l’empire colonial français. « La francophonie est une grande idée » selon lui, mais « il ne faut pas que nous soyons demandeurs », précise-t-il en conseil des ministres le 7 mai 1963. Dans son entourage, on s’active donc pour inciter les « amis » africains à prendre l’initiative. « Je suis très favorable à la francophonie, indique le Premier ministre Georges Pompidou à Alain Peyrefitte le 31 août 1967. Je dirais même plus que le Général, qui a peur de provoquer une réaction hostile de la part des pays colonisés. Il répète : “Donner et retenir ne vaut. Il ne faut pas avoir l’air de les recoloniser.” Je n’ai pas ces scrupules. »
Pompidou lance donc une véritable « opération francophonie » : Matignon se dote d’un « Haut Comité pour la défense et l’expansion de la langue française », dès 1966, et mobilise Léopold Sédar Senghor, ami de jeunesse de Pompidou et grand partisan de la francophonie. C’est en tout cas ce que raconte le diplomate Bernard Dorin, chef du service des Affaires francophones du ministère des Affaires étrangères (1975-1978) et président de l’association Avenir de la langue française (1998-2003), qui précise : « J’ai assez bien connu le président Senghor lorsqu’il était président de la République du Sénégal, car il constituait alors l’une des pièces maîtresses de “l’opération francophonie” lancée parallèlement à tout circuit officiel par quelques jeunes fonctionnaires dont Philippe Rossillon et moi-même. Les deux autres membres du “Triumvirat” étaient […] le président Diori Hamani du Niger et le Président Bourguiba de Tunisie.9 » Le président Norodom Sihanouk du Cambodge apporte une caution asiatique à l’entreprise.
Le mythe d’une initiative africaine
L’idée que les élites colonisées sont à l’origine de la Francophonie en tant qu’institution intergouvernementale va ainsi faire son chemin. La parution en 1962 de l’article de Senghor – « Le français, langue de culture » – dans la revue Esprit est présentée a posteriori comme un événement fondateur. Les défenseurs de la Francophonie « veulent ainsi prouver, observe l’universitaire française Alice Goheneix, que ce sont bien les anciens colonisés, africains et asiatiques – et non l’ancienne métropole – qui décidèrent de faire de la langue française l’objet et le sujet d’une organisation internationale »10. L’aspect culturel est volontairement mis en avant. Senghor présente l’ambition linguistique et culturelle mondiale affichée comme un « humanisme intégral qui se tisse autour de la terre » et met en garde ceux qui y verraient « une machine de guerre montée par l’impérialisme français ».

Sur les fondations posées dans le sillage des indépendances, avec la création en 1960 de la Conférence des ministres de l’Éducation des pays africains et malgache d’expression française (CONFEMEN) et l’installation en 1963 d’un Centre de linguistique appliquée à Dakar, la France consolide l’armature institutionnelle de la francophonie dans la seconde moitié des années 1960, en prenant soin de mettre en avant le « désir » de francophonie de ses alliés africains. En juin 1966 est mis en place un espace politique francophone avec la première conférence à Tananarive des chefs d’État de l’Organisation commune africaine et malgache (Ocam). Le 20 mars 1970, la Conférence de Niamey institue l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui deviendra l’Agence intergouvernementale (1998) puis l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF, en 2006). Le président François Mitterrand crée en 1984 le Haut Conseil de la Francophonie et, en 1999, l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française devient l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Consécration de ce processus, un sommet ritualisé biannuel – Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage – est organisé à partir de 1986 pour décider des orientations et de la stratégie de l’institution.
Des institutions comme l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) visent désormais à renforcer la solidarité entre institutions parlementaires et mairies de la communauté francophone tandis que l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) s’active dans la promotion de l’enseignement en langue française. À côté de ces différentes structures dont la liste est loin d’être exhaustive s’illustrent celles qui sont strictement françaises et qui participent de la stratégie d’influence culturelle de Paris. France Médias Monde réunit ainsi France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya (la radio en langue arabe) mais également la filiale Canal France International, une agence de coopération qui, pour le compte du Quai d’Orsay, coordonne l’aide au développement spécifique aux médias. L’Afrique reste évidemment une cible de choix. Elle est « notre respiration », soutient en 201511 la patronne de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, dont la structure, en partenariat avec CFI, met en œuvre depuis juillet 2020 le projet « Afri’Kibaaru » : une production d’informations en langues locales ciblant les populations de six pays du Grand Sahel, financée par l’Agence française de développement et présentée comme une réponse aux « défis sécuritaires, économiques, sociaux et institutionnels ».
« Penser français » pour acheter français
Dès les débuts de la francophonie moderne, la langue est considérée comme un vecteur de débouchés économiques. Lors de son allocution à l’Assemblée nationale française le 23 octobre 1967, Yvon Bourges, secrétaire d’État chargé de la Coopération explique que son « premier objectif […] est de favoriser la pénétration de la langue et de la culture françaises dans les pays d’Afrique et de Madagascar ». Et Bourges poursuit : « Le second objectif que nous proposons est d’ordre économique : le maintien et le développement des intérêts commerciaux et industriels français constituent également une des préoccupations constantes du secrétaire d’État aux Affaires étrangères chargé de la Coopération. Je le dis sans aucune honte, cela n’a d’ailleurs rien d’illégitime ni de sordide. »
La juxtaposition de ces deux objectifs par le gouvernement n’a rien de surprenant. La langue ouvre la voie aux marchés, comme le maintien d’une présence culturelle forte participe d’un imaginaire collectif favorable à la sauvegarde des intérêts économiques de Paris, en faisant localement « penser français ». Inversement, le maillage économique hexagonal maintient une influence culturelle, et donc politique, française.
Cette stratégie a été poursuivie au fil des ans. Ainsi, dans le rapport que lui demande le président François Hollande sur les opportunités économiques qu’offre la francophonie avant le sommet de l’OIF à Dakar, en 2014, Jacques Attali fait plusieurs recommandations. Constatant que le français « perd du terrain », l’ancien conseiller de François Mitterrand propose de renforcer son enseignement, de diffuser des contenus culturels et créatifs francophones, de faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, et d’organiser des réseaux de personnalités d’influence francophones. Car Attali le sait, les exportations françaises vont de pair avec l’utilisation de la langue. Il existe une « corrélation entre la proportion de francophones dans un pays et la part de marché des entreprises françaises dans ce pays », explique-t-il dans ce rapport12. La France doit donc selon lui, via un « altruisme rationnel », réaffirmer son rôle d’intermédiaire incontournable dans le commerce avec les pays francophones, notamment vis-à-vis de la Chine : « Parce que c’est en français, affirme Attali dans un entretien à RFI, qu’on peut le mieux commercer, investir en Afrique13.
Mais ses propositions vont plus loin : il propose notamment la mise en place de « politiques industrielles francophones » dans des domaines tels que les technologies numériques, la téléphonie mobile, le secteur pharmaceutique ou encore l’industrie minière. En définitive, il s’agit, par le biais de la langue, d’ouvrir des débouchés aux entreprises françaises et de « transformer à terme l’Organisation internationale de la Francophonie en Union économique francophone ».
Un « bastion » à défendre
Un sillon également creusé par différents rapports parlementaires français. Le rapport de la mission d’information sur « la stabilité et le développement de l’Afrique francophone » publié en mai 2015 recommande par exemple de faire du français le principal « vecteur d’influence politique, culturelle et économique » et donc, le premier axe de la politique française sur le continent africain. Dans un entretien accordé en août 2015 à Mondafrique, Jean-Christophe Rufin, ex-ambassadeur de France au Sénégal, abonde dans le même sens. Il plaide pour le renforcement des lycées français en Afrique considérés comme le « dernier vrai bastion sur le continent »14. Leur destin conditionne, dit-il, « la formation des élites, les futurs liens économiques, le maintien du français comme langue de référence ».
En 2018, dans un rapport sur « la diplomatie culturelle et d’influence de la France », deux députés écrivent encore que celle-ci « n’est ni un gadget, ni un moyen de compenser notre puissance déchue, c’est un puissant vecteur de notre politique étrangère ». Tout en appelant à « rompre avec un “universalisme conquérant” », ils rappellent que « la compétition mondiale porte aussi sur la capacité à faire partager ses idées, ses œuvres culturelles, sa vision du monde, ses concepts, sa ou ses langues. Que nous le voulions ou non, nous existons, dans le regard de beaucoup de pays du monde, par la culture et par les œuvres de l’esprit et notre influence dépend aussi de notre capacité à répondre à cette curiosité et à cette attente vis-à-vis de la France, et à les entretenir ». L’enjeu est de « créer les conditions d’un rapprochement profond et sur le temps long, de liens quasi émotionnels, d’une intimité qui peut s’avérer décisive en matière diplomatique » car, rappellent-ils, « si le travail de chancellerie permet d’avoir des “alliés”, la diplomatie culturelle permet de se faire des “amis” ». Et l’amitié, ça paie : « Les Français arrivent avec un quatuor de Debussy et repartent avec une centrale nucléaire », comme le dit un des interlocuteurs interrogés par les députés15.
Depuis son élection, le président Emmanuel Macron cherche à son tour à investir et à moderniser le soft power linguistique : nomination de Leïla Slimani comme représentante personnelle du président pour la Francophonie (2017), lancement d’une « stratégie pour la langue française et le plurilinguisme » (2018), etc. « Ne le regardez pas [le français] comme une langue que certains voudraient ramener à une histoire traumatique, explique-t-il lors de son discours à l’Université de Ouagadougou en novembre 2017. Elle n’est pas que cela puisqu’elle est la langue de vos poètes, de vos cinéastes, de vos artistes, vous l’avez déjà réacquise, vous vous l’êtes déjà réappropriée ! »
Les silences coupables de l’OIF
Macron, qui affiche une vision « ouverte » de la francophonie, inscrit sa défense de la langue française dans une lutte globale pour le « plurilinguisme » : la francophonie, loin de nourrir un dessein hégémonique, ne serait qu’un élément de richesse culturelle. Un argument déjà utilisé par exemple par le très foccartien Jacques Godfrain, ancien ministre de la Coopération devenu président de la Fondation Charles de Gaulle et de l’Association francophone d’Amitié et de Liaison (fédération qui est membre consultatif de l’OIF depuis 2001), dans un colloque au Sénat en 2016 : « J’ai horreur, pour mettre les pieds dans le plat, de l’idée que le français est une langue impérialiste qui voudrait couvrir le monde entier comme d’autres. […] Je suis comme vous pour la pluralité culturelle et linguistique que nous soutenons. »
Suscitant de la méfiance, l’offensive d’Emmanuel Macron n’a pas manqué de créer un bouillonnement sur la scène intellectuelle francophone. Invité par le président le 13 décembre 2017 à contribuer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie, l’écrivain Alain Mabanckou décline l’invitation en rappelant que la francophonie est « perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies ». Pire, « la Francophonie “institutionnelle” […] n’a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d’expression, tout cela orchestré par des monarques qui s’expriment et assujettissent leurs populations en français. Ces despotes s’accrochent au pouvoir en bidouillant les Constitutions (rédigées en français) sans pour autant susciter l’indignation [de Paris] », observe l’auteur franco-congolais écœuré du soutien français à [Denis] Sassou Nguesso16.
Au premier article de sa charte, l’OIF se fixe pourtant comme objectif d’« aider à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme ». À ce titre, elle envoie même des observateurs ou des « missions d’information et de contact » lors d’élections dans ses pays membres, sans jamais dénoncer les simulacres en question. Ce laxisme tranche avec l’attitude du Commonwealh qui avait suspendu pour atteinte à la démocratie le Zimbabwe en mars 2002, les îles Fidji en 2009 et proposé en 2013, en réaction aux multiples atteintes aux libertés en Gambie, la création à Banjul de commissions pour les droits humains, les médias et la lutte contre la corruption. Ce qui avait à l’époque suscité l’ire du président gambien et le retrait de son pays de l’institution anglophone.
Les langues africaines… au service de l’influence française
La francophonie est également dénoncée au nom de la diversité des cultures. Mabanckou et Achille Mbembe plaident en 2018 pour « l’émergence d’une véritable francophonie des peuples »17. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne insiste, lui, sur le « pluralisme » et pense que le français ne doit être qu’une langue parmi les autres de l’espace francophone18.
Mais cet argument de la diversité, qui fait écho au « plurilinguisme » brandi par le président Macron, n’est pas sans poser quelques problèmes. Les langues africaines restent pour l’essentiel confinées à la périphérie par l’institution francophone qui les emploie pour promouvoir le français. En témoigne le programme « ELAN-Afrique » (École et Langues nationales en Afrique), lancé par l’OIF en 2011 et financé par l’Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères français. À travers ce programme, qui compte en 2021 douze pays africains francophones partenaires, l’OIF cherche à améliorer l’apprentissage du français, mal assimilé, en s’appuyant sur la langue maternelle des élèves. Comme jadis les tirailleurs mis au service d’une armée française défaillante, les langues africaines sont ainsi rabaissées au rang de béquilles pour soutenir la langue de l’ancien colonisateur, dont l’hégémonie à l’école et dans les médias est de plus en plus critiquée.
Cette situation crée des inégalités car les langues locales servent de faire-valoir et permettent la transition vers le français dont la promotion passe aussi par la formation des enseignants. En effet, à la suite de la publication d’un rapport du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la CONFEMEN en décembre 2020, qui souligne que plus de la moitié des élèves de quinze pays d’Afrique subsaharienne francophone débutent leur scolarité dans le secondaire sans savoir ni écrire ni lire en français, Paris annonce son intention de former en cinq ans plus de 10 000 enseignants pour relever le défi de la qualité de l’enseignement. Lors de l’inauguration le 1er février 2021 du Centre de développement professionnel (CDP) devant accueillir les enseignants à Abidjan, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, parle de « maillon fort de l’enseignement français ». Le discours officiel sur la diversité se traduit ainsi dans les faits par une uniformisation au seul profit du français.
En marge du sommet de la Francophonie de 2014, une grande voix de la linguistique sénégalaise, Aram Fal, pointait déjà un certain nombre d’insuffisances engendrées par cette promotion du français. Elle dénonçait l’inadaptation de ce vecteur d’enseignement, le complexe d’infériorité engendré par une langue considérée comme un médium de prestige et l’absence des langues nationales dans la sphère officielle. « Aucun pays ne peut se développer lorsque la majorité écrasante de sa population ne comprend pas la langue officielle », relève-t-elle19. Ce que résume le linguiste belge Jean-Marie Klinkenberg qui perçoit bien les inégalités inhérentes à cette diversité mal conçue : « La diversité ne réduit pas les inégalités : elle en est le cache-sexe. Elle se contente de les réguler, en adaptant un système fondamentalement inégalitaire à la réalité culturelle du monde globalisé.20»
« Un prolongement de la stratégie coloniale »
Dans l’univers de la francophonie, le volet linguistique n’est jamais éloigné du volet politique. Aujourd’hui, l’OIF se déploie même sur le terrain militaire avec l’ouverture de l’ère de la « prévention des conflits » rendue possible par la déclaration de Saint-Boniface de mai 2006, laquelle confère à l’institution des « objectifs stratégiques » portant sur la « consolidation de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’État de droit, ainsi que sur la prévention des conflits et l’accompagnement des processus de sortie de crises, de transition démocratique et de consolidation de la paix ». Une volonté réaffirmée tour à tour lors des sommets de la Francophonie de 2008 à 2018 et concrétisée entre autres par la création en 2014 du Réseau d’expertise et de formation francophone pour les opérations de paix (Reffop).
Présentée comme un outil destiné à « favoriser l’usage de la langue française dans les opérations de paix et d’y renforcer la participation des francophones »21, cette nouvelle ambition francophone doit servir à « multilatéraliser nos interventions », déclarait en 2008 le député Bernard Cazeneuve, tout en s’inquiétant que les actions françaises « autour et sur la base de l’OIF pour favoriser le développement du maintien de la paix soient perçues par nos partenaires comme une manière, détournée, de revenir à une prédominance française »22.
Le détournement de l’institution à des fins de soft power pour la France est pourtant une évidence depuis longtemps, comme le rappellent les organisateurs d’un contre-sommet de la Francophonie à Dakar en 2014, qui reprochent à l’OIF, dans une lettre ouverte, d’être « une supercherie et par-dessus tout, un prolongement de la stratégie coloniale destinée à l’exploitation de nos matières premières, la formation d’une élite politique aux ordres de l’Élysée et l’abrutissement de nos peuples ».
Un « pacte renégocié » de la Françafrique »
Loin de rompre avec ses prédécesseurs, Emmanuel Macron utilise même l’institution au bénéfice de sa politique de rapprochement avec Kigali, en œuvrant activement à l’élection de Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères et de la Coopération comme secrétaire générale de l’OIF. L’élargissement de l’institution à des pays où le français est peu pratiqué, les missions d’observation de processus électoraux, font également de la Francophonie un outil stratégique dont les desseins au niveau international ne peuvent être dissociés de ceux de la France, comme le rappelait si bien Bernard Cazeneuve : « On ne peut pas disjoindre totalement la Francophonie du discours porté par la France au niveau international. »
Les prétentions à la prévention des conflits, les missions d’observation des élections et la formation en français de soldats de la paix, cachent mal un prolongement de la coopération militaire sur une base multilatérale, une volonté de mainmise politique et la promotion des technologies de défense françaises. La francophonie militaire est en effet créatrice de débouchés, comme le remarque Brice Poulot, spécialiste de l’enseignement du français comme langue militaire : « Il existe un lien réel entre la francophilie d’une armée étrangère (ou du moins de son état-major) et la provenance de son matériel de défense.23 »
Cette évolution vers la stratégie de puissance est dénoncée par la philosophe Hourya Bentouhami qui pointe en 2018 dans une tribune le « pacte renégocié » d’une « Françafrique qui rêve de se doter d’un “soft power” capable de faire passer derrière l’usage circonstanciel d’une langue commune les accords économiques de libéralisation des marchés africains ». Une stratégie d’influence que le président Emmanuel Macron déploie en mai 2021 à Kigali à l’occasion de sa visite de rapprochement avec le chef de l’État anglophone Paul Kagame, chantre du néolibéralisme en Afrique, au côté duquel il n’hésite pas à célébrer une « francophonie de reconquête, ouverte, modernisée ».
Lire aussi sur notre site :
• Une somme incontournable sur la construction de la Françafrique, par François Gèze
• Onésime Reclus, inventeur du mot « francophonie » et militant de l’expansion coloniale
• Le livre de David Todd « Un empire de velours » montre l’étendue et la permanence de l’empire colonial français
- Onésime Reclus, Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique, Paris, Librairie Universelle, 1904, p. 219.
- Onésime Reclus, Un grand destin commence, Paris, La Renaissance du livre, 1917, p. 95.
- Cité dans Ibrahima Seck, La stratégie culturelle de la France en Afrique, Paris, l’Harmattan, 1993, p. 35.
- Cité dans Denis Bouche, L’Enseignement dans les territoires français de l’Afrique occidentale de 1817 à 1920 : mission civilisatrice ou formation d’une élite ?, Champion, Paris, 1975, p. 82.
- Paul Soleillet, Avenir de la France en Afrique, Paris, Chalamel Ainé Librairie-éditeur, 1876.
- Lieutenant H. Paulhiac, Promenades lointaines : Sahara, Niger, Tombouctou, Touareg, Paris, Plon, vers 1905, p. 406.
- Alain Peyrefitte, C’était De Gaulle, Paris, Fayard, vol. 3., p. 330.
- Ecrite avec une majuscule, la Francophonie désigne ici l’institution (quel que soit son nom, selon les époques) pour promouvoir la francophonie, écrite avec une minuscule quand le mot désigne le concept.
- Bernard Dorin, « Senghor et la naissance de la francophonie ». Dans Léopold Sédar Senghor, Africanité – Universalité, Itinéraires et contacts de cultures, Paris, l’Harmattan, volume 31 (2002), p. 89.
- Alice Goheneix, « Les élites africaines et la langue française : une appropriation controversée », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 40/41 (2008), p. 4.
- Agnès Faivre, « Francophonie : la bataille des images fait rage », Le Point, 21 octobre 2015.
- Jacques Attali, La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable, Paris, Direction de l’information légale et administrative, 2014.
- Jacques Attali, « La Francophonie peut générer un million d’emplois », Entretien à RFI, 27 novembre 2014. »
- « L’inexpérience de Hollande en Afrique, par l’Académicien Jean-Christophe Rufin », Mondafrique, 26 août 2015.
- Rapport d’information (…) en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017 sur « La diplomatie culturelle et d’influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? », 21 octobre 2018,
- Alain Mabanckou, « Francophonie, langue française : lettre ouverte à Emmanuel Macron », Revue de l’Université de Moncton, Volume 49, numéro 2, 2018, p. 5–7
- Alain Mabanckou et Achille Mbembe, « Le français, notre bien commun », L’Obs, 11 février 2018
- Souleymane Bachir Diagne, Francophonie en « guerre culturelle » : la liberté de choisir, Jeune Afrique, 1er mars 2018.
- Aram Fall, « Français et langues nationales : vaincre le complexe d’infériorité », Pambazuka News, 14 décembre 2014.
- Jean-Marie Klinkenberg, « La francophonie comme idéologie. Mythes et réalités d’un discours sur la diversité culturelle », Revue de l’Université de Moncton, Volume 48, no 1, 2017, p. 36.
- OIF, La contribution de la francophonie aux opérations de maintien de la paix, Direction « Affaires politiques et gouvernance démocratique », janvier 2017, p. 7.
- Bernard Cazeneuve, « Francophonie et coopération militaire, un nouveau départ pour l’OIF », Revue internationale et stratégique, vol. 71, no. 3, 2008, pp. 110.
- Brice Poulot, « Le français langue militaire, instrument de la profondeur stratégique de la francophonie », Études de l’IRSEM, no 26, 2013, p. 97.