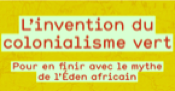L’invention du colonialisme vert,
par Guillaume Blanc
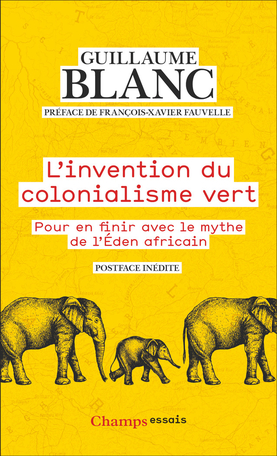
Présentation de l’éditeur
L’histoire débute à la fin du XIXe siècle. Persuadés d’avoir retrouvé en Afrique la nature disparue en Europe, les colons créent les premiers parcs naturels du continent, du Congo jusqu’en Afrique du Sud. Puis, au lendemain des années 1960, les anciens administrateurs coloniaux se reconvertissent en experts internationaux. Il faudrait sauver l’Éden ! Mais cette Afrique n’existe pas. Il n’y a pas de vastes territoires vierges de présence humaine, et arpentés seulement par ces hordes d’animaux sauvages qui font le bonheur des safaris touristiques. Il y a des peuples, qui circulent depuis des millénaires, ont fait souche, sont devenus éleveurs ici ou cultivateurs là. Pourtant, ces hommes, ces femmes et enfants seront – et sont encore – expulsés par milliers des parcs naturels africains, où ils subissent aujourd’hui la violence quotidienne des éco-gardes soutenus par l’Unesco, le WWF et tant d’autres ONG.
Convoquant archives inédites et récits de vie, ce livre met au jour les contradictions des pays développés qui détruisent chez eux la nature qu’ils croient protéger là-bas, prolongeant, avec une stupéfiante bonne conscience, le schème d’un nouveau genre de colonialisme : le colonialisme vert.
Guillaume Blanc est maître de conférences à l’université Rennes 2. Formé à la Chaire du Canada en histoire environnementale, il travaille aujourd’hui sur la circulation contemporaine des experts et des savoirs qui préside, en Afrique, au gouvernement global de la nature et des hommes. Il dirige la collection « histoire environnementale » aux Éditions de la Sorbonne, où il a notamment publié Une histoire environnementale de la nation (2015) et co-dirigé Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes (2017). Son dernier livre, L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain, est paru chez Flammarion en 2020.
Entretien avec Guillaume Blanc
La colonie naturelle
par David Castañer, publié par En attendant Nadeau le 14 septembre 2020.
Source
L’invention du colonialisme vert, sous-titré « Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain », interroge notre vision fantasmée de la nature africaine, tout en pointant les soubassements coloniaux des politiques de préservation mises en œuvre par certains gouvernements africains sous le patronage des organisations internationales. Pour ce faire, l’historien Guillaume Blanc choisit d’étudier la naissance des parcs nationaux en Éthiopie, les acteurs qui les ont promus, les discours qui les ont justifiés et l’ensemble de violences que cette conception de la nature implique.
En France, les parcs naturels valorisent l’empreinte des siècles d’exploitation agricole sur les paysages. Celui des Cévennes, par exemple, est classé depuis 2011 au patrimoine mondial de l’Unesco qui entend sauver les « systèmes agro-pastoraux » et conserver « les activités traditionnelles ». Dans la plupart des pays d’Afrique, au contraire, l’Unesco exige que les parcs naturels soient vidés des populations qui y ont toujours vécu. En Europe, le récit dominant parle de l’adaptation harmonieuse de l’homme à la nature ; en Afrique, de la dégradation sauvage de la nature par l’homme. Le « colonialisme vert » qui donne son titre au livre de Guillaume Blanc désigne l’ensemble des pratiques et des discours mis en œuvre par les experts occidentaux pour sauvegarder la nature en Afrique, et qui finissent par perpétuer l’esprit colonial, le monde moderne et civilisé continuant de sauver l’Afrique des Africains.
D’un côté, les récits de navigateurs et géographes du XVIe siècle, des botanistes du XVIIIe et des romanciers du XXe siècle qui dépeignent un continent africain sauvage, peuplé de bêtes fauves et de forêts vierges. De l’autre, les techniques de contrôle des ressources mises en place par les puissances coloniales pour mettre un frein à l’exploitation des richesses naturelles qu’elles ont provoquée. Ce paradoxe, dans lequel se construit l’imaginaire occidental de la nature africaine, trouve une expression dans la création de réserves de chasse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Elles permettent aux puissances coloniales de restreindre le braconnage et le trafic de faune, de limiter l’accès des Africains à leurs ressources et d’engranger des revenus. À partir des années 1920, les réserves de chasse deviennent parcs nationaux, avec des limitations légales plus strictes concernant l’abattage d’animaux et la destruction de la flore. Aujourd’hui, l’Afrique en compte un peu plus de 350.
L’un des apports majeurs du travail de Guillaume Blanc est l’attention portée à la permanence des acteurs qui permettaient l’exploitation de la nature à l’époque coloniale et qui furent ensuite mis au service d’une conservation guidée par les anciens colonisateurs. C’est le cas d’organisations coloniales qui deviendront des institutions internationales, comme la Société pour la protection de la faune sauvage de l’Empire, créée en 1903 et dont l’ONG Fauna & Flora International est le dernier avatar.
En Éthiopie, ce sont cinq missions de l’Unesco, composées principalement d’anciens administrateurs coloniaux, qui finiront par proposer la création de trois parcs nationaux : Omo, Awash et Simien. C’est également sous le parrainage de l’Unesco que l’empereur Haïlé Sélassié recrute en 1965 son conseiller pour la protection de la nature, John Blower, forestier diplômé d’Édimbourg, ancien soldat de la Royal West African Frontier Force qui s’est illustrée dans la répression des rebelles Mau Mau au Kenya. Blower – mort en juin dernier, à près de cent ans – propose les postes de gardiens des trois parcs éthiopiens à des experts nord-américains ou britanniques. Il conçoit également une loi sur les parcs nationaux qui sera adoptée en 1970. Cette ingérence étrangère n’est pas propre à l’Éthiopie et nombreux sont les pays africains qui entretiennent une relation de dépendance avec les experts internationaux. Les autorités éthiopiennes souhaitent obtenir de l’Unesco le classement dans le patrimoine mondial de l’humanité de ses parcs et c’est pour cela qu’elles devront parfois satisfaire la pulsion de contrôle de ses experts et se plier aux injonctions des organisations internationales.
L’histoire de la naissance des parcs nationaux en Éthiopie est celle de la violence exercée par l’État pour déplacer les populations qui vivaient dans ces espaces. Les stratégies vont de l’étranglement progressif – interdiction de la chasse (sauf à certains moments pour les étrangers, bizarrement), du pâturage, de la culture au-delà d’une certaine surface de plus en plus réduite – à l’expulsion manu militari. Des solutions sont proposées aux paysans qui vivent depuis plusieurs générations dans ces lieux, mais elles consistent souvent en une réorientation vers des métiers urbains et des relogements parfois à plus de 1 000 km de leur terre d’origine, ce qui revient à un appauvrissement certain et à une dégradation de leurs conditions de vie. Une première expulsion des habitants du Simien est prévue pour 1973. La révolution menée par Mengistu Haïlé Mariam retarde l’échéance jusqu’en 1979.
Cette violence faite aux paysans, encouragée d’une certaine manière par l’Unesco et les experts occidentaux, sert de couverture au derg communiste lorsqu’il entend mater les rebelles qui préparent la guerre civile et sont souvent réfugiés dans ces maquis. Les gardes du parc du Simien sont enrôlés pour combattre les insurgés et les soldats jettent du haut de la falaise de Chenek tous ceux qu’ils suspectent de rébellion. Revenus après la fin du conflit, les habitants du Simien sont à nouveau menacés d’expulsion depuis que le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco demande en 2010 de suivre ses recommandations. En 2016, les 2 508 habitants de Gich quittent la zone du parc et sont relogés à Debark, 35 km plus à l’ouest, où ils reçoivent des cours de maçonnerie, de menuiserie, de tissage et de charpenterie. D’autres villages sont menacés d’expulsion et les villageois hésitent entre un déplacement « volontaire » et l’attente du conflit ouvert avec le gouvernement. Cette situation n’est pas spécifique aux parcs éthiopiens, puisque les expulsions définitives de population ont eu lieu dans 50 % des parcs du Bénin, 40 % des parcs du Rwanda et 30 % de ceux de la Tanzanie ou du Congo-Kinshasa.
Au long des décennies, le principal argument en faveur de l’expulsion consiste à dire que l’agropastoralisme est responsable de la déforestation et de l’appauvrissement des sols – raisonnement du début du XXe siècle repris en Éthiopie dès les premières missions de l’Unesco dans les années 1960. Ce « mythe de la forêt perdue » qui continue de guider les politiques publiques est déconstruit par Guillaume Blanc qui montre, preuves à l’appui, qu’il repose sur des chiffres inventés ou peu rigoureux. Bien qu’il ne lui oppose pas une glorification du paysan africain, il apporte quelques éléments pour penser des relations harmonieuses entre les sociétés agropastorales du Simien et leur environnement, un certain équilibre cyclique entre déboisement et reboisement. Les manières d’agencer ce mythe aux projets politiques d’expulsion changent avec le temps et s’adaptent désormais aux discours sur le développement durable, la démocratie participative et les communs, dont les biais apparaissent ici avec éclat.
L’expulsion violente de populations qui vivent de l’agropastoralisme et dont l’empreinte écologique est quasiment nulle ne peut pas être justifiée par des arguments écologistes. D’autant plus que les parcs nationaux éthiopiens ont été conçus dès 1966 comme des attractions touristiques et que la présence des visiteurs étrangers sur les lieux suppose une pollution bien supérieure à celle que pourraient occasionner les paysans.
Œuvre d’un historien qui ne dédaigne pas certains apports des études culturelles et des postcolonial studies, le livre de Guillaume Blanc résonne avec les travaux de Malcolm Ferdinand, d’Arturo Escobar et de tous ceux qui subodorent les failles du concept européen de nature et envisagent une manière décoloniale de penser l’écologie, sensible aux différences territoriales, aux luttes locales, et critique à l’égard des grands récits de l’Anthropocène et du développement durable.