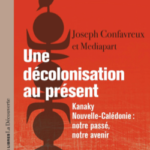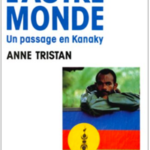Le dernier empire colonial
par Edwy Plenel, extrait de la postface à Une décolonisation au présent. Kanaky-Nouvelle-Calédonie : notre passé, notre avenir, de Joseph Confavreux et Mediapart publié à La Découverte.
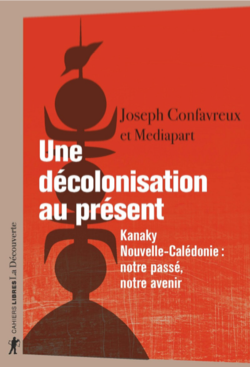 Ce livre collectif auquel ont contribué Lucie Delaporte, Carine Fouteau, Ellen Salvi, Julien Sartre et Antoine Perraud relate le processus né des événements terribles de 1988 vers la décolonisation du territoire. Lecture indispensable pour comprendre les enjeux du second référendum prévu par l’accord de Nouméa en 1998 qui reconnaissait, pour la première fois, le fait colonial de la République française dans le « vaste mouvement historique où les pays d’Europe ont imposé leur domination au reste du monde ». Le scrutin du 4 octobre 2020 concerne la France entière. Ce qui s’y joue c’est sa capacité, ou non, à inventer une décolonisation réussie alors même que le passé colonial ne cesse de saisir le présent hexagonal.
Ce livre collectif auquel ont contribué Lucie Delaporte, Carine Fouteau, Ellen Salvi, Julien Sartre et Antoine Perraud relate le processus né des événements terribles de 1988 vers la décolonisation du territoire. Lecture indispensable pour comprendre les enjeux du second référendum prévu par l’accord de Nouméa en 1998 qui reconnaissait, pour la première fois, le fait colonial de la République française dans le « vaste mouvement historique où les pays d’Europe ont imposé leur domination au reste du monde ». Le scrutin du 4 octobre 2020 concerne la France entière. Ce qui s’y joue c’est sa capacité, ou non, à inventer une décolonisation réussie alors même que le passé colonial ne cesse de saisir le présent hexagonal.
Si je ne me suis rendu qu’une fois en Nouvelle-Calédonie, pour des reportages au début de l’année 1986, la Kanaky est un paysage de pensée qui m’habite toujours, resté aussi proche mentalement que cette terre est lointaine géographiquement.
Les dimanches où je cours au Jardin des Plantes à Paris, je ne manque jamais de saluer les mânes d’Ataï, le chef de la grande révolte kanak de 1878, en passant devant l’orme blanc planté lors de la cérémonie de restitution à son peuple de son crâne, longtemps enfoui dans les réserves du Muséum d’histoire naturelle où la puissance coloniale le conservait en secret, tel un trophée barbare.

Mais, au-delà de ses rendez-vous familiers, j’ai gardé le souvenir des étudiants kanak qui, à Paris dans la foulée de Mai 1968, participaient avec entrain aux mobilisations anti-impérialistes des années 1970, représentant les groupes de jeunes qui allaient constituer la base militante du Front indépendantiste (1979), puis du Front de libération nationale kanak et socialiste, le FLNKS (1984). Nous apprenions d’eux cette civilité coutumière, fondée sur le respect d’autrui, une douce bienveillance qui n’excluait pas la fermeté des convictions.
L’assaut sanglant de la grotte d’Ouvéa
Surtout, dans mon parcours de journaliste, la question calédonienne marque un moment à part, dont l’empreinte ne s’est jamais effacée. Travaillant alors au quotidien Le Monde, j’ai révélé dans ses colonnes, au printemps et à l’été 1988, la vérité sanglante de l’assaut mené par les unités d’élite des armées françaises contre la grotte d’Ouvéa, sur ordre du pouvoir exécutif français – le premier ministre Jacques Chirac qui n’en fut pas empêché par le président François Mitterrand, chef en titre des armées.
Au-delà de la folie meurtrière de cette attaque par sa conception même, véritable acte de guerre qui n’a pas eu d’équivalent contemporain dans aucun autre conflit sécuritaire français, j’ai à chaud, avec l’aide d’un confrère, Georges Marion, non seulement documenté des brutalités, des ratissages, des humiliations et jusqu’à des tortures à la matraque électrique contre les civils des tribus de Gossanah, mais aussi prouvé qu’au moins cinq militants indépendantistes furent tués après avoir été faits prisonniers.
Cette vérité, qui fut à l’époque regroupée dans un livre co-signé avec le journaliste politique en charge des outre-mers au Monde1, fut longtemps reléguée par la réalité que, paradoxalement, ces révélations ont contribué à faire advenir. Nos enquêtes, relayées et prolongées par la Ligue des droits de l’homme, aidèrent en effet Michel Rocard, le nouveau premier ministre, à imposer au pouvoir français une paix néo-calédonienne, avec l’accord des leaders kanak et caldoche. Sinon ces crimes commis par la France contre ses propres ressortissants auraient évidemment eu des suites judiciaires, tout comme ceux des indépendantistes lors de la prise de la gendarmerie de Fayaoué qui déclencha la prise d’otages.
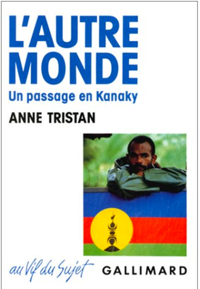
Ayant pour charge de donner à voir et à comprendre l’histoire immédiate, dont la matière première est un présent traversé par le passé, le journalisme ne saurait fonctionner à l’oubli. C’est la raison d’être de ce livre coordonné par Joseph Confavreux et nourri du travail collectif de Mediapart : rappeler, se souvenir, ne rien effacer, bref mettre en perspective, d’hier à demain, le deuxième référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui, issu des accords de Matignon (1988) puis de Nouméa (1998), a lieu en 2020.
Brutal rappel de la violence propre aux situations coloniales, l’événement tragique d’Ouvéa en 1988 – sur lequel ce livre apporte de nouvelles révélations – a produit une nouvelle donne politique, sociétale, économique et culturelle, qui interpelle la France depuis les antipodes. Au-delà de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, c’est celui de notre pays dans son rapport au monde et aux autres qui s’y joue. De sa libération de la question coloniale qui le ligote et l’entrave depuis si longtemps, le tirant en arrière, à rebours de la pluralité du monde, et l’entraînant dans des ornières, contre la diversité de son propre peuple.
La question coloniale recouvre la question française. La France est en effet, au XXIe siècle, la dernière puissance coloniale directe au monde, et cette anomalie, loin de la renforcer, est le chemin de son déclin. Non seulement c’est un passé qui gangrène le présent car non soldé ni affronté, tant les décolonisations françaises furent, de toutes les fins d’empires européens à l’exception du portugais, les plus tardives et les plus douloureuses. Mais, de plus, et c’est ce que nous rappelle l’enjeu calédonien, la France reste aujourd’hui la seule puissance coloniale directe au monde, plantant son drapeau tricolore sur tous les continents, de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie en passant par les Antilles, Mayotte et La Réunion.
Notre pays est ainsi la butte-témoin du colonialisme européen, avec 18 % de son territoire en outre-mer (pour 4 % de la population) et possédant, grâce à ces terres lointaines, le deuxième domaine maritime de la planète. Ce n’est pas seulement une anomalie historique au regard du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, reconnu par les traités et conventions internationales depuis la Deuxième Guerre mondiale, c’est aussi une exception qui contribue à rendre la France, à l’intérieur de son hexagone européen, aveugle à elle-même, refusant, par préjugé colonial, de reconnaître sa dimension multiculturelle, sa diversité d’origines, sa pluralité de cultures.
Tant que la France n’aura pas dénoué la question coloniale, elle restera à la merci des idéologies de l’inégalité (des races, des peuples, des cultures, des civilisations, etc.) que celle-ci a charrié, et par conséquent des perditions politiques qu’elle a enfanté (impérialisme, racisme, antisémitisme, etc.). L’ascension politique de l’extrême droite française depuis le tout début des années 1980 – précisément la décennie de l’acmé de la crise calédonienne – tout comme l’hégémonie idéologique progressivement conquise par ses refrains identitaires – corrompant l’espace public, politique et médiatique – s’enracine dans ce retard français, où un passé non liquidé n’en finit pas de nécroser le présent et de paralyser le futur.

Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre : l’énoncé qui a accompagné tous les combats des décolonisations vaut toujours. C’est en ce sens que l’avenir de la France se joue bien en Nouvelle-Calédonie. Soit elle persiste dans des logiques d’appropriation, de puissance et de domination, au risque d’être livrée de plus belle à des politiques autoritaires, identitaires et racistes. Soit elle saisit cette occasion pour se libérer elle-même de la question coloniale, en accompagnant l’indépendance en relation voulue par les indépendantistes de Kanaky, et dans ce cas elle ouvre la voie à une renaissance qui l’élève et la relève, échappant aux régressions démocratiques et sociales qui, aujourd’hui, la blessent et la rabaissent.
La France ne conjurera les menaces identitaires et autoritaires qui l’assaillent qu’à condition de regarder en face le passé colonial qui l’a façonnée et de se libérer du présent colonial qui persiste.

TRIBUNE
Edwy Plenel : « En évoquant une indépendance en relation pour la Nouvelle-Calédonie, nous défendons et promouvons
l’esprit de l’accord de Nouméa »
par Edwy Plenel, cofondateur et président de Mediapart. Source
A quelques jours du référendum du 4 octobre sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, le président de « Mediapart » répond, dans une tribune au « Monde », à un texte publié le 16 septembre par ce journal et qui mettait en cause un livre publié par sa rédaction.
Alors que le deuxième référendum d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui se tient dimanche 4 octobre, ne suscite guère de débats en France, Mediapart s’est soudain trouvé sous le feu critique d’une tribune venue de Nouméa, publiée dans Le Monde le 16 septembre. Ses quatre signataires y dénoncent « une pensée simplificatrice venue de métropole », « une grille de lecture datant des années 1980 » et « une posture anticoloniale (…) [qui] entretient par sa prétendue bienveillance un paternalisme tout à fait colonial ».
Refusant la notion même de décolonisation, ce texte est un mauvais coup porté au processus inédit engagé par les accords de Matignon de 1988, consécutifs à la tragédie d’Ouvéa survenue entre les deux tours de l’élection présidentielle de la même année, puis par l’accord de Nouméa de 1998, dont le préambule a, pour la première fois, officiellement reconnu le fait colonial de la République française. Un mauvais coup doublé d’une mauvaise manière.
L’héritage pris en otage
S’en prenant à la seule postface du livre que vient de publier notre rédaction sous la direction de Joseph Confavreux, Une décolonisation au présent (La Découverte, 242 pages, 18 euros), cette tribune ignore le travail collectif qui l’a nourri, fruit de plusieurs mois de reportages et d’enquêtes sur le terrain. Loin d’une vision simplificatrice, notre ouvrage souligne l’inédit politique qui s’invente patiemment aux antipodes, conviant la France à s’en inspirer pour vivre sans violence sa propre diversité et inventer une unité dans le respect de ses pluralités. Donnant à voir la mosaïque de son peuple, il veille à rendre compte de la réalité calédonienne dans toute sa complexité et avec toutes ses nuances.
A ce contresens manifeste s’ajoute une manœuvre inélégante. Tout en appelant à faire litière d’un passé colonial qui, pourtant, imprègne le présent du territoire, cette tribune à charge prend indûment en otage l’héritage de Jean-Marie Tjibaou, dont la hauteur de vue a permis ce processus pacifique d’autodétermination, au point de le payer de sa vie, en 1989. L’écho rencontré par ce texte qui nous caricature tient en effet à la présence, parmi ses quatre signataires, d’Emmanuel Tjibaou, l’un des fils du leader indépendantiste kanak, devenu une figure notable de la vie culturelle sur place.
Or ce dernier a tenu à nous faire savoir solennellement qu’il se désolidarisait de cette tribune « qui instrumentalise [son] nom en le portant caution d’un point de vue sur la question coloniale en Nouvelle-Calédonie qu’[il] ne [défendra] jamais ». « Je suis découragé d’avoir été si naïf et en colère contre moi-même », nous écrit-il. Relisant ce texte, il « [se rend] compte que chaque mot est une lame qui se dresse à la gorge des compagnons d’âmes de [son] père ».
De fait, niant « l’existence d’un système colonial institutionnalisé », assimilant toute demande de réparation à une « victimisation » des Kanaks, affirmant enfin que « la “France” d’aujourd’hui n’y est pour rien », cette tribune qu’Emmanuel Tjibaou désavoue a été immédiatement relayée par la droite locale, afin de justifier l’arrêt du processus de décolonisation par un appel à voter non au référendum du 4 octobre sur l’indépendance.
Première décolonisation sans violence
Sur le fond, il reste à comprendre, au-delà des maladresses et incohérences de cette tribune, pourquoi le positionnement informé et argumenté de Mediapart sur la Kanaky-Nouvelle-Calédonie dérange à ce point les tenants locaux d’un confusionnisme qui fait semblant de renvoyer dos à dos indépendantistes et loyalistes afin, en vérité, de maintenir le statu quo.
D’abord parce qu’en évoquant une indépendance en relation, dans la reconnaissance d’une histoire partagée, nous défendons et promouvons l’esprit même de l’accord de Nouméa de 1998. « La décolonisation, peut-on y lire, est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. »
Pour la France, l’enjeu calédonien est bel et bien de « réussir sa première décolonisation sans violence », comme le rappelaient en 2019 une centaine de personnalités dans un appel à ce que notre pays honore sa parole de 1998 : « L’Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période [longue de vingt ans], d’une complète émancipation ».
Une question toujours en souffrance
Ensuite parce que nous avons fait le choix d’interpeller la France hexagonale depuis le « caillou » océanien. Butte-témoin du colonialisme européen, avec 18 % de son territoire en outre-mer (pour 4 % de sa population), notre pays restera à la merci des idéologies de l’inégalité (des races, des peuples, des cultures, des civilisations, des religions) et des perditions politiques, racistes et impérialistes qu’elles ont enfantées, tant qu’il n’aura pas dénoué la question coloniale. Celle-ci est une question française toujours en souffrance, une blessure et une fracture qui attendent encore leur « discours du Vel d’Hiv » à l’instar des paroles décisives prononcées en 1995 par Jacques Chirac sur la participation de l’Etat français au génocide des juifs d’Europe.
On ne tourne pas une page sans l’avoir lue jusqu’au bout. On ne congédie pas un passé sans l’avoir regardé en face. On ne met pas fin à un legs d’injustice, de conquête et de violence, sans rompre clairement avec les passions tristes de domination et d’appropriation qui l’ont enfanté. « Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d’être le plus fort, l’orgueil de détenir la vérité, seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l’œuvre dans l’histoire des humanités. »
Ces lignes sont d’Edouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, en 2007, quand la France officielle céda de nouveau aux passions régressives d’une identité nationale dominatrice et intolérante qui, depuis, n’ont fait que gagner du terrain. En les contredisant, la réussite de la décolonisation calédonienne sera une invitation à les faire reculer ici même.
- Edwy Plenel et Alain Rollat, Mourir à Ouvéa. Le tournant calédonien, co-édition La Découverte-Le Monde, 1988.
- Un livre, injustement oublié, a rendu compte de l’intérieur de cette tragédie : la journaliste Anne Tristan, qui s’était fait connaître avec Au Front (Gallimard, 1987), vécut près d’une année à Gossanah après l’assaut de 1988, partageant la vie de la tribu à laquelle appartenait Djubelly Wéa. Elle rentra en France quelques jours avant le drame de 1989 où il perdit la vie après avoir pris celles de Tjibaou et Yeiwéné. Comme Au Front, il fut publié dans une collection que je dirigeais alors chez Gallimard. Cf. Anne Tristan, L’autre monde. Un passage en Kanaky, coll. « Au vif du sujet », Gallimard, 1990.