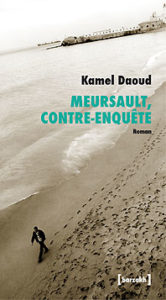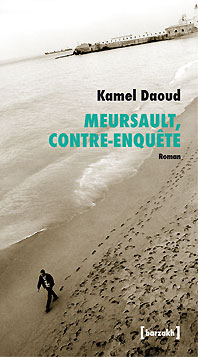
L’endroit de l’envers : Kamel Daoud et Albert Camus
Les écrits algériens sur Camus sont désormais si nombreux que nous avons éprouvé le besoin de les rassembler en une sorte de répertoire, publié ce mois-ci par Casbah éditions, Quand les Algériens lisent Camus1. Cet ouvrage permet de découvrir la richesse bibliographique sur le sujet.
Or, tout récemment, le roman de Kamel Daoud, Meursault. Contre-enquête, à Alger chez Barzakh, a retenu notre attention, une fois le « répertoire » terminé, à la fois par sa performance littéraire mais aussi par le fait qu’il appartient à la génération de la post-indépendance dont le rapport à l’œuvre de Camus est différent de celui des aînés.
Une ouverture incitative
Cette contre-enquête se déroule en 15 chapitres dont le premier chapitre développe les constantes de reprise et contre-proposition par rapport à Camus et d’évasion vers l’Algérie actuelle. On peut lire le roman sans connaître l’œuvre de Camus mais lorsqu’on la connaît l’effet de stéréophonie est savoureux et parfois même désopilant comme cette première phrase : « Aujourd’hui, M’ma est encore vivante. »
Le roman raconte ce qui n’a pas été dit : tout le monde parle d’un seul mort alors qu’il y en a deux ; ainsi le motif de la contre-enquête est dévoilé : « Je te le dis d’emblée : le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n’en reste rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. »
Un « je » parle à un « tu » dans un bar d’Oran… évidemment pas dans un bar d’Amsterdam ! Oran comme dans La Peste ! Ce vieillard ne laisse pas la parole à son interlocuteur et l’exhorte au silence et à la patience : les choses seront dites quand elles devront être dites. Très vite ce narrateur développe une thématique récurrente : s’il écrit et parle en français, c’est qu’il a appris cette langue qui n’est pas la sienne pour se mesurer, sinon rivaliser avec Camus, lire son livre et raconter, lui-même, l’histoire complète qui n’éliminerait pas « l’Arabe ». Dans ce monde « ciselé » que Camus a su créer, une seule ombre, « celle des « Arabes », objets flous et incongrus, venus « d’autrefois », comme des fantômes avec, pour toute langue, un son de flûte. » L’Arabe sur la plage s’appelait Moussa : « Qui sait si Moussa avait un revolver, une philosophie, une tuberculose, des idées ou une mère et une justice ? »
Moussa/Meursault-deux morts, un frère aîné/son petit frère, deux meurtres, l’un au soleil à 2h. de l’après-midi et l’autre sous la lune à 2h de la nuit…, le chiffre 2 est souverain et donne du sens en même temps qu’il montre le jeu auquel s’est livré Kamel Daoud : reprendre un texte si connu et si controversé sans en faire une tragédie mais comme un jeu où humour, ironie (de l’histoire…) et invention donnent une jubilation à celui qui jongle avec Camus et avec l’Algérie. Autour du « zoudj », Kamel Daoud, brode avec virtuosité. Au bout du … conte, on verra apparaître une équivalence, Meursault ou l’Arabe, c’est pareil, Meursault ou lui, le vieux narrateur, partagent la même identité de meurtrier impuni et d’homme indifférent au monde : « Un Arabe bref, techniquement fugace, qui a vécu deux heures et qui est mort soixante-dix ans sans interruption, même après son enterrement. » Et tout le monde a transformé un meurtre « en insolation ». Le frère qui parle s’appelle Haroun ; lui et Moussa sont Ouled el-assasse, fils du gardien. Or, dans « assasse », il y a aussi bien assassin qu’assassiné.
Ce roman est si intelligent et si bien construit, intégrant reprise, détournement et transgression de l’œuvre camusienne qu’on souhaiterait tout citer. Ne le pouvant pas, on conseille de le lire… Car, malgré sa proximité avec L’Etranger, Kamel Daoud parvient à écrire une œuvre autonome et originale, sans oublier son objectif qui apparaît comme unique dans le titre mais qui n’est pas le seul : une contre-enquête pour rétablir justice et droit que la première enquête a voilés.
Les quatorze chapitres suivants vont détailler la vie qu’a été celle du frère et de la mère après le meurtre, le quartier où ils vivaient puis leur déménagement à Hadjout où la mère vit toujours et, pour le vieillard qui parle, à Oran. Haroun a appris le français pour lire « un des livres les plus lus au monde », interprétant L’Etranger comme un récit des origines. Le chapitre 7 offre une magistrale transposition du fameux « Dimanche au balcon », déjà remis sur le métier par Camus dans Le Premier homme et qui devient ici « Le Vendredi au balcon ». Vient ensuite le récit de l’autre meurtre : au début de l’été 62, Haroun a tué un Français : ce n’est « pas un assassinat mais une restitution ». Le chapitre 15 est la clôture… « Fin de partie » comme dirait Beckett ! Le vieillard du bar est au bout de son histoire, il n’a pas été condamné et, comme Meursault dans sa cellule, il a rêvé que les autres assistent à sa pendaison avec des cris de haine et reconnaissent ainsi son existence.
Camus et sa lecture
Kamel Daoud sollicite plusieurs textes de Camus mais le dialogue massif se fait avec L’Etranger, avec une prédilection pour l’extension du récit : au-delà de ce que pouvait voir Camus, l’envers du décor qu’il ne voyait pas et le décor d’aujourd’hui qu’il ne pouvait connaître. Une fois la lecture terminée, il est patent que l’Arabe a été oublié sur la p(l)age et que la « colère » de ses semblables se justifie. Le reproche n’est pas fait à Camus de n’avoir pas procédé autrement : fils de l’Algérie coloniale – même si ces termes ne sont jamais utilisés – il ne pouvait concevoir les choses autrement. Dont acte. En cela il rejoint quelques interprétations universitaires qui, contrairement à ce qu’affirme Haroun, n’ont pas manqué de souligner la forte contextualisation algérienne du récit pour comprendre l’escamotage de la victime du meurtre. En 1960, Pierre Nora, approuvé par J. Derrida, interprétait, « L’Etranger comme un roman algérien dont la dernière scène – le coup de revolver de Meursault sur un Arabe anonyme – s’offre comme la réalisation fantasmatique d’un désir inconscient des Français d’Algérie. »
Beaucoup serait à dire sur les thématiques qui se déploient dans cette contre-enquête. Evoquons-en trois. La langue tout d’abord : de façon appuyée et récurrente reviennent des paragraphes insistant sur Camus, maître de langue française et sur le style comme transformation du réel et sur la duplicité de l’écriture dès lors qu’elle s’attaque à l’Histoire plutôt qu’à la géographie. La femme est très présente tant chez Camus que chez Daoud. Que ce soit par le biais de la Mauresque prostituée dont Raymond est le proxénète ou Zoubida qui serait l’amie de Moussa et non sa sœur. Que ce soit avec les femmes aimées : Marie et Meriem ; plus contemporain, Kamel Daoud n’a pas la vision conformiste méditerranéenne de la femme aimante et soumise qu’a Camus et sa Meriem est pleine de vie, insoumise et constructive. Les mères enfin, en apparence opposées mais qui, au fond se ressemblent, régnant sur la vie de leurs fils pesamment. L’identité enfin. Meursault. Contre-enquête est l’histoire d’une restitution de l’identité de base à laquelle a droit chaque être humain. De cette spoliation naissent des êtres timorés, lâches et velléitaires comme le narrateur du bar d’Oran. S’il y a toujours « un autre » dans l’Histoire comme il nous le dit à un moment du récit, il faut savoir qui il est ; pour que chacun évolue en toute autonomie, il ne faut pas le réduire à une identité grégaire : hier l’Arabe est devenu Arabe par le regard de Meursault et a perdu son identité, aujourd’hui, par l’imposition d’une même attitude religieuse, tous deviennent des Meursault. « Arabe, je ne me suis jamais senti arabe, tu sais. […] Dans le quartier, dans notre monde, on était musulman, on avait un prénom, un visage et des habitudes. Point. »
Il faut aussi, pour aller plus loin relire les « résumés » du récit camusien qui jalonnent le roman de Daoud et rétablissent l’endroit, la vie algérienne, de l’envers, la vie coloniale. Il faut se reporter aux pages 17-18, 69, 75, 88-89 : « Après l’Indépendance, plus je lisais les livres de ton héros et remontais sa carrière d’écrivain devenu célèbre, plus j’avais l’impression d’écraser mon visage sur la vitre d’une salle de fête où ni ma mère ni moi n’étions conviés. Tout s’est passé sans nous, même après la mort du meurtrier. Il n’y a pas de trace de notre deuil et de ce qu’il advint de nous par la suite. Rien de rien, l’ami ! Le monde entier assiste éternellement au même meurtre en plein soleil, personne n’a rien vu et personne ne nous a vus nous éloigner. Quand même ! Il y a de quoi se permettre un peu de colère, non ? Si seulement ton héros s’était contenté de s’en vanter sans aller jusqu’à en faire un livre ! Il y en avait des milliers comme lui, à cette époque, mais c’est son talent qui rendit son crime parfait. »
Mais Kamel Daoud ne s’en tient pas à la rectification du passé et c’est ce dépassement qui fait de son œuvre, une œuvre autonome et originale.
Car redonner un nom et une identité à son frère et, par extension, à un peuple, aux siens, c’est, en rétablissant une injustice de l’Histoire, tenter de mettre le doigt sur la course à la désillusion des années post-indépendance. Ce brouillage identitaire, à force d’être répété, transforme tous les Algériens en orphelins comme Haroun, comme Meursault, c’est-à-dire en acteurs passifs face à une réalité qu’ils ne parviennent pas à maîtriser. « J’ai vu récemment un groupe de Français devant un bureau de tabac à l’aéroport. Tels des spectres discrets et muets, ils nous regardaient, nous les Arabes, en silence, » ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts ». »
Il semblerait alors qu’en écrivant Meursault. Contre-enquête, Kamel Daoud a voulu rétablir une analyse historique, sans reproche ni nostalgie. Certaines de ses chroniques « Raïna Raïkoum » ont déjà abordé ce devenir des relations algéro-françaises qui, selon lui, ne pourront repartir sur des bases saines que si on règle le passé pour solde de tout compte. Si on poursuit dans l’occultation et le meurtre, réel ou symbolique, on devient tous des Meursault, « l’Autre est une mesure que l’on perd quand on tue. »
C’est ainsi que je lis toutes les passages sur l’Algérie d’aujourd’hui, par réalisme bien sûr puisqu’Haroun y vit, mais surtout par désir de clore le débat. Son désir d’écrire cette œuvre a-t-il été réactivé par la fameuse polémique autour de « la caravane Albert Camus » ou par le passage aux propos inconvenants de Michel Onfray à Alger ? Peut-être. Néanmoins, ce solde de tout compte a largement précédé cette actualité et même le « centenaire » de Camus, comme on peut le lire dans une de ses chroniques du Quotidien d’Oran, du 27 avril 2006, « L’ « Etranger » de Camus n’est plus le pied-noir ». Il y a dans ce roman et de façon plus générale dans ses chroniques, affirmation d’un avenir possible moins déceptif si la mémoire pervertie n’occulte pas ses potentialités ; un avenir sans Meursault, sans Caïn et Abel et en redonnant à l’absurde, son sens usuel et non celui d’une philosophie existentielle.
Dans un Café littéraire récent à Béjaïa, Kamel Daoud a affirmé : « J’ai démantelé l’œuvre de Camus, mais avec amusement. » Il faut croire que l’amusement n’est pas incompatible avec un travail en profondeur et en connaissance de cause de l’œuvre du « démantelé »… Que cette proposition emporte ou non notre conviction n’empêche pas la lecture d’un des romans algériens « camusiens » les plus réussis.