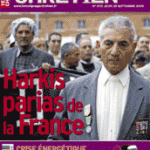Longtemps, elle a enfoui son histoire. Par honte ou tout simplement pour tourner la page. Longtemps, elle a essayé discrètement de se défaire des étiquettes infamantes accolées aux siens : « harkis », « traîtres », etc. En 2000, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a tout brisé. En visite officielle en France, il déclare : « Les conditions ne sont pas encore venues pour des visites [en Algérie] de harkis. […] C’est exactement comme si on demandait à un Français de la Résistance de toucher la main d’un collabo. » « Collabo », Fatima Besnaci-Lancou, la fille de harki, est atteinte au cœur par « l’insulte de Bouteflika et par le manque de réaction des autorités françaises ». Il a en effet fallu un mois, se souvient-elle, pour que Jacques Chirac, répondant à une question de Patrick Poivre d’Arvor le 14 juillet, réagisse à cette attaque contre des compatriotes.
Compatriote… le mot est-il bien trouvé pour parler des harkis ? Est-on français de plein droit quand on a été supplétif de l’armée française pendant la guerre d’Algérie et abandonné à la fin de celle-ci au prix de milliers de morts, quand pendant des décennies, on se retrouve parqué en métropole dans des camps militaires et quand, cerise sur le gâteau, le Président de tous les Français attend des semaines avant de réagir à une attaque d’un chef de l’État étranger ? Que se serait-il passé si la pique de Bouteflika avait visé d’autres compatriotes, bretons, corses ou corréziens ? Plutôt que de mariner à l’infini son amertume, Fatima a décidé de sortir de son silence. En écrivant son histoire et celle des siens. Cela donne un récit captivant, précis, émouvant de la première à la dernière page. Qui, après une première édition – épuisée – en 2003, ressort ces jours-ci.
Avant d’être une histoire française, la tragédie des harkis trouve ses racines dans la terre algérienne. La famille Besnaci, d’origine berbère, vit dans un village proche de Cherchell, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Alger. Le grand-père de Fatima, ancien poilu de 14-18, notable de village, voulait que ses petites-filles soient instruites. Toute petite, elle connaît le plaisir d’apprendre le français aux côtés de camarades pieds-noirs, mais éprouve déjà la ségrégation. « Tous les matins, écrit-elle, nous étions obligés de baisser notre culotte pour que la maîtresse vérifie notre hygiène. Mes camarades françaises étaient dispensés de cette séance humiliante. »
Pour cette fille de la guerre (elle est née en 1954), l’enfance rime avec violence. Les morts se succèdent – imputables à l’un ou l’autre des belligérants – pendant et surtout après la guerre. La population favorable à l’indépendance, et surtout les combattants de la dernière heure (« les marsiens » parce qu’ils s’étaient engagés en mars 1962), s’en donnent à cœur joie contre ceux qui étaient – ou supposés être – du « mauvais côté » : menaces, enlèvements, tortures, assassinats. La famille de Fatima est justement de ce côté-là.
Comment devenait-on harki ? Là encore, bien des idées reçues hérissent Fatima. Comme celle qui voudrait que la majorité d’entre eux aient choisi, par amour de la France, de rejoindre les harka, ces armées supplétives. En fait, la plupart des supplétifs endossaient l’uniforme français par peur de représailles de l’armée de libération, après en avoir souvent été membres. C’est que dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), les règlements de compte, pour des raisons politiques mais aussi personnelles et familiales, sont légion. L’histoire de la famille de Fatima raconte ce déchirement : la maison en montagne sert de base arrière des soldats de l’ALN, laquelle compte deux membres de la famille ; ceux-ci se sauvent du maquis, accusés de collusion avec l’ennemi, et pour se protéger rejoignent l’armée française… S’ensuivent, après mars 1962, des semaines périlleuses où la famille est menacée par les « marsiens » et où elle échappe par miracle à la mort pour finalement être évacuée vers la métropole en novembre 1962.
« Ma première adresse en France, c’était derrière des barbelés ». Fatima ne peut oublier les conditions d’accueil des harkis. Le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées Orientales, était le passage obligé pour tous ceux qui fuyaient l’Algérie. Enfin pas tous : « aucun pied-noir n’est passé par les camps, heureusement pour eux ». Fatima ne cache pas son agacement devant l’hypocrisie de certaines associations de rapatriés qui parlent de « nos amis, les harkis ». « Personne n’est venu nous voir dans les camps », souligne-t-elle calmement.
Parler de la vie dans ces camps, c’est se replonger dans l’une des plaies les plus béantes de la France de l’après-décolonisation C’est s’obliger à une impudeur permanente. Dans son livre, Fatima Besnaci-Lancou raconte la vie dans ce camp qui antérieurement fut peuplé d’Espagnols fuyant le franquisme puis de juifs et de tsiganes persécutés par Vichy. « Dès les premiers jours en France, écrit-elle, j’attrapai des engelures aux orteils qui allaient durer pendant des années. Les conditions de vie dans ce camp étaient épouvantables, car rien n’était été prévu, ni sanitaires, ni eau. Parfois, le vent violent emportait les tentes mal amarrées et les familles se débattaient comme elles pouvaient pour replanter les piquets et protéger leurs enfants. »
Le couple Besnaci avait à l’époque cinq filles et il en aura trois autres – deux garçons et une fille – au cours de son long périple dans les camps de la République. Après une année à Rivesaltes, les Besnaci rejoignent Vic-le-Comte dans le Puy-de-Dôme où un ancien officier français proposait un logement aux harkis. Dans ce village, les enfants étaient scolarisés avec les autres Français. Des amitiés naissaient et, pour la première fois, Fatima côtoyaient d’autres personnes que des harkis ou des militaires. La parenthèse, presque enchantée, ne dure que deux années. Suite à la maladie du père, toute la famille part dans le Bourbonnais dans le camp de Bourg-Lastic. « C’était un retour traumatisant », se souvient Fatima qui n’avait pas osé dire à ses camarades de Vic où elle partait. « Comment expliquer les camps à quelqu’un qui n’est jamais sorti de la chaleur d’un foyer et ne connaît pas l’exil. »
Après le centre, retour dans le sud, cette fois-ci pour longtemps. Entre Grasse et Cannes, le hameau forestier de Mouans-Sartoux qui accueillait, dans des anciens pré-fabriqués militaires, une trentaine de familles, était situé entre un dépotoir et les égouts. Loin des regards, toujours, comme si la France cherchait à faire de ces otages de l’histoire coloniale des invisibles. Fatima a vécu en tout pendant quatorze années dans des camps militaires, isolés de tous. Par chance, Fatima et ses frères et sœurs vont croiser quelques bénévoles. Parmi elles, Lucie Mantoux, habitant Cannes. « Mariée à un grand médecin, j’étais vouée au bénévolat. Le pasteur et le curé avaient demandé à moi et quelques amies d’intervenir à Mouans-Sartoux pour alphabétiser les femmes. Là, j’ai repéré très vite la maman de Fatima, belle et douce. » La famille Mantoux se lie d’amitié avec les Besnaci, allant jusqu’à héberger quelques mois Fatima lors de son bac. Une vingtaine d’années plus tard, Lucie parle, non sans fierté, de Fatima qui a mené « une belle carrière » à Paris (elle dirige des éditions médicales). Elle se rappelle du jour où sa « protégée » est partie frapper à la porte d’une grande société dans la capitale. « Elle portait ses affaires dans un sac plastique quand d’autres avaient un attachés-case. Elle a tout de même été retenue. » Fatima écrit dans son livre : « Lucie m’avait apprivoisée : avec elle, je n’étais un oiseau qu’à demi sauvage. Ma sœur Yasmina, personne ne l’a jamais apprivoisée. »
Vingt ans ont passé. Les camps – à l’exception de celui de Fuveau (Bouches-du Rhône) -ont tous fermé. Ici ou là, des municipalités, comme celle de Mouans-Sartoux dirigée par André Aschieri, ont construit des pavillons pour les reloger. Ailleurs, on les a « parqués » dans des cités peu reluisantes. La société française a commencé, timidement, à soulever ce pan d’histoire très sombre. Le livre de Fatima 1 a, depuis deux ans, permis d’ouvrir les bouches. « J’ai reçu un gros volume de courrier, des enfants de harkis dont certains ont fait des lectures pour leurs parents illettrés, mais aussi des « Gaulois » qui m’ont écrit avoir découvert notre histoire. » Fatima a également répondu à des dizaines de demandes d’interventions, notamment dans des écoles. « Les lycéens me posent souvent les questions : est-ce que vous en voulez à votre père ? auriez-vous pu être harki ? » Sur cette seconde interrogation, elle n’a pas de réponse. Dans le droit fil de son engagement, Fatima a créé en 2004 l’association « Harkis et droits de l’homme » qui se bat pour la reconnaissance – au niveau du droit et de la mémoire – du drame harki. Même si elle se félicite de l’instauration en 2001 d’une journée nationale (le 25 septembre), certaines images lui restent au travers de la gorge : « Je ne veux plus voir ces vieux harkis défiler avec deux rangées de médailles sur la veste. » Elle attend toujours des mots forts de l’État : « Jacques Chirac a dit un jour : « En quittant l’Algérie, la France n’a pas su protéger ses enfants. » Il aurait dû dire « n’a pas voulu » ». En écoutant Fatima, on sent que l’étiquette « enfant de harki » est toujours difficile à porter. Peu importe, d’une certaine manière, si elle s’en est bien sortie. D’autres, tellement nombreux, sont restés en marge, enfermés dans des cités, dans le chômage et la délinquance, dans des discriminations que connaissent tous les Français d’origine maghrébine, sans compter les maladies mentales 2. « Depuis 2000 [lors de la déclaration de Bouteflika], je me considère comme apatride alors qu’avant, je me sentais française. Je ne sais pas à qui j’appartiens », confie celle qui passe week-ends et vacances à récolter la mémoire harkie et à batailler pour une reconnaissance des deux côtés de la Méditerranée. Pour elle, la France continue à instrumentaliser le drame des harkis, sans jamais reconnaître ses responsabilités. La loi du 23 février dernier dont un article reconnaît « le rôle positif de la colonisation française », ne la fait pas décolérer d’autant que cette loi fourre-tout traite aussi de l’indemnisation des harkis. « Pour nous, la colonisation continue. » Fatima Besnaci-Lancou craint d’être toujours cantonné dans une position de victime, elle qui n’oublie jamais les larmes de ce vieil harki disant « On nous a toujours menti ». « Avec des mains tendues, on pourrait y arriver, glisse-t-elle. J’y crois. »
Quelle réconciliation ?
Le 29 septembre, les Algériens sont appelés par référendum à approuver la « charte pour la paix et la réconciliation nationale », proposée par le président de la République. Celle-ci prévoit une large amnistie des crimes perpétrés par les islamistes, y compris pour les meurtres individuels. Cette très grande largesse est combattue par certains partis « laïcs » et les associations de droits de l’homme, notamment des familles de disparus qui craignent que la justice ne leur soit jamais rendue. Ce scrutin intervient quelques jours après la déclaration d’Abdelaziz Bouteflika, reconnaissant que des « erreurs ont été commises par le passé, particulièrement durant la période post-indépendance, à l’encontre des enfants et des familles des harkis ». Interrogée le 15 septembre par le quotidien El-Watan, Fatima Besnaci-Lancou a demandé au Président algérien l’ouverture des archives aux historiens pour qu’on « sorte de la passion et gestes idéologiques, qu’on replace les harkis dans le contexte global de colonisation et dans un contexte de guerre. »
Les harkis et la gauche
« Que compte faire le conseil municipal pour nous débarrasser des harkis ? » Ce titre n’est pas celui d’une feuille d’extrême droite, mais d’un journal communiste (Le travailleur catalan) en octobre 1962. Cette anecdote, parmi d’autres, témoigne de la grande méfiance – pour ne pas dire plus – entretenue par la gauche envers les harkis. Il était sans doute difficile pour elle de comprendre ceux qui n’avaient pas fait le choix de l’indépendance. De plus, les fréquentations d’une petite frange de harkis avec l’extrême droite suscitaient la méfiance. Dans les entreprises, la CGT s’est longtemps opposée à l’embauche d’anciens harkis. Cette grande méfiance s’estompe peu à peu. Fatima Besnaci-Lancou a été invitée à discuter avec le communiste Henri Alleg lors de la dernière fête de l’Humanité. Les associations de droits de l’homme se sont associées à la manifestation organisée à Paris en janvier 2004 par Harkis et droits de l’homme. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, signe la postface de la seconde édition de Fille de harki et y écrit : « Ceux que l’on nomme les harkis furent privés de leur part d’humanité ».
Dans l’intimité d’un drame
Disons-le tout net : on ne sort pas indemne de la lecture de ce récit. En une centaine de page, Fatima Besnaci-Lancou raconte le destin d’une famille broyée par une guerre qui opposa combattants de l’indépendance et soldats français, mais aussi Algériens entre eux. Toutes les étapes de cet exil sont décrits avec beaucoup de précision et toujours de la retenue. Le livre mêle la grande et la petite histoire : après avoir raconté comment un membre de la famille a échappé à ses poursuivants en Algérie, l’auteur glisse une anecdote sur la boulangère de Vic-le-Comte qui lui donnait en douce quelques friandises… Dans les dernières pages, Fatima raconte le traumatisme de son fils Rémi, « viscéralement attaché à l’Algérie » qui, tentant de se lier d’amitié avec un camarade d’origine algérienne, avait entendu celui-ci dire des harkis qu’ils étaient des « traîtres ».
- Tout comme d’autres livres, comme celui Dalila Kerchouche, qui née dans un camp dans les années 1970, est reparti sur la trace de sa famille (Mon père, ce harki, Seuil).
- L’hôpital psychiatrique d‘Agen a longtemps eu un étage réservé aux harkis, en raison de sa proximité avec le camp de Bias qui accueillait les « irrécupérables et inclassables » (terme officiel).