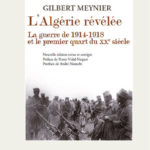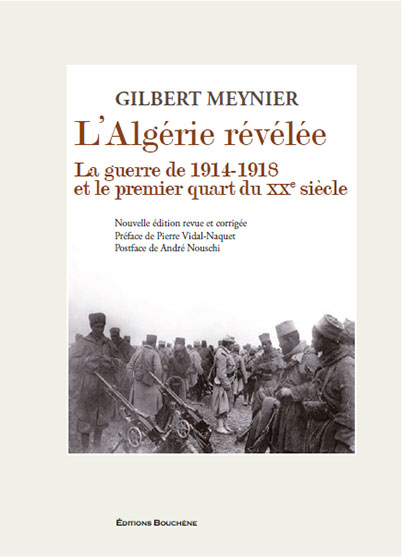
Résumé et problématique du livre :
Les Algériens et la 1ère guerre mondiale
Loyalisme pro-français ou prodromes nationalistes ?
La 1ère guerre mondiale fit découvrir la France à près de 250 000 Algériens – 120 000 soldats et 120 000 ouvriers. S’ils y souffrirent d’un climat rude, la reconnaissance envers les tirailleurs fut réelle. Après des débuts sanglants au front, le commandement français manœuvra intelligemment. L’ordre militaire fut plus égalitaire que l’ordre colonial, les tirailleurs furent des « loyalistes » appréciés.
Mais, aux tranchées et dans les usines, la nostalgie de la patrie et l’attachement à l’islam firent naître une conscience identitaire, prémisse d’une revendication politique anticoloniale qui, devant les blocages coloniaux, fit poindre le nationalisme. Les travailleurs algériens découvrirent la vie ouvrière, la revendication, la grève. Tirailleurs et ouvriers connurent des Français(e)s.
Après la guerre, de facto, rien ne changea. L’émir Khaled, saint cyrien, capitaine « indigène », et populaire petit-fils d’Abd el-Kader, fit campagne pour l’égalité citoyenne avec les Français. Bien qu’il ne revendiquât pas l’indépendance, il remettait en cause le système colonial – il fut exilé au Shâm en 1923. En mars 1926, sous les auspices du PCF, fut fondée l’Étoile Nord-Africaine – dont Messali Hadj fut élu secrétaire général et qui revendiqua peu après l’indépendance de l’Algérie.
Un grand livre d’histoire, incontestablement, que celui de Gilbert Meynier. Si le mot dialectique a un sens, ce dont, à voir l’usage qui en est fait, je
ne suis pas toujours persuadé, c’est un livre profondément dialectique. Un livre, d’abord, qui sait jouer sur l’immobile et sur le changeant. « Le
colonialisme, disait Jean-Paul Sartre, est un système ». Et certes, le système est en place avant comme après la Première Guerre mondiale.
Avant comme après, il y a deux sociétés superposées, le droit des uns qui exclut le droit des autres. Avant comme après, la représentation « algérienne » au parlement français est exclusivement européenne. Économiquement, la dépendance reste la même. C’est à peine si l’on peut parler, par la suite des difficultés des communications avec la métropole, d’un début d’industrialisation. Devant la misère, la maladie, la mort, les deux sociétés restent, avant comme après, fondamentalement inégales, et ceci bien qu’il s’agisse – et c’est bien le drame – de deux sociétés complètes. Comme le dit fort bien Gilbert Meynier, après la guerre, « dans les grandes lignes, pour le pouvoir colonial, rien n’a changé. En fait, tout a changé ».
Bonne feuille 2
L’Algérie, support du nationalisme français
L’Algérie fait partie de l’arsenal mythologique français. La manière dont elle est perçue et, plus généralement, dont est perçu le fait colonial et impérial est caractéristique des prévalences idéologiques de la société française. À la veille de la guerre l’ensemble des Français ont une vue simpliste de l’Empire. L’outillage conceptuel est limité et flou, jusque chez les socialistes. L’historien François Bédarida a noté que colonialisme et impérialisme sont, au début du XXe siècle, des néologismes récents 3. Rares sont ceux qui, comme Paul Louis 4 se risquent à théoriser, avec un inégal bonheur. Impérialisme est usité mais son sens est restrictif : traduit de l’anglais, et malgré le livre de Hobson s²ur l’impérialisme qui donne au terme son sens actuel 5, on l’emploie encore surtout pour désigner, ainsi que le représente François Bédarida
« la doctrine qui vise à réunir toutes les communautés de souche ou de tutelle britannique éparses sur le globe en un bloc économique ».
Cela sauf chez une minorité de socialistes qui l’emploient dans le même sens que le militant et député S.P.D. au Reichstag Georg Ledebour, léniniste avant la lettre. Les non socialistes usent, pareillement, de concepts flous : « émancipation des indigènes », « tyrannie administrative et féodale »… Aucun ne formule des concepts généraux. Cela est compréhensible pour la gauche, le centre ou la droite libérale. Ce devrait l’être moins pour une famille politique partiellement inspirée du marxisme. Ce manque de précision se relie vraisemblablement à l’archaïsme structurel de l’impérialisme colonial français si on le compare à ses rivaux britannique et allemand. À des fondements infrastructurels qui ont – relativement – peu évolué correspond l’archaïsme des concepts. On traite donc de l’impérialisme colonial avec le matériel mental de l’idéologie jacobine, quels que soient, par ailleurs, les habillages qui la recouvrent. Le mouvement ouvrier français est, sur le problème colonial, à la traîne des autres Européens. Les clivages existant ne sont bien souvent que les reflets de prises de position, émises par des ténors de la IIe Internationale dans ce domaine – Hyndman, Van Kohl, Ledebour –, dont aucun n’est français. La faible connaissance et la compréhension incomplète du phénomène colonial vont de pair avec la pénétration du jacobinisme assimilateur dans la masse française. L’école est le canal principal de cette pénétration.
À la base de cette introjection idéologique, il y a le sentiment de la supériorité française. De la meilleure foi du monde, les instituteurs disent à leurs élèves que la meilleure grâce que l’on puisse faire aux Algériens, c’est de leur apprendre le français. C’est bien ce qu’entend Lavisse : illustré par une gravure représentant une salle de classe algérienne divisée en deux groupes – égaux – d’élèves (à gauche, rien que des Français, à droite rien que des Algériens), un texte du manuel du cours élémentaire (édition 1913) apprend aux enfants français que
« les Arabes sont de bons petits écoliers. Ils apprennent aussi bien que les petits Français. Ils font d’aussi bons devoirs. La France veut que les petits Arabes soient aussi instruits que les petits Français. Cela prouve que notre France est bonne et généreuse pour les peuples qu’elle a soumis ».
Le manuel de Lavisse ne dit pas en quelle langue sont faites les leçons. Cela va de soi : ce ne peut être que le français, puisque, apprend Henri Hauser aux élèves de troisième (édition de 1912), « la langue française est la langue auxiliaire de tous les peuples civilisés ». À plus forte raison, doit-on l’apprendre aux autres. Dénigrer plus ou moins le colonisé fait partie de l’argumentation ordinaire. On persuade les élèves que l’Algérie, en 1830, n’offrait à la colonisation que « quelques îlots de terres colonisables » au milieu de « vastes espaces presque désertiques ou trop escarpés, détériorés eux-mêmes et défertilisés par le long séjour d’un peuple inactif » (Hauser) ; bien que, par ailleurs, on puisse présenter une Algérie capable d’exporter des céréales à la fin du XVIIIe siècle. Les jeunes Français ignorent profondément qui sont ces Arabes soumis. Les lecteurs d’Hauser ont la chance d’apprendre que les Algériens n’étaient pas « des populations sauvages comme les indigènes australiens mais des races qui avaient un long passé historique, une civilisation originale ». L’ouvrage reconnaît honnêtement que « en Algérie, l’installation de ces colons européens présenta des difficultés sérieuses par la seule présence de la population indigène ». Il n’en justifie pas moins la conquête et la colonisation par la mission de la France. La conquête du pays est présentée de manière factuelle comme un haut fait d’armes, d’autant plus valeureux que l’émir Abd El Kader est présenté comme un guerrier « éloquent et brave », nulle part comme le despote éclairé qu’il voulut et put être. D’ailleurs, si la conquête fut entreprise, ce fut uniquement parce que notre consul à Alger
« fit des observations au dey à propos de mauvais traitements que des Français avaient souffert. Le dey se fâcha et le frappa avec son chasse-mouche qu’il tenait à la main. Pour le punir. » (Lavisse, Cours moyen, édition 1912).
Non seulement le Lavisse ne parle pas des transactions Bacri-Busnach mais encore il présente une affaire d’honneur où la France ne peut que venger un affront qui lui fut fait. Près de vingt cinq ans plus tard, le manuel de l’enseignement supérieur de la collection Peuples et Civilisation (le « Halphen et Sagnac ») ne présente pas autrement les faits et n’en dit guère plus : dans son volume xix 6, après avoir évoqué le « fléau » de la piraterie, sans indiquer que la course a beaucoup décliné au XVIIIe siècle et qu’elle ne touche pas les navires français, l’auteur parle brièvement de l’affaire Bacri-Busnach en se gardant de présenter les Français comme de mauvais payeurs. La chute est la même :
« Le dey se fâcha et, dans la discussion avec le consul de France, le frappa d’un coup d’éventail (1827). Il fallait punir cet affront. »
Au cours moyen, le Lavisse consacre trois pages à la conquête de l’Algérie, dont une entière à Sidi Brahim, avec illustration : 80 chasseurs à pied succombant sous le feu de « milliers d’ennemis ». Et « dans les villes et les villages de France, on racontait les combats d’Afrique. On était fier du courage de nos soldats car on se souvenait toujours des guerres de la Révolution et de l’Empire ». Pour les petits du cours élémentaire, il y a mieux que Sidi Brahim : la conquête de l’Algérie ne leur est connue que par le seul combat de Mazagran qui oppose 123 Français à 12 000 Arabes « très braves ». Et, qui l’eût cru, les 123 Français sont victorieux dépassant dans la mythologie française d’autres figures de proue : Roland, Jean le Bon, Jeanne d’Arc et sa petite sœur en mythe, Jeanne Hachette. Les combats d’Algérie sont présentés et sentis exactement de la même manière dont le sont tous les combats qui forgèrent la nation française. Une fois montrée la supériorité indiscutable de la civilisation française, il est nécessaire de montrer que les Français en doivent faire bénéficier les autres peuples : si « la diffusion de notre langue aide puissamment à la diffusion de nos produits ». Pour Hauser,
« Il est d’abord du devoir de tous les Français de contribuer, dans la mesure de leurs forces, à la propagation de leur langue par laquelle se répandent par le monde les idées généreuses qui font aimer la France et qui accroissent son autorité morale ».
Sont présentées aux jeunes Français des idées reçues comme évidentes, qui confirment les images véhiculées par la grande presse, les magazines illustrés et, déjà, le cinéma ; la mission de la France est éminemment civilisatrice :
« l’Afrique du Nord, à laquelle Carthage et Rome avaient assuré une réelle prospérité, mais qu’ensuite la conquête musulmane avait séparée politiquement et économiquement de l’Europe, a retrouvé, sous la direction de la France, sa place dans le monde civilisé ». Bien sûr,
« la France fait avec ses colonies un commerce de 1 200 millions de francs et ce chiffre est la plus éclatante justification de nos efforts coloniaux ».
Mais, enseigne le Lavisse du Cours moyen, « un noble pays comme la France ne pense pas qu’à gagner de l’argent ». Le Lavisse du Cours élémentaire glorifie l’œuvre coloniale de la République, célèbre Jules Ferry et montre que « partout la France enseigne le travail. Elle crée des écoles, des routes, des chemins de fer, des lignes télégraphiques ». De même, pour le manuel,
« La France a apporté la paix, si souvent troublés jadis, elle leur a fait connaître des procédés de culture moins rudimentaires ; elle les protège contre la famine qui les menaçait périodiquement autrefois ; elle améliore leur hygiène et diminue leur mortalité ».
Apparemment, l’auteur ignore, on ne dit pas, que famine et typhus ont fait rage dans l’hiver 1908-1909, peu avant la publication du manuel. On suggère que les Algériens ne sont pas toujours très dignes des bienfaits prodigués. Il est vrai que, pour Hauser,
« le fanatisme religieux est le seul obstacle qui s’oppose à la complète mise en valeur de tout le Maghreb. Il rend impossible la fusion des populations indigènes et européennes ».
L’auteur présente à ses lecteurs une praxis coloniale mutante, assimilatrice au point de départ et que le poids des faits – la résistance algérienne présentée et ressentie comme un pur fanatisme religieux entravant une œuvre scientifique objective – transforme en associationniste : il indique d’ailleurs clairement que l’association est la seule politique possible en Algérie.
Dans les manuels, tout suggère que les colonies sont une nouvelle France. L’imagerie de Lavisse est orientée vers la glorification du drapeau français s’imposant aux peuples soumis. Dans le manuel du cours élémentaire, en frontispice du chapitre colonial, une gravure inscrite dans un arc outrepassé représente un salut aux couleurs devant les cases d’un village africain ; des officiers habillés de blanc et casqués saluent le drapeau qu’un autre hisse. De part et d’autre de la gravure, à gauche un Arabe à fines moustaches, en burnous et chèche, le corps à demi penché, a un air affreusement sournois ; à droite, un Africain noir, à l’air bonasse,un peu bête et disponible. On imagine leur régénération à l’ombre du drapeau. Hauser a choisi plus subtilement, pour illustrer son chapitre d’introduction sur les colonies une photo de village kabyle, typiquement méditerranéen, qui a un petit air de Provence. D’autres photos représentent des villages du Sud très différents, ceux-ci comme celui-là offrant des exemples variés d’une France capable de digérer tous les peuples en une « plus grande France ». Les représentations de la puissance française sont intimement mêlées à celle de l’Empire. Le Lavisse du Cours moyen apprend que :
« La France moderne ne pouvait se passer de colonies. Notre Empire colonial vient au troisième rang dans le monde pour l’étendue et au deuxième rang pour la population. La valeur de nos colonies est considérable. La plus grande France s’étend sur toutes les parties du monde. »
De cet ensemble, l’Afrique du Nord, et d’abord l’Algérie, sont présentées comme le fleuron et affectées d’une charge émotionnelle particulière. Hauser exprime un éblouissement national : « Nous possédons un empire au Nord de l’Afrique. Cet empire est plus vaste que la France. Il est situé près d’elle. » Il exalte l’œuvre française au Maghreb et prépare ses lecteurs à la conquête du Maroc : « L’œuvre admirable accomplie par la France en Algérie-Tunisie doit avoir son complément au Maroc. »
De même, le socialiste marseillais Gustave Rouanet parle de la Méditerranée comme d’un « lac français » et voit dans le Maroc « notre sphère d’influence naturelle » 7. Les manuels scolaires ont donc enseigné aux jeunes Français une image exaltante de leur empire colonial : les conquêtes, entreprises chez des gens peu civilisés, ont été l’occasion de réaffirmer la valeur militaire française et elles aboutissent à répandre l’amour du nom français dans une « Plus grande France ». L’empire colonial – et l’Algérie en est la pièce maîtresse – sert donc à alimenter la solidarité française. Les manuels le présentent comme une œuvre de tous les Français, communauté en expansion. Les grands coloniaux – Bugeaud, Ferry, Brazza – agissent collectivement au nom des Français. L’œuvre française en Algérie – le modèle –, mise sur le compte du génie français, fortifie l’unanimité nationale. L’usage est continuel du possessif à la première personne du pluriel :
« De grands efforts ont été déjà faits pour mettre en commun notre Afrique Occidentale avec notre Afrique du Nord. Ces efforts aboutiront certainement un jour. Notre empire africain sera tout d’une pièce » (Lavisse, Cours moyen).
Principe d’unité nationale, l’empire contribue à la collaboration de classes. Comme le dit excellemment F. Bédarida,
« Á la base de cet état d’esprit spontanément impérialiste, il y a le conditionnement du monde ouvrier par le modèle culturel de la bourgeoisie républicaine : un modèle à la fois nationaliste et colonialiste ».
Dans l’avant-guerre, le nationalisme français se nourrit donc de plus en plus des mythes de l’Empire.
- Extrait de la préface.
L’intégralité de la préface : http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/meynier_algerie_revelee_debut.pdf. - Extrait de L’Algérie révélée pages 104 – 109.
Avec l’autorisation de l’auteur. - François Bédarida, « Perspectives sur le mouvement ouvrier et l’impérialisme en France », Le Mouvement social, 1974, n° 86, p. 25-41.
- Paul Louis, Le colonialisme, Paris, G. Bellais, 1905, 110 p.
- John Atkinson Hobson, Imperialism, a Study, London, J. Nisbet, 1902, VUU-400 p. (plusieurs éd. postérieures).
- Maurice Baumont, L’essor industriel et l’impérialisme colonial (1878-1904), Paris, PUF, 1937.
- Cf. Antoine Olivesi, « Les socialistes marseillais et le problème colonial », Le mouvement social, n° 46, janv.-mars 1964, p. 27-65.