Il y a 40 ans, la guerre d’Algérie s’achevait, laissant, des deux côtés de la Méditerranée, des blessure profondes. De nombreux acteurs ou victimes de cette guerre s’enfonçaient dans le silence pour tenter d’oublier. 40 ans après, faute d’avoir pu dire toute la vérité, toute la complexité de cette guerre, les souffrances sont toujours là, enkystées.
Il faut entendre la mémoire de ceux qui ont été doublement victimes, les harkis, souvent pris entre deux loyautés, ou jetés par les circonstances dans le camp de la France. La vérité impose de sortir des visions simplificatrices ou manipulatrices de l’histoire. Certes, si l’on était algérien en 1955 en Algérie, il peut sembler, avec le recul du temps, qu’il était logique de se battre pour l’indépendance. Mais qui peut oser dire qu’en temps de guerre les choix se posent aussi clairement pour tous, que le choix même dans certains cas, ait existé ? En lisant le témoignage de Fatima Besnaci-Lancou, on comprend comment des hommes, pris entre deux loyautés, ont pu être amenés à se ranger dans le camp de la France, entraînant du même coup, femmes et enfants dans l’exil.
Fatima Besnaci-Lancou a écrit pour que ses enfants aient le droit d’être fiers de leurs racines, et qu’enfin des paroles officielles, des deux côtés de la Méditerranée, reconnaissent les responsabilités partagées du malheur des harkis.
Fille de harki, avec une préface de Jean Daniel et Jean Lacouture, éd. de l’Atelier, seconde édition septembre 2005, 13 €.
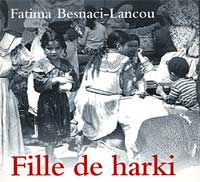
Présentation de l’ouvrage par Gilles Manceron
Fatima Besnaci est née aux environs de Cherchell au début de l’insurrection armée du FLN algérien. Elle avait huit ans lorsque, pendant l’été 1962, plusieurs membres de sa famille ont été victimes des massacres visant ceux à qui on reprochait d’avoir été durant la guerre du côté des Français. Et c’est à cet âge qu’avec ses parents survivants, elle s’est échappée juste à temps, vers Alger puis vers une France qu’elle ne connaissait pas, mais où elle fera sa vie.
Depuis, elle ne s’était intéressée qu’épisodiquement au sort de sa communauté d’origine. Elle s’était efforcée, plutôt, de s’éloigner des camps où on avait voulu enfermer son horizon, de faire des études, d’acquérir un métier et de vivre. Jusqu’au jour où elle entendit le président algérien Abdelaziz Bouteflika justifier, quarante ans après la guerre, le bannissement des harkis. Cette déclaration, le 16 juin 2000, au terme de sa visite en France, selon laquelle “ les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis. (…) C’est exactement comme si on demandait à un Français de la Résistance de toucher la main d’un collabo ” lui a été insupportable. Tous ses souvenirs d’enfant, toutes les histoires personnelles des membres de sa famille ou des personnes étiquetées “ harki ” qu’elle avait rencontrées, au fil des années, dans les camps ou “ cités de transit ” françaises contredisaient une telle simplification de l’histoire.
En réalité, parmi les engagements divers des Algériens pendant les huit années de la guerre de libération, il n’est pas facile de faire la part des hasards, des solidarités et rivalités claniques ou familiales, et des réactions de survie devant la misère ou face aux formes de violence aveugle développées par les deux camps.
Un exemple : dans un village de Kabylie, un collecteur du FLN, dénoncé par un ennemi héréditaire, est arrêté puis “ retourné ” par les Français ; il tue son dénonciateur, que la famille venge en le tuant à son tour : sa mort est-elle l’assassinat d’un harki ou celle d’un ancien du FLN ? C’est avant tout le résultat d’une rivalité ancestrale dans un contexte troublé de guerre nationale qui a pris par endroits et par moments des aspects de guerre civile. Fatima Besnaci-Lancou est persuadée que les mêmes personnes ne se seraient pas retrouvées dans le même camp si le cessez-le-feu était intervenu six mois plus tôt ou six mois plus tard.
Des milliers d’Algériens ont servi, de l’indépendance à la fin de l’été 1962, de boucs émissaires. Combien ? L’auteur parle de 80 000 à 150 000 morts et l’éditeur avance, en quatrième page de couverture, le nombre de 100 000. Ces chiffres sont davantage des projections, des estimations que le résultat d’études véritables. Pour la bonne raison qu’indépendamment de la position inadmissible du pouvoir, personne ne souhaite en Algérie, dans les villages et les familles concernées, la réouverture de ces plaies par des recensements et des enquêtes précises. Ce qui laisse la porte ouverte aux chiffres les plus incertains.
Mais le mérite de l’auteur est de rapporter des histoires qui nous renseignent qualitativement sur les victimes et leurs bourreaux. Elles suffisent à montrer que les concepts de “traître” ou de “collabo” qui renvoient à l’histoire des nations européennes dans la Seconde guerre mondiale sont tout à fait impropres à décrire le phénomène harki durant la guerre d’Algérie. Beaucoup de familles étaient divisées. Fatima Besnaci-Lancou se souvient, comme de nombreux autres enfants de harkis, d’oncles montés au maquis rejoindre le FLN quand d’autres étaient avec les Français, et de gens qui, à la fois, aidaient les maquisards et cherchaient aussi à entretenir de bons rapports avec la caserne française voisine.
Il ne faut pas oublier aussi que plusieurs générations d’hommes algériens avaient construit des fidélités mentales avec l’univers de l’armée française, qui entraient en contradiction avec un sentiment national algérien naissant – ou renaissant – dans la société.
Certains nationalistes de cœur ont fui auprès des Français l’arbitraire de tel ou tel chef de maquis. Beaucoup songeaient surtout à sauver leur peau ou leur famille. Finalement, sauf pour une petite minorité, le choix de servir les Français n’a presque jamais été une opposition délibérée à l’idée d’une Algérie indépendante.
On ne peut que souscrire au souhait exprimé par les prestigieux préfaciers de ce livre, Jean Daniel et Jean Lacouture, que cette année de l’Algérie soit l’occasion “ qu’un peu de lumière soit faite sur le sort infligé à cette communauté humaine flagellée par une histoire incarnée aussi cruellement par leur patrie d’origine que par leur pays d’accueil ”.
C’est pour témoigner de cette histoire complexe qu’on cherche, ici et là, à étouffer sous des légendes, que Fatima a écrit ce livre.
Et aussi pour ne pas laisser ses deux enfants confrontés à un immense trou de mémoire, ou, pire encore, à des clichés générateurs de haine ou de désespoir. Son fils, surtout, rêve d’un séjour en Algérie.
En ce qui la concerne, elle n’a pas de haine. Elle souhaite simplement que l’on cesse, par des simplifications, d’un côté comme de l’autre de la Méditerranée, de cultiver les haines pour s’en servir.
