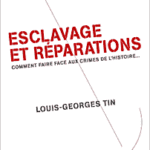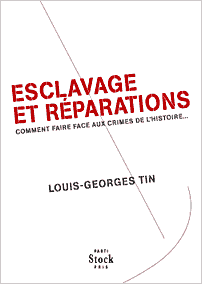
Stock, avril 2013 – 175 pages, 12.50 €
Quelles réparations ?
Pour Louis-Georges Tin, universitaire et président du Cran – Conseil représentatif des associations noires –, originaire de Martinique, s’il y a eu crime lors de la colonisation et de l’esclavage, il faut qu’il y ait réparation. Son plaidoyer pour des réparations manie avec brio les différentes acceptions du terme, sans relever la forte polysémie de ce concept, ni se demander s’il est possible en réalité de vraiment réparer un crime. Il reprend ce mot aussi bien pour désigner, par exemple, la «réparation symbolique» que fut le choix, pour Saint-Domingue, de s’appeler Haïti, la simple récupération de leurs richesses naturelles par les anciennes colonies à leur indépendance, la «réparation psychique» nécessaire aux anciens colonisés comme aux anciens colons, la dotation des esclaves à leur émancipation ou l’idée du «retour en Afrique» comme vraie sortie de l’esclavage, qui sont autant de sens différents du mot Les exemples qu’il donne, relatifs aux abolitions françaises ou aux revendications des Afro-américains, montrent bien pourtant qu’on peut recourir à ce terme pour justifier de multiples demandes. Doit-on penser en termes de réparations morales ou de réparations financières, de réparations individuelles ou de politiques de réparations collectives? Concernent-elles les victimes elles-mêmes ou bien leurs descendants, et, dans ce cas, jusqu’à combien de générations?
L’auteur ramène l’ensemble de la question de la colonisation et de l’esclavage à cette notion de réparations, suggérant qu’elle permettrait d’effacer ce passé comme on solde un compte. Pourtant la reconnaissance de celui-ci relève plutôt d’un long travail qui restera à l’ordre du jour dans les sociétés concernées pendant plusieurs générations. Il fait aussi l’impasse sur les réflexions de Frantz Fanon ou d’Aimé Césaire sur les aspects négatifs du concept de réparation. Dans l’histoire, cette notion a parfois conduit à prolonger les conflits qu’elle prétendait solder. Marcus Garvey, en 1920, avait-il raison de prendre exemple sur l’exigence de Poincaré à demander des réparations à l’Allemagne, quand on sait que, loin d’en finir avec la guerre, son intransigeance en a préparé une nouvelle ? Plutôt que des dommages et intérêts aux descendants des victimes, ne faut-il pas un patient travail de reconnaissance, assorti de politiques reconstructrices, notamment vers les nouvelles générations, et d’actions mémorielles, culturelles et symboliques? De ce point de vue, la décision que pourrait prendre le gouvernement français de rembourser la rançon inique, exigée par la France d’Haïti pour prix de son affranchissement, serait un geste fort.
Reste que ce livre dérangeant, qui aborde un sujet grave, nous oblige à repenser la page esclavagiste et coloniale de l’histoire de France, et la manière de la dépasser

La traite en héritage
Le mot intrigue, parfois même il inquiète. Lorsque l’on évoque la « réparation » de l’esclavage, le malaise, souvent, domine. Certains estiment que la servitude imposée, du XVIe au XIXe siècle, aux 12 millions d’Africains victimes de la traite atlantique est, par essence, irréparable. D’autres ajoutent qu’elle est, de toute façon, très ancienne. Les plus hautes autorités de l’Etat ont d’ailleurs fermé le ban. En 2013, à l’occasion de la journée commémorative de l’abolition de 1848, François Hollande a déclaré que la réparation était tout simplement « impossible ». L’effort doit porter sur la mémoire, a estimé le président en citant Aimé Césaire : « Ce qui a été a été. »
« Devoirs »
Le poète martiniquais de la négritude n’aimait guère, il est vrai, le mot de « réparation ». Pour autant, il ne circonvenait pas le débat au seul champ de la mémoire. « Je pense que les Européens ont des devoirs envers nous, comme à l’égard de tous les malheureux, mais plus encore à notre égard pour des maux dont ils sont la cause, expliquait-il. C’est cela que j’appelle “réparations”, même si le terme est plus ou moins heureux. »
C’est au nom de ce « devoir » particulier des Européens envers les descendants d’esclaves que le Conseil représentatif des associations noires (CRAN), et plusieurs associations antillaises, demandent aujourd’hui des « actions et des politiques publiques permettant de répondre à l’héritage durable de l’esclavage colonial » : ils demandent notamment une réforme foncière en outre-mer, des bourses d’études pour les étudiants noirs et une politique de co-devéloppement avec les pays africains victimes de la traite.
Mettre fin à « l’ère du tabou »
Au fil des ans, ces militants de la réparation ont été rejoints par des intellectuels ou des hommes politiques. En 2012, le philosophe Etienne Balibar, le député européen Daniel Cohn-Bendit, l’ancien ministre Jack Lang ou le sociologue Edgar Morin appelaient ainsi à mettre fin à « l’ère du tabou » : « L’heure du débat est arrivée », estimaient-ils.
Un an plus tard, l’économiste Thomas Piketty rappelait que la France avait mis en place une commission sur la spoliation des biens juifs, et que plusieurs pays d’Europe de l’Est et de l’ex-URSS s’étaient lancés dans des restitutions de propriétés et des compensations concernant des événements vieux de plus d’un siècle. « L’abolition de l’esclavage a eu lieu en 1848, concluait-il. Est-on sûr que cette légère différence en termes d’ancienneté suffise pour clore définitivement le débat ? »
Incompréhension polie
Le plus souvent, ces demandes se heurtent cependant à une incompréhension polie. En France, on associe volontiers l’esclavage au sud des Etats-Unis, pas à la patrie des droits de l’homme. Les faits, pourtant, sont têtus : l’esclavage était, certes, interdit en métropole, mais les Antilles françaises comptaient beaucoup plus d’esclaves que le sud des Etats-Unis. Du XVIe au XIXe siècle, 600 000 à 800 000 Africains furent déportés en Amérique du Nord, 1,6 millions dans les Antilles françaises. « Le commerce avec ses colonies fit de la France la troisième nation importatrice d’esclaves, après l’Angleterre et le Portugal », rappelait l’Assemblée nationale, en 1999.
Contrairement à ce que l’on croit souvent, les esclaves des territoires français étaient, en outre, plus durement traités que les esclaves américains. « Aux Etats-Unis, les mouvements abolitionnistes du nord aidaient les fugitifs venus du sud : ils jouaient le rôle d’une soupape, explique l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch. Aux Antilles, il n’y avait rien de tout cela. L’esclavage dans les plantations était très dur, surtout après la révolte d’Haïti, en 1 804. Les planteurs avaient tellement peur d’une rebellion qu’ils faisaient régner la terreur. Si beaucoup de Français l’ont oublié, c’est parce que ce chapitre de l’Histoire s’est déroulé loin de la métropole. »
Un passé pas vraiment soldé
Le silence a été d’autant plus facile qu’il a été encouragé par les autorités. Au lendemain de l’abolition, en 1848, le gouverneur de la Martinique, Claude Rostoland, recommandait « à chacun l’oubli du passé ». Les esclaves que l’« horreur de la servitude avait poussé à fuir » furent amnistiés par la IIe République, les propriétaires de ces hommes asservis qui, dans la comptabilité des plantations, figuraient à la rubrique « cheptel », furent indemnisés. « L’oubli a été posé comme un élément fondateur de la société issue de la servilité, dans l’outre-mer, mais aussi en métropole », résume Myriam Cottias, historienne au CNRS et présidente du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage.
Si les partisans de la réparation veulent mettre fin à ce long silence, ce n’est pas seulement pour dénoncer les injustices d’hier : c’est parce qu’ils estiment que le passé esclavagiste n’est pas vraiment soldé. « Aux Etats-Unis comme dans l’outre-mer français, les hiérarchies sociales et raciales héritées de l’esclavage n’ont pas complètement disparu, explique l’historien Pap Ndiaye. La situation actuelle des Noirs n’a évidemment rien à voir avec la servitude, mais cette histoire façonne encore les trajectoires actuelles. Une enquête sur les élites afro-américaines a ainsi montré que les ancêtres des Noirs qui figurent dans le “Who’s Who in Black America” étaient très majoritairement des individus “libres de couleurs”. Au début de la guerre de Sécession, ils ne représentaient pourtant que 10 % des Noirs vivant aux Etats-Unis ! »
Ni pécule, ni lopin de terre
Selon Pap Ndiaye, cette survivance des anciennes hiérarchies n’est pas le fruit du hasard. « Après les abolitions, les cartes n’ont pas été rebattues », résume-t-il. En 1865, le général nordiste Sherman avait en effet promis de donner aux affranchis américains « 40 acres et une mule » afin qu’ils puissent gagner leur vie, mais cette politique a été bien vite abandonnée : la plupart des descendants d’esclaves sont restés au sein des plantations avec des salaires de misère.
Dans les territoires français, une même logique a prévalu : les planteurs ont été généreusement indemnisés par la IIe République, alors que les esclaves n’ont reçu ni pécule ni lopin de terre. « Le fait de ne pas leur avoir donné leur chance, juste après l’abolition, a pesé lourd : leurs descendants restent, encore aujourd’hui, cantonnés à des positions subalternes », affirme Pap Ndiaye.
« Hiérarchies liées à la couleur »
Pour les tenants de la réparation, l’esclavage ne s’est pas contenté de laisser des cicatrices sociales : plus d’un siècle et demi après l’abolition, il reste, selon eux, inscrit dans nos mentalités. « C’est l’esclavage, dans les plantations des Antilles, qui a construit la catégorie de “Blancs” − synonyme de maîtres − et celle de “Noirs” − synonyme d’esclaves, explique Myriam Cottias. Ce regard racialiste a survécu à l’abolition de 1848, car les Républicains de la fin du XIXe étaient convaincus de la supériorité de la “race” blanche. Victor Hugo ou Jules Ferry pensaient ainsi qu’il faudrait beaucoup de temps pour amener les Noirs à la civilisation. Ces catégories raciales, nous en sommes les héritiers : nous les portons encore beaucoup plus profondément que nous le croyons. Ce sont elles qui nourrissent le racisme et les discriminations. »
Pap Ndiaye en veut pour preuve l’attention portée à la couleur de la peau qui gouverne, encore, bien des comportements sociaux. « Aux Etats-Unis comme en France, de nombreuses hiérarchies restent liées à la couleur. L’universitaire américain Henry Louis Gates raconte que, lorsqu’il est arrivé à Yale, dans les années 1970, il y avait des “brown bag parties” : on affichait à l’entrée un sac de papier brun dans lequel on mettait les courses : seuls pouvaient entrer ceux dont la peau était plus claire que le sac. Aux Antilles, les enfants métis, quand ils sont clairs de peau, sont souvent valorisés : on les appelle les “chappés” ou les “sauvés”, comme s’ils s’étaient échappés de la catégorie raciale des Noirs. Ces pratiques qui ont cours dans nos sociétés contemporaines sont l’un des héritages des sociétés esclavagistes. »
Condamnation symbolique
En montrant que la servitude n’est finalement pas si lointaine, en expliquant qu’elle modèle toujours une partie de nos représentations et de nos structures sociales, les partisans de la « réparation » espèrent ouvrir le débat. Ils ne demandent nullement à l’Etat de distribuer des chèques aux descendants d’esclaves. « Nous n’avons pas le fétichisme de la généalogie », explique le président du CRAN, Louis-Georges Tin.
L’entreprise serait d’ailleurs périlleuse : en raison du métissage, beaucoup d’Antillais ou de Guyanais ont, parmi leurs ancêtres, des esclaves, mais aussi des maîtres. Cette indemnisation individuelle réveillerait en outre des mauvais souvenirs. « Ce serait une atteinte à la dignité des esclaves, estime Myriam Cottias. Cette monétarisation des corps remettrait les esclaves et leurs descendants dans des positions d’objets, comme avant l’abolition. »
Travail de mémoire
Les associations qui plaident en faveur d’une « réparation » ne demandent pas non plus une déclaration de « repentance ». « Ce mot appartient au vocabulaire de la morale ou de la religion, remarque Louis-Georges Tin. Ce n’est pas notre registre. » La condamnation symbolique a d’ailleurs déjà eu lieu : en 2001, la loi Taubira, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et le Sénat, a solennellement affirmé que la traite négrière transatlantique, la traite dans l’océan Indien et l’esclavage « perpétrés à partir du XVIe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe » constituaient un « crime contre l’humanité ».
Dans la foulée de ce texte, un véritable travail de mémoire a été engagé : le 10 mai est devenu la journée nationale des mémoires de la traite, une stèle et une sculpture rendant hommage aux esclaves des colonies françaises ont été inaugurées à Paris, en 2011, et de nombreuses expositions ont vu le jour. « La loi Taubira a été décisive, explique l’historienne Myriam Cottias. Dans le domaine de l’enseignement, les choses ont beaucoup changé : depuis 2008, l’esclavage a été intégré dans les programmes scolaires de l’enseignement secondaire, ce qui est une bonne chose. La recherche, elle aussi, a beaucoup progressé : le Centre international de recherche sur les esclavages, que je dirige, a été créé en 2006. Nous avons lancé un programme européen et nous travaillons désormais avec des chercheurs africains, haïtiens et sud-américains. Depuis une dizaine d’années, il y a une véritable floraison de travaux sur ces questions. »
Politique de « co-développement »
Les partisans de la « réparation » estiment cependant que cet effort mémoriel ne suffit pas. Ils souhaitent, disent-ils, rouvrir le débat escamoté lors du vote de la loi Taubira − la proposition de loi initiale évoquait « les conditions de réparation due au titre de ce crime », mais l’article fut supprimé par la commission des lois. Le CRAN demande donc une amplification de la politique de « co-développement » avec les pays africains concernés, jusqu’au XIXe siècle, par la traite négrière, la mise en place d’une réforme agraire dans l’outre-mer français, et le remboursement des 90 millions de francs or (l’équivalent de 21 milliards de dollars actuels) payé par Haïti à la France, après le soulèvement des esclaves de 1 804.
Le président du CRAN plaide également en faveur de la création d’un « fond national de soutien aux réparations » qui serait alimenté par les entreprises ayant bénéficié, jadis, de l’esclavage. « Elles se sont enrichies grâce au travail gratuit fourni, avant l’abolition, par les esclaves, explique Louis-Georges Tin. Elles ne sont certes pas responsables de leur passé, nous le savons très bien, mais elles en ont tiré de confortables bénéfices qui leur ont permis de prospérer jusqu’à nos jours. C’est le cas, par exemple, de la société sucrière Say, qui a été fondée au début du XIXe siècle par Louis-Auguste Say, le frère de l’économiste Jean-Baptiste Say. Ces sociétés pourraient alimenter une fondation finançant des projets éducatifs, mémoriels ou sociaux. »
Encouragées par des lois incitant les entreprises à examiner leurs activités avant l’abolition de l’esclavage, certaines sociétés américaines se sont engagées dans cette voie. A la demande de la ville de Chicago, la banque JP Morgan a ainsi découvert, en analysant ses archives, qu’avant la guerre de Sécession, elle avait largement bénéficié de la servitude : deux des établissements dont elle est issue acceptaient des esclaves en caution lors de la délivrance des prêts et en prenaient possession lorsque les planteurs étaient en défaut de paiement. Entre 1831 et 1865, plus de 15 000 esclaves vivant dans le sud des Etats-Unis furent ainsi monnayés par ces banques.
126 millions de francs-or d’« indemnités »
Au titre de la « réparation », JP Morgan a décidé, en 2005, de lancer un programme universitaire de 5 millions de dollars, sur cinq ans, pour les étudiants noirs de Louisiane. « [Cette somme] couvrira l’intégralité des frais d’inscription en premier cycle, expliquait alors la banque. La sélection des étudiants se fera au mérite et sur critères sociaux. En plus de la bourse, les étudiants auront la possibilité de réaliser un stage chez JP Morgan Chase durant l’été, avec une possibilité d’embauche une fois leur cursus terminé. »
Une même logique a prévalu en Californie : en 2000, la « Slavery era Disclosure Law » a obligé les compagnies d’assurance à rendre publiques leurs activités pendant l’esclavage. Au titre de « réparation », plusieurs sociétés, comme Wachovia et Aetna, ont alors décidé de financer des bourses destinées aux étudiants afro-américains.
Les partisans de la « réparation » estiment que la France pourrait s’inspirer de cette démarche. Dans les colonies françaises, les planteurs ont en effet tiré un immense bénéfice de la servitude – parce que leurs commerces ont prospéré grâce au travail non rémunéré des esclaves pendant plus de trois siècles, mais aussi parce qu’ils ont reçu, après l’abolition, 126 millions de francs or d’« indemnités ».
Fortunes
Ces fortunes ont permis à de grandes familles antillaises de créer des sociétés qui existent encore aujourd’hui. Le CRAN ne souhaite ni procédure judiciaire ni comptabilité : il leur propose simplement de faire, à l’image de JP Morgan, un geste en faveur des plus déshérités – bourses, initiatives mémorielles, projets de formation.
Cette démarche ne convainc pas tout le monde. « Certaines firmes françaises ont effectivement assis leur prospérité sur l’esclavage – c’est le cas, par exemple, des entreprises qui faisaient venir des Antilles de la mélasse qu’elles transformaient en sucre sur le territoire métropolitain, précise l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch. Certaines de ces sociétés perdurent, mais peuvent-elles être considérées comme responsables ? Doivent-elles hériter de ces dettes morales qui remontent à plusieurs siècles ? Je n’en suis pas certaine. La création de bourses d’études serait, bien sûr, une bonne idée, mais elle me semble très difficile à imposer, voire à systématiser. »
Redistribution des terres
A cette controverse concernant les entreprises, s’ajoute un débat sur la redistribution des terres. La garde des sceaux, Christiane Taubira, souligne souvent que l’abolition ne s’est accompagnée d’aucune réforme agraire. « Les anciens esclaves n’ont guère eu accès au foncier, expliquait-elle en 2013. Il faudrait donc envisager, sans ouvrir de guerre civile, des remembrements fonciers, des politiques foncières. Il y a des choses à mettre en place, sans expropriation, en expliquant très clairement quel est le sens d’une action publique qui consisterait à acheter des terres. En Guyane, l’Etat avait accaparé le foncier, c’est plus facile. Aux Antilles, ce sont les descendants des “maîtres” qui ont conservé la terre, c’est plus délicat à mettre en œuvre. »
Les débats nationaux se doublent, depuis quelques années, d’un chapitre international. En 2001, lors de la conférence mondiale contre le racisme de Durban (Afrique du sud), les pays africains avaient – en vain – demandé « réparation » pour les trois siècles d’esclavage qui leur furent imposés. « Ce mal a privé pendant des siècles l’Afrique de ses ressources humaines et naturelles », expliquait le vice-président zambien à l’appui de sa demande d’annulation des dettes africaines.
Douze ans plus tard, en 2013, les quinze pays de la Communauté des Caraïbes créaient une « commission des réparations » afin d’évaluer le préjudice subi par les îles. « L’héritage de l’esclavage et du colonialisme dans les Caraïbes a sévèrement altéré nos possibilités de développement », affirmait Baldwin Spencer, le premier ministre d’Antigua-et-Barbuda (Etat insulaire des Petites Antilles).
Le chemin de la politique
Aux Etats-Unis, le débat est ouvert depuis les années 1960, même s’il reste souvent cantonné aux élites intellectuelles et aux milieux militants. « Pendant le mouvement pour les droits civiques, Malcom X parlait beaucoup de réparations en insistant sur les siècles de sueur et de sang imposés aux Noirs américains, souligne Pap Ndiaye. Le débat américain a été ravivé, en 2001, par un livre de Randall Robinson, (The Debt : What America Owes to Blacks, Plume) et depuis, cette question est débattue avec une certaine vigueur, au moins dans le monde académique. En France, ce n’est pas le cas. C’est dommage : entre la politique de la stèle, qui est nécessaire, et le chèque individuel, qui serait une insulte, il existe un espace pour la réparation des injustices et des discriminations liées à l’héritage de l’esclavage. »
A condition, précisent certains, que cette démarche de réparation emprunte le chemin de la politique − pas celui de la justice ou de la comptabilité. « Les Etats-Unis ont un langage, celui de la judiciarisation, qui n’est pas forcément le nôtre, remarque Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice. L’esclavage est par définition irréparable : il est donc illusoire de rêver d’une justice qui remettrait les compteurs à zéro. Il faut redéfinir le pacte républicain en ayant pour horizon des valeurs ou des mythes qui correspondent à l’histoire commune de la France et de ses colonies. C’est une bonne chose que la question de la redistribution des terres ou de la politique des entreprises s’invite dans ce débat, mais il doit prendre un tour politique, pas judiciaire. »