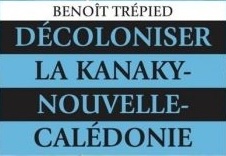Du peuplement kanak du pays il y a trois mille ans aux colons venus « blanchir » le territoire, de la lutte pour l’indépendance aux accords de paix, dans Décoloniser la Kanaky-Nouvelle Calédonie (Anacharsis, mars 2025) Benoît Trépied revient sur un long chemin d’émancipation et examine les mutations survenues ces quarante dernières années, d’un point de vue tant social, qu’économique et politique. Nous publions ici sa conclusion, qui tire les leçons des événements de 2024 et indique qu’une indépendance dont les formes restent à définir est la seule solution.
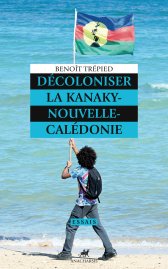
« Les Kanak vous emmerderont jusqu’à l’indépendance, que vous soyez contents ou pas contents. »
Jean-Marie Tjibaou, 4 septembre 1987[1].
« Ici c’est Kanaky content ou pas content. »
Banderole indépendantiste, Nouméa, mai 2024[2].
Deux mois à peine après le soulèvement du 13 mai 2024, les législatives de juillet ont fait l’effet d’un coup de semonce en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Pas seulement à cause de la victoire surprise d’Emmanuel Tjibaou, mais aussi et surtout parce que les résultats montrent qu’en l’état actuel des rapports de force, les indépendantistes n’ont pas besoin de restreindre le corps électoral pour l’emporter. Obtenues avec un corps électoral ouvert, leurs 10 000 voix d’avance suscitent autant d’espoir dans leur camp que de crainte chez les loyalistes. Mais cette nouvelle donne interroge aussi sur la pertinence du combat autour du gel du corps électoral qui a mis le feu au pays. À l’aune du scrutin, certains commentateurs et responsables politiques jugent ainsi que le cataclysme du 13 mai n’avait pas lieu d’être puisque l’argument de la minorisation électorale des Kanak ne tient plus. Pour l’Éveil océanien par exemple, « cela signifie que l’insurrection était déjà un non-sens, tout d’abord sur la forme avec des morts et des blessés, directement ou indirectement, des entreprises brûlées, des milliers d’emplois perdus, des vies à jamais bouleversées, puis sur le fond au vu des résultats des législatives[3] ».
Le scrutin de juillet 2024 est incontestablement un tournant électoral et politique, et la crise que connaît la Kanaky-Nouvelle-Calédonie depuis huit mois un drame incommensurable. Pour autant, je ne pense pas que l’insurrection du 13 mai ait été un « non-sens ». Tout l’objectif de ce livre était de montrer qu’elle fait sens, pour de multiples raisons.
Corps électoral, citoyenneté et décolonisation
En matière électorale d’abord, aujourd’hui n’est pas demain. On ne sait rien des flux et reflux migratoires que connaîtra la Kanaky-Nouvelle-Calédonie à l’avenir : c’est pour se prémunir d’un risque futur de marginalisation que les Kanak se mobilisent sur cet enjeu. Surtout, il ne faut pas perdre de vue la portée hautement politique et symbolique du gel du corps électoral qui, bien au-delà des enjeux électoraux immédiats, s’inscrit fondamentalement dans une longue histoire d’aliénation et de lutte. Il s’agit d’un mécanisme essentiel de la décolonisation telle que définie par l’accord de Nouméa ; un mécanisme qui passe par un double mouvement d’exclusion et d’inclusion.
Sur le volet exclusif, la restriction du corps électoral constitue pour les Kanak un rempart incontournable contre la colonisation de peuplement, toujours d’actualité et qui le demeurera tant que les Français pourront s’installer dans l’archipel comme bon leur semble. Exclure du vote les Français débarqués en Kanaky-Nouvelle-Calédonie après 1998, c’est-à-dire après le lancement officiel du processus de décolonisation, c’est une façon de leur rappeler où ils mettent les pieds. Ils ne sont ni en Île-de-France ni sur la Côte d’Azur, mais aux antipodes de l’Europe, sur une terre d’Océanie qui tente de s’affranchir d’une histoire coloniale complexe et traumatique dont ils ne font pas partie. S’ils font mine d’ignorer ce fait, alors ils perpétuent et reproduisent une logique coloniale contre laquelle les Kanak n’ont pas cessé de s’insurger depuis le xixe siècle. C’est cette même logique qui les a fait se lever une fois de plus le 13 mai.
Sur le volet inclusif, le corps électoral gelé fixe les frontières de la citoyenneté calédonienne. En d’autres termes, il définit le périmètre des personnes qui reconnaissent la Kanaky-Nouvelle-Calédonie comme leur pays, qui sont d’ici et pas d’ailleurs, et qui dès lors ne sont pas censées envisager l’avenir sans les Kanak, peuple autochtone et, à ce titre, incontournable. Les Kanak ont accepté de partager leur droit à l’autodétermination et à la décolonisation avec ces Calédoniens de toutes origines, « victimes de l’histoire » ou autres. Pour sortir du contentieux colonial qui les a longtemps opposés, les signataires de l’accord de Nouméa ont trouvé une issue par le haut, qui ne ressemble à aucune autre : faire peuple dans une citoyenneté partagée et construire ensemble un pays engagé sur la voie d’un destin commun, de l’émancipation et de la souveraineté. Pendant la période de l’accord de Nouméa, ce peuple calédonien en devenir, ce « Nous » formé de la réunion du peuple kanak et des autres communautés de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, était celui qui votait aux élections provinciales.
D’une certaine façon, c’est à prendre ou à laisser. Soit les citoyens du pays jouent le jeu et embarquent sur la pirogue kanak – pour reprendre une métaphore océanienne – afin de définir ensemble un chemin d’avenir, c’est-à-dire une forme de recouvrement de souveraineté convenant à tout le monde. Soit ils nient le fait autochtone et restent sur les rives d’une colonie, les yeux tournés vers Paris. Mais dans ce cas, ils vivront toujours dans une situation d’insécurité coloniale latente où le pays risquera de brûler encore et encore ; ou bien ils finiront par partir. Car quoi qu’il arrive, les Kanak ne renonceront jamais à leur souveraineté aliénée par la colonisation française. Ils n’ont pas d’autre pays que la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Qu’on le veuille ou non, la phrase prononcée par Jean-Marie Tjibaou en mars 1985 est toujours d’actualité quarante ans plus tard, et le restera à l’avenir : « En Calédonie la paix s’appelle indépendance kanak[4]. »
Maintenant que le processus ouvert par l’accord de Nouméa est terminé, le périmètre du corps électoral a vocation à être rediscuté, comme tous les autres dispositifs prévus par le texte de 1998. Toutefois, c’est précisément parce que ce point ne renvoie pas seulement à des enjeux électoraux, mais aussi à la définition même de la citoyenneté calédonienne, c’est-à-dire aux frontières du futur peuple calédonien, qu’il doit faire l’objet d’une attention particulière. C’est un code de la citoyenneté de Kanaky-Nouvelle-Calédonie qu’il faut dorénavant inventer, dans un contexte où le peuple autochtone kanak, historiquement minorisé, doit encore accueillir des nouveaux venus dans le corps des citoyens, alors même qu’il refuse simultanément d’être invisibilisé ou noyé dans le peuple calédonien – a fortiori dans le peuple français. Entre autochtonie et citoyenneté, identité kanak et destin commun, indépendance et lien à la France, il y a là des logiques d’échelles et d’emboîtements complexes à articuler.
Une question aussi sensible ne peut être abordée qu’avec beaucoup de temps et de finesse. Elle ne peut être disjointe d’une réflexion globale sur le devenir du pays. Et elle ne peut être tranchée qu’à Nouméa, par les principaux intéressés qui en connaissent toutes les nuances, et pas à Paris, par des parlementaires français ignorants des subtilités du dossier. Pour avoir agi en la matière comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, en invoquant les grands mots de « République » et de « démocratie » afin de masquer la nature coloniale du problème à régler – un peu comme Charles Pasqua déclarant quarante ans plus tôt, sans autre forme de procès, que « la défense de Bastia commence à Nouméa » –, l’État et les loyalistes ont une nouvelle fois précipité la Kanaky-Nouvelle-Calédonie dans l’abîme.
Soulignons d’ailleurs, pour bien comprendre l’ampleur de la tragédie, que les indépendantistes avaient déjà accepté, avant le 13 mai et en guise de compromis, d’intégrer au corps électoral provincial toutes les personnes nées dans le pays. L’idée était d’instaurer une procédure d’accession à la citoyenneté calédonienne par droit du sol. Ces « natifs » ne sont pas quantité négligeable : ils représentent grosso modo la moitié des 25 000 individus potentiellement concernés par le projet de loi constitutionnelle, si l’on se fie aux listes électorales générales (loin d’être fiables pourtant, comme indiqué plus haut). L’autre moitié est constituée de citoyens français arrivés dans le pays il y a plus de dix ans mais après 1998, donc inscrits sur les listes électorales générales mais exclus des scrutins provinciaux – et parmi lesquels, il faut le redire, un nombre inconnu mais sans doute conséquent de personnes ne résidant plus dans le pays et qui devraient être radiées des listes. Là encore, l’État et les loyalistes ont refusé de transiger et de considérer cette proposition d’ouverture des indépendantistes, pour les résultats que l’on sait.
Situation coloniale et lutte kanak
Si le soulèvement du 13 mai n’est pas un « non-sens », c’est aussi parce qu’il couvait depuis longtemps déjà. Le projet d’ouverture du corps électoral a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase mais, au fond, le problème dépasse de loin la question du vote. Il renvoie d’abord au sentiment de dépossession coloniale qui perdure encore aujourd’hui chez de nombreux Kanak, en particulier au sein des jeunes générations, et que les accords de Matignon et Nouméa n’ont pas réussi à dissiper.
Ce sont toutes les frustrations kanak accumulées en silence depuis 1988 qui ont explosé à partir du 13 mai 2024. L’amertume face à un processus de décolonisation qui s’est arrêté aux portes de Nouméa. L’insatisfaction liée au maintien dans les faits, derrière les beaux discours sur le destin commun, de mécanismes structurels de domination, d’exploitation et d’exclusion hérités du passé colonial. L’aversion pour un système politique, économique et social qui, en dépit de toutes les avancées sur la voie du rééquilibrage, est resté profondément colonial, avec la bénédiction des élus et des patrons loyalistes, reproduisant encore et encore les inégalités et les discriminations au détriment des Kanak. Le rejet d’une classe politique indépendantiste qui a vieilli sans se renouveler et s’est bureaucratisée. Le ras-le-bol né de l’expérience répétée de la détresse sociale, du racisme quotidien, de la stigmatisation et du mépris – notamment des jeunes, en permanence renvoyés à la délinquance –, alors que coexistent à Nouméa une grande précarité touchant quasi exclusivement les Kanak et les Océaniens, et un étalage des richesses du côté européen. La rancœur, enfin, vis-à-vis des Français de l’Hexagone qui, ignorant tout du lourd contentieux colonial calédonien, débarquent en terre kanak puis, au bout d’un moment, se l’approprient sans même y penser, trompés par la fausse évidence du drapeau bleu blanc rouge comme des générations de colons avant eux.
Dans ces conditions, il faut être aveugle, sourd et amnésique, ou faire preuve d’une bonne dose de mauvaise foi, pour considérer comme Nicolas Metzdorf que les événements du 13 mai 2024 relèvent du fascisme ou du racisme anti-Blancs, alors qu’il s’agit foncièrement d’une révolte contre une situation coloniale. Ce à quoi on a assisté en réalité, c’est à un soulèvement contre un héritage colonial qui continue de marquer le pays et ses habitants de son empreinte. C’est à une insurrection liée au fait que le processus de décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie n’a pas été mené à son terme.
À partir du 13 mai, des milliers de jeunes Kanak se sont jetés à corps perdu dans ce tourbillon, aux côtés d’autres Océaniens, au cri de « Kanaky ». Condensées dans ce cri de ralliement, leur rage, leur énergie et leur colère ont semé le chaos. Comme l’a écrit sur le moment le philosophe Hamid Mokaddem, aux premières loges en tant qu’habitant d’un quartier nord de Nouméa, « plutôt que d’émeute généralisée, on est en face d’une révolte de jeunes Kanak qui veulent en découdre et aller jusqu’au bout. Au bout de la nuit, la Kanaky[5] ». Tous les témoignages de première main que j’ai pu recueillir décrivent un déferlement de violence qui a stupéfait tout le monde, tant par son ampleur que par son aspect confus et désordonné. Au sein de la population kanak et parmi les responsables politiques, de nombreuses personnes ont condamné le soulèvement et taxé les « émeutiers » d’irresponsables réduisant en cendres tout le chemin parcouru par le peuple kanak depuis la signature des accords de Matignon. D’autres au contraire ont défendu ces nouveaux « combattants » qui, de leur point de vue, reprenaient le flambeau de la longue lutte kanak contre l’ordre colonial, avec leurs propres références, leurs stratégies et leurs capacités d’action (via les réseaux sociaux notamment), et qui étaient prêts à tout détruire et tout sacrifier pour Kanaky – y compris leur vie. En brousse et aux îles, certains Kanak n’ont pas caché leur satisfaction et leur fierté de voir les jeunes de la ville s’insurger ainsi, et se sont précipités à Nouméa pour observer la révolte de plus près, voire y participer.
C’est pour cela que l’hypothèse de « commanditaires des exactions » préparant à l’avance la destruction minutieuse de Nouméa ne me semble pas convaincante, jusqu’à preuve du contraire, malgré les propos répétés en boucle par les dirigeants loyalistes et les représentants locaux du gouvernement et du parquet pour accréditer l’idée d’un plan prémédité de la CCAT. Que des discours enflammés aient été tenus dans des moments de ferveur militante, cela ne fait pas de doute, dans les deux camps d’ailleurs : des cris comme « On va brûler Nouméa ! » ont été entendus lors de manifestations indépendantistes, auxquels a répondu la fameuse phrase de Sonia Backès menaçant de « mettre le bordel »[6]. Mais les jeunes qui se sont soulevés à partir du 13 mai ont l’air de n’avoir obéi à personne d’autre qu’eux-mêmes[7].
L’échec de l’accord de Nouméa ?
Dans les circonstances actuelles, au vu du profond malaise colonial qui gangrène aujourd’hui encore la société calédonienne, et dont cette explosion urbaine est la conséquence, on est en droit de se demander si l’accord de Nouméa a finalement été un échec.
À mon sens, la lettre et l’esprit de l’accord ne sont pas forcément en cause. En imaginant une forme originale de décolonisation au xxie siècle qui articule à la fois l’identité kanak et le destin commun, qui élabore une citoyenneté partagée sur la voie de la souveraineté, qui transcende le passif colonial et les antagonismes dans une communauté de destin, et qui organise la réconciliation entre ex-colonisateurs et ex-colonisés dans une dynamique d’émancipation d’un genre nouveau, le projet de l’accord de Nouméa demeure audacieux, prometteur et, à bien des égards, inégalé.
En revanche, c’est sa mise en œuvre qui n’a pas été à la hauteur du souffle politique de 1998. La responsabilité en incombe aux dirigeants locaux et nationaux. Aux loyalistes d’abord, qui ont trop souvent renié leurs signatures au bas de l’accord de Nouméa et n’ont jamais vraiment rompu avec leurs vieux réflexes colonialistes et racistes. À l’État français ensuite qui, sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, a volontairement enrayé le processus de décolonisation à partir de 2021, au nom des intérêts supérieurs de la France dans l’« Indo-Pacifique ». Aux indépendantistes enfin, qui ont considéré qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner d’une remise en cause trop frontale du processus institutionnel en cours, en dépit des dérives avérées des autres signataires.
En un sens, les dirigeants du FLNKS semblent avoir fait trop confiance à l’accord de Nouméa, comme si sa signature avait créé de facto, dès 1998, une « indépendance au présent[8] » et une accession inéluctable à la souveraineté. On pourrait d’ailleurs dresser un constat analogue à propos de leur optimisme concernant le projet d’usine du Nord qui devait financer l’indépendance, et dont la fermeture constitue l’autre cataclysme de l’année 2024 – dont on parle moins, car le 13 mai l’a éclipsé. Quoi qu’il en soit, sans doute trop occupés à gérer les provinces Nord et Îles, les élus indépendantistes ne se sont guère mobilisés pour s’opposer aux politiques réactionnaires de la droite locale en province Sud, au Congrès ou au gouvernement. Nouméa n’est pourtant plus la ville blanche qu’elle était, mais les Kanak et les Océaniens qui y vivent, en particulier dans les quartiers populaires et les squats, n’ont pas été placés en haut des priorités du FLNKS sous l’ère des accords, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans les faits, ils ont été peu ou prou abandonnés à leur sort et aux élus loyalistes du Sud.
Lors des accords de Matignon en 1988, le partage du pouvoir par la création des trois provinces avait permis de ramener la paix. Trente-six ans plus tard, ce sont les Kanak de la province Sud, en particulier les « gosses perdus » de « Babylone », comme on dit dans l’archipel, qui ont déterré la hache de guerre. Au cœur du fief loyaliste de Nouméa, ces oubliés des accords ont rué dans les brancards en poussant le même cri : « Ici c’est Kanaky. »
Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie
« Il faut se rappeler, pour comprendre notre malaise et nos aspirations, que nous ne sommes pas encore décolonisés », déclarait Jean-Marie Tjibaou en 1984. « Ce monde moderne, que nous n’avons pas encore exorcisé, continue à porter la marque d’une colonisation qui nous diminue, qui nous châtre »[9]. Quarante ans plus tard, énormément de choses ont changé – en mieux – pour les Kanak grâce aux accords, mais cette « marque de la colonisation » n’a pas disparu. Pour sortir le pays de l’ornière, la décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie demeure plus que jamais d’actualité.
À court terme, cela passe par un changement complet d’attitude de la part de l’État et des loyalistes. La réponse purement répressive et punitive dont ils font preuve depuis le 13 mai 2024 à l’égard des Kanak est une impasse totale qui mène le pays droit à la catastrophe – une catastrophe encore bien pire que celle des derniers mois, alors que flotte déjà dans l’air un tragique parfum d’Algérie française. Si les autorités nationales et locales persistent dans cette logique d’affrontement et de vengeance, comme elles l’ont déjà fait en 1986-1988, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie risque de plonger dans un nouveau bain de sang – un nouvel Ouvéa – et de ne jamais pouvoir se relever. Ni l’emballement de la machine policière, judiciaire et pénale de l’État, ni les mesures de rétorsion économique et sociale prises par les dirigeants loyalistes et le patronat ne permettront un quelconque apaisement, bien au contraire.
Les Kanak ont de la mémoire. Ils savent que c’est l’État qui a fait dérailler le troisième référendum décisif de 2021 pour éviter que le « oui » à l’indépendance l’emporte. Depuis 1998, ils ont observé les loyalistes contourner l’exigence de décolonisation contenue dans l’accord de Nouméa. Ils se souviennent, avant cela, de l’attitude de l’administration et des colons à l’égard des leurs, de l’injustice et de l’humiliation coloniale subies par leurs aïeux, des révoltes kanak brutalement réprimées, génération après génération, des années 1850 aux années 1980[10]. À l’aune de cette mémoire longue du fait colonial, les choix politiques d’Emmanuel Macron et de Sonia Backès ne peuvent apparaître que comme les derniers avatars contemporains d’une oppression coloniale qui dure depuis plus de cent soixante-dix ans. Il est indispensable d’abandonner cette approche colonialiste à Nouméa, et impérialiste à Paris, vis-à-vis du dossier calédonien.
À long terme, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie explosera de nouveau si aucune réponse politique et sociale n’est apportée à la revendication kanak de souveraineté et d’indépendance, une aspiration plus pressante que jamais parmi les jeunes générations nées sous l’ère des accords. C’est non seulement la leçon du 13 mai, mais c’est aussi le sens de l’histoire. Il suffit de penser au renversement des écarts électoraux des dernières années, des 18 000 voix de retard des indépendantistes au référendum de 2018 à leurs 10 000 voix d’avance aux législatives de 2024. On peut aussi évoquer ce qu’il se passe en dehors du Grand Nouméa, à Voh-Koné-Pouembout, Bourail, Poindimié et ailleurs, là où Kanak et Caldoches ont fait la paix au nom de leur commune appartenance au pays, dans le cadre inclusif et rassembleur de la citoyenneté calédonienne. Dans cette brousse où la présence kanak est incontournable, des habitants de toutes communautés s’engagent désormais dans la construction d’un futur partagé menant, sous une forme ou une autre, à la souveraineté. Ils se sont d’ailleurs rassemblés pour réaffirmer leurs liens de concitoyenneté quand Nouméa a brûlé. Dans l’agglomération elle-même, l’insurrection de mai-juin 2024 a aussi donné à voir des solidarités inédites entre communautés, notamment entre Kanak et Océaniens, tant du côté des insurgés que des résidents des quartiers socialement et ethniquement mixtes. Enfin, l’attachement affectif croissant des jeunes Wallisiens, Caldoches, métis et autres aux symboles de la Kanaky témoigne également de l’émergence d’une adhésion populaire à l’idée d’un pays libre et émancipé dans lequel chacun a sa place.
Plutôt que de réprimer à tout va, l’État et les responsables locaux devraient s’appuyer sur ces changements sociaux et politiques qui sont la plus grande réussite de l’accord de Nouméa, et qui découlent d’une décision majeure prise en 1998 : celle de reconnaître le fait colonial dans toute son ampleur et ses multiples dimensions. Le projet de destin commun ne fait sens que parce que les signataires de l’accord ont choisi de nommer et de décrire le phénomène colonial, que parce qu’ils ont pris la mesure de ses conséquences historiques et contemporaines, tant d’un point de vue politique que socio-économique et culturel, et qu’ils ont tenté d’agir pour s’en affranchir. C’est une voie originale de décolonisation pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie et ses habitants qui a été dessinée à ce moment-là.
Aucune paix durable dans le pays ne sera possible si cette dynamique de décolonisation n’est pas poursuivie, si elle ne suscite pas la refondation d’un nouveau contrat social et politique, et si elle ne débouche pas sur une forme originale d’indépendance qui reste à inventer. Il n’y a pas d’autre solution.
Benoît Trépied est anthropologue, chargé de recherche au CNRS et membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, EHESS). Ses recherches portent sur les relations raciales en Nouvelle-Calédonie coloniale et les enjeux contemporains de la décolonisation.
[1] Jean-Marie Tjibaou, conférence de presse, 4 septembre 1987 (voir la note 45, p. 85xx).
[2] Mokaddem, 2024, p. 29 (photographie).
[3] L’Éveil océanien, « Résultats des législatives », communiqué, 10 juillet 2024.
[4] Tjibaou, 1996, p. 176.
[5] Mokaddem, 2024, p. 37.
[6] Nogues, 2024.
[7] Mokaddem, 2024 ; Ellen Salvi, « Dans les quartiers populaires de Nouméa, la colère des jeunes couve toujours », Mediapart, 12 décembre 2024 ; Louise Chauchat et François Roux, « Nouvelle-Calédonie : quand la justice devient le bras armé du politique face à l’insurrection kanak pour son indépendance », La Lettre. La revue du Syndicat des avocats de France, octobre 2024.
[8] Néaoutyine, 2005.
[9] Cité dans Bensa, 1998, p. 105.
[10] On pourra lire notamment Bensa, Goromoedo et Muckle, 2015.