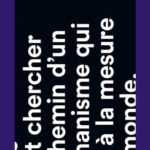Décolonial, par Stéphane Dufoix

Présentation de l’éditeur
« Décolonial » ou « décolonialisme » : des mots omniprésents dans le débat public français, mais dont le sens réel et la portée heuristique semblent ignorés ou instrumentalisés. Ce nouvel opus de la collection Le mot est faible permet d’y voir plus clair.
Depuis quelques années, les mots « décolonial » et « décolonialisme » ont fait leur apparition dans le débat public français : dans les tribunes, discours, essais ou encore éditoriaux divers. Ils y occupent une place très particulière, celle du mot qui divise en prétendant défendre l’unité, celle du mot qui agit en prétendant se contenter de décrire, celle de la victime contre l’ennemi qui menace.
Comme nombre de titres de la collection Le mot est faible, l’objectif de l’ouvrage est d’explorer les transformations de certaines approches épistémiques contre-hégémoniques à l’échelle mondiale. Si le mouvement décolonial n’est pas le seul existant, il est sans doute l’un des plus repris actuellement, du fait de son affinité sémantique avec l’idée de décolonisation. Explorer ces nouvelles approches nécessite aussi de s’intéresser aux logiques de résistance – politiques et intellectuelles – qui s’exercent en particulier en France à leur égard. L’ouvrage tente non pas de rester neutre, mais de plaider pour un engagement académique, tout à la fois réflexif et situé, attentif à saisir à quel point et de quelle manière l’ethnocentrisme – pas seulement eurocentré – invite au binarisme. Il s’agit d’inciter à réfléchir et à rendre possible un dialogue scientifique plus large, ouvert au(x) monde(s) et à une forme d’universalité différente, qu’on l’appelle « pluriverselle » ou tout simplement « plurielle ».
L’hégémonie culturelle du colonialisme
À propos de : Stéphane Dufoix, Décolonial, Anamosa
par Alain Policar, publié dans La vie des idées, le 6 janvier 2023.
Source
La mouvance décoloniale est diverse et souvent très éclatée. Elle n’en demeure pas moins une force théorique majeure, qui traque toutes les formes d’eurocentrisme et explique que la connaissance est toujours nécessairement située.
Dans un domaine où les contempteurs s’empressent de disqualifier un champ d’études en raison de sa supposée absence de rationalité ou de traiter d’imposteurs les auteurs qui s’en réclament, rares sont ceux qui se donnent la peine de lire les textes. La première vertu du livre de Stéphane Dufoix est son exceptionnelle connaissance du corpus qu’il étudie. Cette connaissance lui permet d’en dégager l’extrême diversité (même si la plupart des auteurs sont originaires d’Amérique latine), d’abord disciplinaire (philosophie, sociologie, histoire, sémiotique, anthropologie, pédagogie et même théologie), mais aussi d’inspiration (philosophie de la libération, théorie de la dépendance, postcolonialisme). Et ainsi de parvenir, en peu de pages, à en dégager la logique, alors que, le plus souvent, on se contente d’en dénoncer les excès.
Avant toute chose, il convient de procéder à une clarification terminologique. Pour nommer le courant dont il est question, certains parlent (nous l’avons fait) de décolonialisme, alors que S. Dufoix, comme en témoigne le titre de l’ouvrage, préfère décolonial. En effet, le premier est une construction polémique, destinée à disqualifier ceux qui s’inquiètent de la persistance de discriminations systémiques, et, surtout, il suppose une homogénéité introuvable, alors que le second n’implique pas l’affirmation de cette homogénéité. De surcroît, la position de S. Dufoix a le mérite d’être conforme avec la façon dont les auteurs décoloniaux, eux-mêmes, se désignent. Nous nous rangeons donc à son choix : en effet, « décolonial invite à ce qu’on entre plus avant dans son histoire » (p. 23).
Et c’est bien ce que fait l’auteur en clarifiant la nature et de la puissance critique de l’interpellation que les auteurs se réclamant de la mouvance décoloniale adressent à l’Occident.
Défense et illustration du paradigme décolonial
L’affirmation principielle est l’indissociabilité de la colonialité et de la modernité, ce qui explique que 1492 soit systématiquement privilégié comme la date inaugurale, celle de l’instauration d’un ordre colonial fondé sur l’émergence du commerce transatlantique triangulaire. Cette thèse s’ancre sur une réalité factuelle : c’est lors de cette période que se forge une identité européenne, celle du « nous contre le reste du monde », qui justifie l’asservissement de certaines populations au nom de leur infériorité supposée. La colonialité n’est donc pas une conséquence de la modernité, elle est constitutive de celle-ci.
Elle n’est pas un résidu ou une séquelle d’une violence originelle, le colonialisme. Décolonialité n’est donc pas synonyme de décolonisation : la colonialité survivant au colonialisme, la décolonialité doit compléter la décolonisation juridique et politique qui a été conduite aux XIXe et XXe siècles en s’intéressant à la dimension épistémique (colonialité du savoir pour Edgardo Lander), ou encore à la négation ontologique (colonialité de l’être, selon Walter Mignolo et Nelson Maldonado-Torres). Comme le résume Enrique Dussel, les Indiens « voient leurs propres droits niés, ainsi que leur civilisation, leur culture, leur monde, leurs dieux au nom d’un dieu étranger et d’une raison moderne »
Cette perspective modifie profondément l’analyse de la modernité : cette dernière n’est plus le produit de processus internes au développement de l’Europe, elle apparaît lors de la rencontre de celle-ci avec l’Amérique, moment où se crée la notion de périphérie, « quand l’Europe put se définir comme un “ego” découvreur, conquérant, colonisateur de l’Altérité constitutive de sa propre Modernité ». On comprend que l’on ne puisse se contenter d’insister sur la dépossession des terres : il y a aussi dépossession des identités culturelles. De ces mécanismes, S. Dufoix rend compte avec clarté et érudition.
Repenser l’universalisme classique, ce n’est pas réveiller le démon du particularisme, de la pureté biologique et des passions fascistes, ni tomber dans le piège de l’identité comme fondement de toute légitimité, ou couper la République en deux. C’est, tout au contraire, chercher le chemin d’un humanisme à la mesure du monde.
Lire la suite dans La vie des idées
Universalisme,
par Julien Suaudeau et Mame-Fatou Niang

Présentation de l’éditeur
Repenser l’universalisme classique, ce n’est pas réveiller le démon du particularisme, de la pureté biologique et des passions fascistes, ni tomber dans le piège de l’identité comme fondement de toute légitimité, ou couper la République en deux. C’est, tout au contraire, chercher le chemin d’un humanisme à la mesure du monde.
Partout, des plateaux de chaînes info aux tribunes des grands hebdomadaires, des interviews présidentielles aux phénomènes de librairies, on dresse le même constat : l’universalisme, indissociable de l’esprit français, pilier de la République, ferait face à un péril mortel. Dans le récit qui structure le discours politico-médiatique en France, l’antiracisme présentable d’antan, validé par les partis de gauche pour son ambition universaliste – lutter en même temps contre toutes les haines collectives en intégrant tout le monde – se verrait supplanté par un antiracisme « décolonial », « indigéniste » et « catégoriel », dont la grille de lecture serait « racialisante ». Si ce nouvel antiracisme est perçu comme une menace pour l’universalisme, c’est parce que ses promoteurs joueraient avec le feu communautariste. L’antiracisme 2.0 serait ainsi un racisme déguisé, utilisant des concepts essentialisants qui ne valent guère mieux que les théories de la suprématie blanche. Idiots utiles du soft power américain ou apprentis-sorciers de la gauche radicale, ses idéologues formeraient avec l’extrême droite une « tenaille identitaire » visant à renverser l’ordre républicain, en déclenchant rien moins qu’une guerre des races.
Mais de quel universalisme parle-t-on ? Dans quelle mesure le concept fait-il l’objet d’un monopole intellectuel ? Pourquoi ceux qui se pensent et se disent universalistes sont-ils convaincus qu’il n’en existe qu’une seule forme – celle qu’ils professent ? Et comment expliquer l’équivalence morale entre racisme et antiracisme qui sous-tend leur « modèle » ? Telles sont les questions que pose cet essai qui se veut à la fois une critique de la raison pseudo-universaliste et une approche de l’universalisme postcolonial, ou créolisé. Repenser l’universalisme classique, ce n’est pas réveiller le démon du particularisme, de la pureté biologique et des passions fascistes. Ce n’est pas non plus tomber dans le piège de l’identité comme fondement de toute légitimité, ni couper la République en deux. C’est, tout au contraire, chercher le chemin d’un humanisme à la mesure du monde.
Pour un universalisme « à la mesure du monde »
par Colin Folliot, publié par Le Monde, le 18 février 2022.
Source
Reprenant à leur compte la formule d’Aimé Césaire, Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau invitent à penser un humanisme adapté aux habitants d’origines diverses de la France aujourd’hui.
Rien de commun, a priori, entre une femme portant le voile, une réunion féministe en non-mixité et une statue de Colbert ou de Gallieni. Ces trois sujets alimentent pourtant régulièrement de virulentes polémiques, dont le scénario est devenu familier. Une personnalité médiatique s’insurge devant une actualité, qui touche en général les musulmans, les femmes ou les personnes LGBT. L’universalisme républicain est en péril, menacé par une dérive intellectuelle qui entraînerait le pays vers une société fracturée, minée par les communautarismes. L’argument est redoutable – qui, en France, se proclamerait anti-universaliste ? – et mène à un débat stérile, comme si ses protagonistes ne parlaient pas la même langue.
La collection « Le mot est faible » de l’éditeur Anamosa s’emploie à désarmer ce genre de rhétorique. Elle regroupe des ouvrages courts et incisifs, dont chacun est consacré à un « mot dévoyé par la langue du pouvoir » (l’histoire, la science, le peuple…) qu’il s’agit de revitaliser. Universalisme, écrit par Mame-Fatou Niang, maîtresse de conférences à l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh et spécialiste de l’antiracisme en France, et Julien Suaudeau, enseignant au Bryn Mawr College et spécialiste de l’histoire coloniale et de son refoulement, est le dernier de cette série.
Pour sortir des polémiques rebattues, les deux auteurs veulent explorer une autre voie, « entre l’immobilisme et la table rase ». Cette tentation de la « table rase », portée par certaines revendications minoritaires, leur apparaît comme une impasse. Mais leur cible est d’abord dans l’autre camp, chez ceux qu’ils qualifient de « pseudo-universalistes ». Tout en prétendant défendre une tradition républicaine intransigeante, ces personnalités politiques, intellectuelles ou médiatiques (Emmanuel Macron, Manuel Valls, Alain Finkielkraut, Michel Onfray…) alimenteraient en réalité « des fantasmes de guerre civile qui entérinent l’idée d’une France irréconciliable ».
Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau refusent de leur abandonner l’universalisme et proposent au contraire de le réinvestir pour l’adapter au « peuple postcolonial » qui habite la France aujourd’hui. C’est une gageure, qui nécessite d’aller puiser dans les idées d’auteurs d’horizons variés. Ils nous invitent ainsi à relire aussi bien les classiques du genre (Frantz Fanon, Aimé Césaire et Albert Memmi) que des intellectuels contemporains (Malcom Ferdinand, Sarah Mazouz) et des auteurs majeurs de la philosophie européenne (Diderot, Montaigne et jusqu’à Descartes).
Double jeu
Pour déconstruire la prétention universelle de cette « illusion eurocentrée », les auteurs font d’abord une histoire du concept et de ses usages. Malgré ses fondements humanistes et progressistes, la notion a également servi aux XVIIIe et XIXe siècles, rappellent-ils, à justifier l’esclavage et la colonisation, cette « universalisation de la raison européenne ». Ces derniers appartiennent au passé, mais l’universalisme républicain brandi au XXIe siècle hérite de cette histoire, assurent les auteurs. Il est devenu une idéologie qui ne cible plus de lointains indigènes à « universaliser », mais des segments de la société française jugés comme étrangers à la nation.
Cette idéologie se révèle dès lors conservatrice. Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau soulignent le double jeu de ses partisans, décrits comme des « rentiers de la République », une « police idéologique » incapable « d’abandonner sa mainmise sur la production du discours républicain ». Avec des effets bien réels : « Des outremers aux banlieues, l’universel et l’ordre républicain sont les noms politiquement corrects du contrôle social et de la domination. »
Le livre s’attarde sur deux exemples : le port du voile et la volonté de retirer de l’espace public des statues de personnalités liées à la colonisation et à l’esclavage. Confronté à ces revendications, l’universalisme républicain dénonce une tentation sécessionniste au cœur de la République. Mais cette position, rétorquent les auteurs, est un refus de la diversité des sociétés contemporaines. Elle promeut l’uniformité, rompt avec l’universel et se mue en un « communautarisme de maîtres de lieux ».
En miroir, Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau ébauchent un universalisme réellement universel. Reprenant à leur compte la formule d’Aimé Césaire, ils invitent à penser un « humanisme à la mesure du monde ». A une conception figée, focalisée sur l’histoire et les pensées européennes, ils en opposent une autre, nourrie de la « mosaïque d’expériences » qu’est aujourd’hui la France. Un universalisme vivant, « jamais achevé, toujours à redessiner », qu’ils placent « sous le signe du doute et non de la certitude ».
Malgré la réflexion sans concessions qui la porte, l’ambition pourra sembler utopiste, voire naïve. C’est que sa force ne réside pas dans un cadre politique abouti, mais plutôt dans une méthode et un regard, qui laissent entrevoir, à rebours des querelles actuelles, une société plus apaisée.
Race, par Sarah Mazouz

Présentation de l’éditeur
Les répercussions mondiales de la mort de George Floyd, le 25 mai 2020, l’ont montré : plus que jamais il est utile de défendre un usage critique du mot race, celui qui permet de désigner et par là de déjouer les actualisations contemporaines de l’assignation raciale.
User de manière critique de la notion de race, c’est, en effet, décider de regarder au-delà de l’expression manifeste et facilement décelable du racisme assumé. C’est saisir la forme sédimentée, ordinaire et banalisée de l’assignation raciale et la désigner comme telle, quand elle s’exprime dans une blague ou un compliment, dans une manière de se croire attentif ou au contraire de laisser glisser le lapsus, dans le regard que l’on porte ou la compétence particulière que l’on attribue. C’est ainsi expliciter et problématiser la manière dont selon les époques et les contextes, une société construit du racial.
Si le mot a changé d’usage et de camp, il demeure cependant tributaire de son histoire et y recourir de manière critique fait facilement l’objet d’un retournement de discrédit. Celles et ceux qui dénoncent les logiques de racialisation sont traité·es de racistes. Celles et ceux qui mettent en lumière l’expérience minoritaire en la rapportant à celle des discriminations raciales sont accusé·es d’avoir des vues hégémoniques. Dans le même temps, les discours racialisants continuent de prospérer sous le regard indifférent de la majorité.
Si le mot de race sert à révéler, y recourir est donc d’autant plus nécessaire dans le contexte français d’une République qui pense avoir réalisé son exigence d’indifférence à la race et y être parfaitement « aveugle », « colour-blind », dirait-on en anglais.
Sarah Mazouz, Race, par Aurélia Michel
Note de lecture de la revue Le Mouvement social, publiée le 22 mars 2022.
Source
C’est un petit objet noir gravé de blanc, qui vaut autant pour son contenu que pour son contexte, et dont le texte de Sarah Mazouz, clair et direct, articule parfaitement les enjeux. Race s’inscrit dans une collection d’ambition, lancée en 2019 par les éditions Anamosa, qui parie sur le mode des keywords de Raymond Williams pour, à partir d’un mot, proposer à la fois une réflexion, la diffusion de savoirs scientifiques et une clé d’émancipation.
Septième opus après Révolution, Peuple, Histoire, Démocratie, Science et École, le livre de Sarah Mazouz est à la fois une contribution sociologique, une intervention dans le débat public et un événement éditorial qui participe d’une séquence historique en cours : il est probable en effet que, quelques années avant la mort de Georges Floyd en juin 2020, un tel titre aurait été reçu comme une provocation, et il est désormais évident, depuis la sortie du livre en septembre de cette même année et l’accueil immédiat qui lui a été fait, que nous ne pourrons pas nous passer du mot « race » pour la compréhension de nos sociétés.
C’est précisément sur ce point de bascule que s’ouvre le premier chapitre de ce court texte, à tel point qu’il a décidé de la date de publication du livre, retardée de quelques mois afin de s’inscrire dans les débats déterminants qui ont suivi la mobilisation transnationale après la mort de George Floyd pour dénoncer le racisme. Sarah Mazouz rappelle l’importance des répercussions de cette mobilisation en France, notamment dans les réactions très marquées dans plusieurs médias nationaux qui visaient à contester une possible articulation avec la situation étasunienne et à délégitimer, parfois avec grande violence, les mouvements dénonçant les bavures policières et plus largement le racisme dans la société française. Le fait que ce positionnement de réaction ait été largement endossé par le gouvernement, à travers ses ministres de l’Éducation Jean-Michel Blanquer ou de l’Enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal, n’est certainement pas un aspect à minimiser, puisqu’il a conduit, comme le rappelle l’auteure, à une inédite et confuse mise en question de l’autonomie de la recherche et de l’enseignement à l’université.
L’enjeu donc, de l’utilisation du mot « race » et de la clarification de son contenu, dépasse largement le débat intellectuel qui oppose divers courants des sciences sociales, débat dont Sarah Mazouz donne les coordonnées en développant son propre positionnement. Un premier point, préalable à la discussion, aborde la nécessité du mot pour désigner des rapports sociaux actuels, dès lors que les théories raciales sont en tant que telles dépassées, invalides et dangereuses, comme si le mot lui-même pouvait performer le racisme que l’on entend déconstruire. Ces théories, que l’auteure résume par la croyance en une « hiérarchie entre groupes humains qui pourrait être fondée en nature » (p. 24) et qui s’appuient sur l’existence présumée « des races » (p. 18), ne suffisent pourtant pas à désigner la domination raciste, ou plutôt les rapports sociaux qui engagent une « assignation raciale » (p. 22), assignation qui n’a pas besoin de la théorie raciale pour s’exercer. Reprenant deux textes fondateurs de la sociologie du racisme, celui de Colette Guillaumin, « Je sais bien mais quand même », et celui de Philomena Essed sur le racisme du quotidien, Sarah Mazouz nous invite à saisir la réalité de la race dans les pratiques sociales, parfois anodines, parfois violentes, qui mettent en jeu « la forme sédimentée, ordinaire et banalisée » (p. 22) de l’assignation raciale, et que seul le mot « race », lui-même sédimenté par une longue histoire européenne coloniale et esclavagiste, permet de révéler.
Car il s’agit ici de « nommer une pratique de pouvoir », c’est-à-dire « pointer la manière dont certains membres du groupe sont infériorisé·es » (p. 31), pratique de pouvoir qui se conjugue systématiquement à d’autres – classe, genre, validité, pour ne nommer qu’elles. C’est de cette manière que l’on peut analyser « la racialisation comme condition sociale » (p. 40), et ainsi caractériser des groupes sociaux dont les interactions, les expériences, les trajectoires seraient déterminées par cette condition – toujours parmi d’autres, celle du genre, de la classe, de l’orientation sexuelle, etc.
Cette courte et limpide leçon de sociologie devrait permettre de faire admettre au plus grand nombre la « notion critique de race » (p. 80) et son usage. Pourtant, ainsi que poursuit l’auteure, cet usage continue de déclencher en France les plus vives réactions, et au-delà des crispations caricaturales dans diverses tribunes, suscite un débat intellectuel qu’il ne faut pas évacuer. Plusieurs reproches sont signalés par Sarah Mazouz : c’est d’abord le fait que la race, si on veut bien la reconnaître dans d’autres espaces, et en premier lieu les États-Unis, n’existerait pas dans les rapports sociaux en France, ou en tout cas pas de manière prioritaire. En outre, lui faire trop de place dans les analyses et les observations participerait à sa réification, voire son activation dans les relations sociales, et en tout état de cause abonderaient des logiques « identitaires » qui seraient portées par les mondes militants de l’antiracisme dit politique, et dont les concernés et concernées deviendraient alors les captifs. Autrement dit, analyser la race comme rapport social contribuerait à produire une conscience de race – processus que les sciences sociales ont reconnu depuis longtemps à propos de la classe comme un levier d’autonomisation – et serait facteur de divisions sociales et vecteur de conflits – ce que tout mouvement d’émancipation ne peut manquer d’être mais qui semble pour certains une intolérable atteinte à l’intégrité de la communauté nationale et républicaine. Enfin, un autre type de reproche, formulé notamment par l’historien Gérard Noiriel, consiste à pointer le risque d’ainsi manquer la cible principale de la déconstruction des dominations, qui restent fondamentalement liées à la position des acteurs dans les rapports de production, position que la race contribue à déterminer, mais seulement parmi d’autres facteurs.
Or, l’approche critique de la race entend montrer que précisément les rapports de race participent pleinement aux positions dans les rapports de production, et parfois aussi, ainsi que le montrent les propres travaux sociologiques de l’auteure, les dépassent, c’est-à-dire que malgré des positions comparables ou inversées, l’assignation raciale vient rectifier et modifier les hiérarchies de classe ou de statut. Enfin, et ce n’est pas le moindre argument, ces processus d’assignation sont perçus et dénoncés par les personnes concernées, et méritent au moins pour cette raison d’être pris en compte pour eux-mêmes dans l’analyse (p. 79).
C’est ainsi que Sarah Mazouz invite à une opération générale de « transposition minoritaire », rappelant la nécessité à la fois épistémologique et politique de l’effort intellectuel de prendre le point de vue des dominés pour comprendre une situation globale – en cela le parallèle entre les mécanismes du sexisme et du racisme est toujours très efficace – et ainsi assumer que l’universalisme qui s’affirme aveugle à la couleur et procède par abstraction des individus, « de leurs affiliations et de leurs identités » (p. 81), est en fait un particularisme de la majorité, qui organise les normes assurant le renouvellement des structures de pouvoir.
Au-delà de la mise au point sociologique et des éventuelles discussions qu’elle peut susciter dans la discipline, le livre de Sarah Mazouz a rapidement été identifié et utilisé par de nombreux auteurs comme le positionnement d’un antiracisme qui se définit par référence à une histoire coloniale. De fait, les questions vives sur le racisme qui renouvellent actuellement nos approches sont portées par une génération qui fait face aux conséquences de la migration postcoloniale en Europe. Or, accepter cette perspective suppose pour d’autres chercheurs de renoncer aux enjeux auxquels ils ou elles se sont identifiés au début de leur carrière, dans un contexte politique différent. Le débat historiographique qui prend une certaine ampleur autour de la race reflète lui aussi les difficultés d’un changement lexical et de la conflictualité charriée par le mot lui-même. Des approches historiques variées de la race témoignent de diverses inquiétudes : ne risque-t-on pas de désarrimer la race de l’antisémitisme alors que ce dernier a été jusqu’alors l’objet constitutif de la critique du racisme ? La notion de race ne mobilise-t-elle pas d’autres aspects de l’histoire européenne – l’histoire des idées, l’histoire des sciences, l’histoire politique – qui auraient leur propre dynamique ? Est-il pertinent de centrer l’analyse sur un terme confus qui a changé plusieurs fois et radicalement de sens en trois siècles ? Dans ce contexte, le livre de Sarah Mazouz dialogue très bien avec une historiographie qui s’intéresse aux rapports sociaux forgés par l’histoire coloniale – rappelons que c’est l’histoire européenne depuis le début de l’époque moderne et qu’elle inclut l’usage massif de l’esclavage. Il a ainsi la grande vertu de mettre un mot, certes faible mais indispensable, sur la chose : la reproduction de rapports de domination dans nos sociétés.