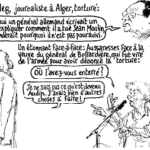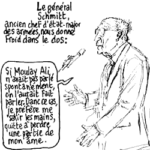Communiqué de la LDH
Paris, le 25 janvier 2002,
La LDH se félicite d’un jugement qui reconnaît l’existence de crimes de guerre commis par des militaires durant la guerre d’Algérie. Ce jugement porte aussi condamnation de tous ceux qui considèrent que la torture, les exécutions sommaires et les enlèvements seraient admissibles dans certaines circonstances.
Mais cette décision ne rend pas compte, et ne pouvait rendre compte, de tous les errements qu’a connus cette guerre coloniale faite à un peuple qui réclamait sa liberté. Sans doute, les victimes ne trouveront pas dans cette décision la reconnaissance à laquelle elles ont droit.
La LDH espère que cette décision sera un des premiers pas en direction de la vérité et de la reconnaissance des responsabilités de tous ceux qui ont mené cette sale guerre.
Les motivations du jugement sont sévères.
Après avoir écarté les problèmes de forme, le tribunal, présidé par Catherine Bezio, s’est longuement penché sur l’apologie des crimes de guerre. Un délit de presse, puisque les crimes d’Algérie sont, en l’état actuel du droit français, amnistiés et prescrits. Pour le tribunal, l’apologie du crime de guerre consiste à le présenter « de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable, effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à ce crime ». Que la torture et les exécutions sommaires soient prescrites ou amnistiées importe peu, le délit d’apologie, insiste les juges, « pouvant avoir trait à des crimes réels, passés, ou simplement éventuels ».
Ci-dessous des extraits du jugement :
A deux reprises, dès le début de son récit, Paul AUSSARESSES vient compléter cette présentation de la torture, ainsi qualifiée d’inéluctable, par un commentaire personnel légitimant cette pratique. Ces passages, visés par la citation (p.30 et 31 – p.44 et 45) décrivent, l’un, l’initiation de Paul AUSSARESSES à la torture par les policiers de PHILIPEVILLE, l’autre, la scène où, pour la première fois, le prévenu, lui-même, torture un prisonnier :
-Pages 30 et 31 « Les policiers de Philippeville utilisaient donc la torture, comme tous les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait. Ces policiers n’étaient ni des bourreaux ni des monstres mais des hommes ordinaires. Des gens dévoués à leur pays, profondément pénétrés du sens du devoir mais livrés à des circonstances exceptionnelles. Je ne tardai du reste pas à me convaincre que ces circonstances expliquaient et justifiaient leurs méthodes. Car pour surprenante qu’elle fût, l’utilisation de cette forme de violence, inacceptable en des temps ordinaires, pouvait devenir inévitable dans une situation qui dépassait les bornes. Les policiers se tenaient à un principe : quand il fallait interroger un homme, qui, même au nom d’un idéal, avait répandu le sang d’un innocent, la torture devenait légitime. »
-Pages 44 et 45 « … Je n’ai pas eu de haine ni de pitié. Il y avait urgence et j’avais sous la main un homme directement impliqué dans un acte terroriste : tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça. »
Placés en tête de récit, ces propos exposent une réflexion générale de l’auteur sur la torture […] Les deux passages en cause justifient, de la même manière, la commission des actes de torture ainsi décrits, dans la mesure où ceux-ci sont présentés non seulement comme inévitables (p.30 « inacceptable en temps ordinaires, [cette forme de violence] pouvait devenir inévitable » – p.44 : « j’ai été conduit à user de moyens contraignants ») mais aussi comme légitimes (p.31 « la torture devenait légitime dans les cas où l’urgence l’imposait » – p.45 : « il y avait urgence[…] tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça »).
En dépit des prétentions contraires de Paul AUSSARESSES, cette véritable pétition de principe, posée en exergue de son ouvrage, qui légitime expressément l’usage de la torture et toutes autres exactions permettant l’élimination physique immédiate de l’adversaire, valorise, par avance, l’ensemble des actes perpétrés et décrits dans les pages suivantes du livre ; elle a ainsi, pour effet d’ôter, aux yeux du lecteur, la réprobation morale inhérente à ces actes, – condamnés sans réserve par la communauté internationale dans les textes rappelés ci-dessus.
L’apologie, pour le tribunal, est caractérisée. Non parce que le général n’a pas de regrets, ce qui « ne relève que du domaine de la morale et de la conscience », mais parce que la torture, « qualifiée d’inéluctable », est accompagnée « par un commentaire personnel légitimant cette pratique ».
Paul Aussaresses est par ailleurs « l’acteur d’un passé qu’il ne s’agit plus de juger », mais « ces actes et ces pratiques, bien que hors-la-loi, apparaissent avoir été connus et tolérés par les plus hautes autorités militaires et politiques de l’Etat français, de surcroît jamais sanctionnés, et amnistiés depuis plus de trente ans ».
________________________________________
Voici les comptes-rendus des audience parus dans Le Monde.
LA TORTURE AU COEUR DES DÉBATS
[Le Monde, 28 novembre 2001]
Le « calvaire » des victimes de la torture, mais aussi celui des soldats « obligés » par leur hiérarchie à torturer pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) ont été évoqués, mardi 27 novembre, au procès du général français Paul Aussaresses pour « complicité d’apologie de crimes de guerre ».

Au deuxième jour du procès de Paul Aussaresses, la veuve du général Jacques de Bollardière, l’un des rares officiers français à avoir dénoncé la torture pendant cette guerre, a raconté « le calvaire » des soldats français « obligés » par leur hiérarchie à pratiquer ces exactions. Tremblante et visiblement émue, Simone de La Bollardière a affirmé qu’ « aujourd’hui encore, ils n’en parlent pas parce qu’ils sont démolis. Il y a un abcès à l’intérieur d’eux, ils n’ont jamais vu de psychologue ».
Elle a ensuite accusé Paul Aussaresses, 83 ans, qui a servi sous les ordres de son mari pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), de « se vanter » d’avoir pratiqué la torture, ce que ce dernier a aussitôt nié. Henri Alleg, 80 ans, journaliste et militant communiste arrêté et torturé par les parachutistes durant le conflit, a également été entendu à la demande des parties civiles. Pudique sur le sort qu’il a subi durant un mois dans une villa de la région d’Alger – « électricité, étouffement sous l’eau, coups » -, il a évoqué « les cris » des Algériens qui subissaient le même sort. « C’est ce souvenir, encore plus qu’un autre, qui est resté dans ma mémoire », a-t-il dit. Pédagogue, auteur du célèbre ouvrage La Question, l’un des premiers témoignages sur ces sévices, publié en 1958, M. Alleg a aussi indiqué que la torture était une pratique « institutionnalisée » par l’armée française.
RETOUR SUR L’AFFAIRE AUDIN

M. Alleg et Mme de Bollardière ont encore demandé au général Aussaresses ce qu’il était advenu de Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien, disparu depuis 1957, après avoir été arrêté le 11 juin de cette même année à Alger parce que suspecté d’aider le FLN. « Je ne sais pas ce qu’est devenu Maurice Audin », a répété le général Aussaresses, sans convaincre.
Aucune explication officielle n’est donnée sur la disparition de ce père de trois enfants, si ce n’est « son évasion au cours d’un transfert ». Selon le quotidien communiste L’Humanité, Maurice Audin est mort le 21 juin 1957, « à la villa El Biar à Alger, entre les mains d’un tortionnaire, un lieutenant parachutiste de l’armée française, qui l’avait étranglé ». « Le tortionnaire a même été fait commandeur de la Légion d’honneur », affirmait le journal le 4 décembre 1997.
A l’époque des faits, Paul Aussaresses était responsable des renseignements français à Alger, sous les ordres de Jacques Massu.
LE GÉNÉRAL SCHMITT A JUSTIFIÉ L’USAGE DE LA TORTURE EN ALGÉRIE
par Franck Johannès [Le Monde, le 29 novembre 2001]
Plusieurs témoins sont venus, mardi 27 novembre, défendre l’honneur de Paul Aussaresses. Le général Maurice Schmitt a justifié l’usage de la torture en Algérie au nom de « la légitime défense d’une population en danger de mort ». Henri Alleg a, lui, évoqué l’horreur des sévices qu’il a subis après son arrestation, en 1957.
Un quarteron de généraux en retraite bat la semelle devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ils ont une apparence : courbés, chenus, décorés, à moitié sourds, plein de souvenirs et d’arthrite. Mais, en réalité, ils sont prêts comme au premier jour à défendre l’honneur de la patrie, et de leur camarade Paul Aussaresses, poursuivi pour « complicité d’apologie de crimes de guerre » après son livre sur l’Algérie.
Au deuxième jour du procès, mardi 27 novembre, chacun est venu donner son grain de sel, y compris un copain restaurateur qui connaît bien le général Aussaresses depuis deux ans. Et la torture, qu’on croyait crime de guerre, est désormais une opinion : le général Schmitt, par exemple, est plutôt pour, dans les cas exceptionnels naturellement.
Henri Alleg est, lui, plutôt contre, d’autant qu’il y est passé, et certains de ses amis en sont morts. C’est un petit homme à l’œil vif, de quatre-vingts ans sonnés, qui était directeur d’Alger républicain , un journal vite interdit. Il a été arrêté en juin 1957 chez Maurice Audin, dont on n’a jamais retrouvé le corps, et a été torturé « à l’électricité, par noyade ou plutôt étouffement sous l’eau, avec des torches de papier ». Personne n’ose lui demander d’expliquer. « J’entendais hurler, j’entendais les cris des hommes et des femmes pendant des nuits entières, c’est cela qui est resté dans ma mémoire », a raconté le vieux monsieur, resté un mois dans un « centre de tri ». Il a passé trois ans en prison, a fait sortir feuille à feuille son livre, La Question, avant d’être condamné à huis clos à dix ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État. Et association de malfaiteurs, ça me fait toujours rire, mais c’est comme ça ».
La guerre d’Algérie, « que l’on présentait comme un combat pour notre civilisation, c’était en fait une guerre contre l’indépendance d’un peuple, menée avec les méthodes des occupants nazis ». Henri Alleg a expliqué que Larbi Ben M’Hidi, tué par Paul Aussaresses, était le Jean Moulin algérien. « Si un général allemand comparaissait aujourd’hui pour dire comment il avait suicidé Jean Moulin, tout le monde se demanderait pourquoi on le juge seulement pour apologie de meurtres alors qu’il en a commis tellement. » Et il a mis en garde les jeunes contre le retour de la torture, « un retour à la barbarie, au nom de la civilisation ou de la lutte contre la barbarie » . Le vieux monsieur a été digne, profond, touchant. Mais il a été communiste, et la salle, assez largement acquise au général Aussaresses, en a frissonné d’indignation. Me Gilbert Collard, pour Paul Aussaresses, a enfoncé le clou en expliquant qu’en 1962 Henri Alleg collaborait à la Pravda : courte manœuvre, tombée à plat, d’autant qu’il avait seulement donné une interview.
« PERDRE MON ÂME »
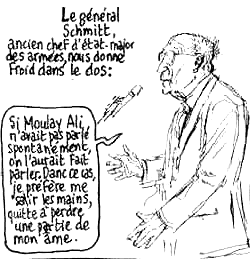
Après un défilé, assez uniforme, des compagnons de Paul Aussaresses à travers les âges, l’autre témoin majeur est venu déposer. Le général Maurice Schmitt, soixante et onze ans, est un calibre : saint-cyrien, prisonnier à Dien Bien Phu, lieutenant au troisième régiment de parachutistes coloniaux à Alger en 1957, il a aussi été chef d’état-major des armées de 1987 à 1991, c’est-à-dire le plus haut responsable militaire de son temps. Et le général ne tourne pas autour du pot : « Les membres du FLN, avant d’être des terroristes, étaient des tortionnaires. » Il suggère assez rudement que Louisette Ighilahriz, violée et torturée, a menti et que « tout ceci est une affaire montée ». S’il « n’est pas contestable » qu’il y a eu de la torture en Algérie, c’était « de la légitime défense d’une population en danger de mort ».
Le général Schmitt est d’ailleurs prêt à recommencer : « S’il faut se salir les mains ou accepter la mort d’innocents, a énoncé le militaire, je choisis de me salir les mains au risque de perdre mon âme. » D’ailleurs, « si Moulaï Ali -le responsable d’un réseau de poseurs de bombes- n’avait pas parlé, je l’aurais fait parler. Il y a des cas limites ou vous avez le choix entre la mort d’une centaine d’innocents et un coupable avéré ». Maurice Schmitt est lui-même accusé d’avoir torturé la jeune Malika Koriche (Le Monde du 29 juin), mais la question lui a été à peine posée et n’intéresse guère le tribunal. Pourtant, a relevé Me Henri Leclerc pour la Ligue des droits de l’homme, le général Massu lui-même s’est interrogé sur la nécessité de la torture. « Massu aurait dû se poser la question quand il était à la tête de la dixième division parachutiste », a répondu rudement le général.
La substitut a réclamé 100 000 francs d’amende pour chacun des prévenus, le général Aussaresses et ses éditeurs. Le jugement sera prononcé le 25 janvier.