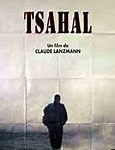[marron] Après avoir combattu très jeune dans un maquis de la Résistance, Claude Lanzmann a soutenu la lutte d’indépendance des peuples colonisés, en particulier du peuple algérien. Signataire, en septembre 1960, du « Manifeste des 121 », « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie », il a fait partie des dix personnes qui ont été inculpées pour l’avoir signé.
[marron]Il a témoigné lors du « procès Jeanson » ouvert à Paris, le 6 septembre 1960, devant le tribunal permanent des forces armées, dans la salle de la prison du Cherche-Midi où avait été condamné Alfred Dreyfus. Etaient jugés, en même temps que six algériens, dix-neuf membres du réseau de soutien au FLN coordonné par le philosophe Francis Jeanson, arrêtés à partir de février 1960. Leurs avocats avaient demandé le 14 septembre l’audition d’un certain nombre de signataires du « Manifeste des 121 » pour qu’ils expliquent au tribunal pourquoi ils avaient justifié des actes tels que ceux reprochés aux accusés. Claude Lanzmann y a déposé le 21 septembre, témoignant notamment en faveur de l’un des inculpés, Jean-Claude Paupert, qu’il connaissait depuis leur adolescence. Paupert avait fait la guerre d’Algérie puis s’était engagé ensuite dans le soutien au FLN. [/marron]
Claude Lanzmann intervient à plusieurs reprises dans le documentaire de Mehdi Lallaoui, « Le Manifeste des 121 » réalisé en 2011
(25’34 » à 27’02 » ; 32’13 » à 33’31 » et 45’45 » à 46’08 »)
[marron] Nous publions ci-dessous le texte de la déposition de Claude Lanzmann telle qu’on peut la reconstituer à partir de ce qui a été publié dans le livre écrit par François Maspero, « Le droit à l’insoumission (le dossier des « 121 ») », éditions François Maspero, Cahiers libres, n°14, 1961, et dans l’autre livre qu’il a publié peu après, « Le procès du réseau Jeanson », présenté par Marcel Péju, éditions François Maspero, Cahiers libres, 1961 (réédition, La Découverte, 2002) — tous deux aussitôt interdits. Claude Lanzmann y emploie le mot de « génocide » à propos de l’action de l’armée française en Algérie et déclare que Jean-Claude Paupert a eu raison de faire ce qu’il a fait après avoir participé à cette guerre.
[marron]Pour expliquer et justifier la nécessité pour un ancien appelé de l’armée française en Algérie comme Jean-Claude Paupert de faire des choix qui lui permettaient de revivre après cet épisode, il a tenu, au début de sa déposition et en accord avec les avocats, à faire un long détour par l’évocation d’autres crimes contre l’humanité : ceux du nazisme dont il a pu constater les dégâts une dizaine d’années auparavant en Allemagne. Il a voulu, à travers deux longues anecdotes, soulever la question de la nécessité pour ceux à qui il a été demandé de commettre des crimes sur ordre d’échapper à la « mort intérieure » dans laquelle ces crimes — des crimes que la société « ne voyait pas », qu’elle « ne voulait pas voir » — les avaient eux-mêmes plongés.
[marron]Au début de sa déposition, il réagit à la déclaration du Commissaire du gouvernement qui avait dit, lors de l’audience du 14 septembre, que l’audition de certains signataires du « Manifeste des 121 » demandée par les avocats constituait « une injure au tribunal ». [/marron]
La déposition de Claude Lanzmann au « procès Jeanson »
M. Lanzmann. — Avant de prêter serment, et avant de commencer ma déposition, je voudrais dire un mot. C’est important pour moi de savoir, en effet, si ma présence à cette barre est considérée comme injurieuse pour le tribunal que vous présidez. Vous comprendrez que si c’est effectivement le cas et que si c’est insultant de par ma seule présence, il me soit difficile de déposer dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises, sans haine et sans crainte comme le veut la formule de serment que vous me demandez de faire.
M. le Président. — Vous êtes appelé ici comme témoin régulièrement cité. Vous appartenez aux débats. Je vous ai fait prêter serment. Le seul fait que vous soyez là implique qu’il n’y ait rien d’injurieux dans votre présence.
M. Lanzmann. — Je vous remercie…
M. le Président. — Faites votre déposition.
M. Lanzmann. — J’en prends acte et je le jure…
Me Vergès. — Une question pour commencer. Le témoin, je crois, a été lecteur de philosophie à l’Université libre de Berlin. Je crois qu’il a eu, dans cette Université libre de Berlin, des étudiants allemands qui avaient fait la dernière guerre et qui avaient « pacifié » toute l’Europe. Je pense qu’il serait intéressant, puisqu’il est question ici des problèmes de conscience transformés en actes des accusés, que le témoin puisse nous dire son expérience de ces jeunes soldats allemands devenus étudiants.
M. Lanzmann. — J’ai été effectivement lecteur de l’Université libre française de Berlin, une année, en 1950. Il y avait là-bas des étudiants qui étaient tous beaucoup plus âgés que moi, pour une très simple raison, c’est qu’ils avaient fait la guerre dans les armées d’Hitler et qu’ils avaient donc, au bas mot, six à sept ans de guerre ; quelques-uns avaient davantage encore, car outre la guerre, ils avaient connu les camps de prisonniers : certains avaient été prisonniers en France, d’autres aux Etats-Unis, d’autres encore en Union soviétique.
Je me souviens très bien — et c’était quelque chose d’assez affreux — que ces hommes étaient morts, Monsieur le Président. Ils étaient intérieurement morts. Je suis devenu leur ami. Beaucoup d’entre eux m’ont raconté leurs expériences. Je me souviens très bien d’un garçon qui s’appelait Hans Erfeld. Hans Erfeld avait été Jeunesse Hitlérienne, comme tous les enfants allemands pendant le nazisme. Ensuite il avait été sur le front russe et là-bas il avait assisté, en tant que témoin d’abord, en tant que participant ensuite, aux pendaisons en chaîne de Partisans soviétiques. C’était la première chose.
La seconde, c’est qu’il avait aidé à former des convois de déportés, ces convois de déportés qu’on emmenait à Auschwitz et ailleurs.
Il était revenu à Berlin. Il avait été prisonnier en URSS d’abord, puis était revenu et n’avait pas été jugé comme criminel de guerre. Il n’avait pas un grade assez important, il avait réussi à passer au travers.
Il m’avait raconté tout cela, c’était sa confession. Pas besoin de vous dire que ma première réaction avait été de le fuir, de lui tourner le dos et de le haïr. J’avais en outre des raisons personnelles de le faire. Mais il était mon étudiant et, de toute façon, j’étais obligé de lui parler comme aux autres.
Dans ses devoirs, dans ses explications de textes, je lui faisais expliquer Stendhal, je me souviens, il essayait de comprendre et il avait du mal. Un jour il est venu me trouver et m’a dit : « Monsieur, je suis un homme mort. Je ne vis plus. J’ai honte de ce que j’ai fait. Je suis torturé, poignardé en permanence par le remords. Essayez de me sauver sinon je me tuerai ».
Alors, j’ai fait ceci, Monsieur le Président : je me suis arrangé pour lui faire obtenir une bourse d’études en France, bourse que j’avais demandée au ministère des Affaires étrangères. Hans Erfeld est donc parti pour Paris et je ne l’ai plus revu. Je ne l’ai plus revu en Allemagne du moins, mais je l’ai rencontré un jour, tout à fait par hasard, quatre années plus tard sur le boulevard Saint-Michel. Il était heureux. Il était transformé. Il me dit : « Venez chez moi, Monsieur, venez chez moi, je vais vous montrer ma femme et mes enfants. » Je suis allé chez lui et il m’a dit : « Est-ce que vous savez ce qui m’est arrivé ? »
— Non, je ne le sais pas. Vous êtes marié, vous êtes père de famille ?
— Oh ! Monsieur, c’est beaucoup plus que cela : j’ai épousé une Juive. »
C’était une histoire. Mais Erfeld est le seul à en être sorti. Les autres, de toute façon, ne pouvaient plus être des hommes parce qu’ils avaient été complices de trop de crimes et de trop d’horreurs.
C’est la première anecdote. J’en ai une seconde.
J’ai eu là-bas comme étudiante une jeune fille qui avait 19 ans, elle s’appelait Von Neurath. Elle était la nièce du ministre des Affaires étrangères d’Hitler, le baron Von Neurath, c’est-à-dire la fille du frère du baron. Le frère du baron était général dans l’armé nazie. Elle m’avait invité une fois dans sa maison de Stuttgart ; ses parents étaient propriétaires d’un immense domaine, cette propriété foncière allemande avec des centaines de serviteurs. J’ai déjeuné avec ces nazis. Il y avait le général tout récemment libéré ; il avait été condamné à Nuremberg à quatre ou cinq ans de prison et il venait de sortir. Le général n’avait rien appris. Dès le début du déjeuner il a commencé, je ne sais plus pourquoi… Nous parlions de l’Italie : « Ah ! je déteste les Italiens… »
Dans l’après-midi, j’ai été me promener avec la petite… Elle m’a dit : « Je voudrais vous montrer quelque chose ». Elle m’a emmené. Il y avait à quelques kilomètres du domaine un camp de concentration. Je ne me souviens plus du nom de ce camp. Je veux simplement rappeler qu’outre les grands camps très célèbres comme Auschwitz, Dachau, Buchenwald, il y avait en Allemagne une infinité de petits camps ; on y tuait, on y gazait, on y massacrait. La jeune fille, donc, s’est promenée avec moi dans ce camp et elle me disait : « Comment se fait-il ?… Comment est-ce possible ?… Comment n’avons-nous rien dit ?… Comment n’avons-nous rien fait ?… Pourquoi n’avons-nous pas lutté contre ?… »
De toute façon, elle était trop jeune. Mais elle me demandait comment il se faisait que les intellectuels allemands, les écrivains allemands, les magistrats allemands, tous ceux qui sont considérés d’ordinaire comme l’élite d’un pays, avaient tous accepté sans broncher, sans protester, le génocide, le massacre.
C’était une enfant de 19 ans qui me posait la question.
Qu’est-elle devenue plus tard ? C’est tout à fait intéressant. Elle voulait racheter les fautes et les crimes de ses pères. Elle vit aujourd’hui dans un kiboutz en Israël. Elle vit là-bas depuis… De toute façon elle ne pouvait plus rien pour tous ceux qui étaient morts, partis en fumée, elle ne pouvait plus faire qu’une opération de rachat personnel, d’ordre purement moral, si vous voulez celui-là.
Et ses camarades, à partir du moment où ils eurent compris que la France en Algérie se livrait à des opérations de caractère identique et qu’on peut appeler sans abus de langage un génocide avaient le droit et le devoir…
[marron] Se produit à ce moment une intervention du Président du tribunal qui proteste contre l’emploi par Claude Lanzmann du mot « génocide ». François Maspero écrit dans le premier livre cité : « Protestation du Président ». Vue la réponse de Claude Lanzmann, il l’interrompt probablement en disant quelque chose comme : « Vous n’avez pas le droit d’employer le mot de « génocide » à propos de l’action de l’armée française en Algérie ! » [/marron]
… Je le dirai tout de même, Monsieur le Président…
[marron] François Maspero se limite dans son livre à la reproduction de ce début de la déposition de Claude Lanzmann. La phrase suivante, la dernière citée, répond probablement à une question de l’un des avocats lui demandant ce qu’il pensait des faits reprochés aux accusés. [/marron]
Ils avaient le droit et le devoir de faire ce qu’ils ont fait.
[marron] C’est dans l’autre ouvrage cité que se trouve le reste de sa déposition. Il répond probablement à une question lui demandant : « Connaissez-vous l’un des inculpés, M. Jean-Claude Paupert ? » [/marron]
M. Lanzmann. — Jean-Claude Paupert était mon ami et je n’ai pas besoin d’ajouter qu’il l’est toujours. Je l’ai connu en 1948 : il avait 16 ans, j’en avais 24. Ma mère, chez laquelle je vivais, habitait en face de chez ses parents, c’est-à-dire en face du café dont M. Paupert était le propriétaire. Avant de me rendre à la Sorbonne, où je faisais mes études, j’allais le matin prendre mon café chez M. Paupert père. Il aurait souhaité que son fils prenne sa succession, et sans doute un avenir tout à fait paisible de cabaretier se serait-il ouvert à Jean-Claude. Pourtant, quelque chose n’allait pas, parce que cet adolescent était un intellectuel. Il avait cessé, à cette époque, de faire des études régulières. Mais je me suis pris d’amitié pour lui et je l’ai emmené chez moi. Je l’ai fait travailler, je l’ai fait étudier et nous lui avons prêté des livres. C’étaient sans doute de bien mauvais livres puisqu’ils l’ont conduit où il se trouve actuellement. C’étaient Le Discours de la Méthode et Les Méditations de Descartes, L’Esprit des Lois de Montesquieu, les œuvres de Voltaire et bien d’autres encore. Ensuite, je l’ai perdu de vue, et je l’ai retrouvé lorsqu’il a été rappelé en Algérie, c’est-à-dire en 1955. Il avait déjà un conflit : il ne voulait pas partir. Il pensait que, là-bas, on n’avait rien à défendre et il avait compris que le système colonial ne lui permettrait pas de se conduire comme un homme libre.
Il est parti néanmoins. Et il parait que M. Le Commissaire du gouvernement a posé à tous les accusés une seule et même question : « Avez-vous été en Algérie ? » On peut d’abord se demander s’il est nécessaire d’être passé par les chambres à gaz pour savoir que les camps de concentration allemands existaient. Mais il se trouve que Jean-Claude, lui, est parti en Algérie faire son service.
Je l’ai revu au cours d’une permission et je puis affirmer que ce n’était plus du tout le même garçon. J’imagine que, quand M. le Commissaire du gouvernement demande aux accusés s’ils ont été en Algérie en espérant qu’ils répondront non, il a quelque chose dans la tête. Il doit penser à l’œuvre civilisatrice de la France, ou aux « atrocités terroristes ».
Il se trouve que Jean-Claude Paupert, en Algérie, et dès le premier jour, a vu tout autre chose. Ce qu’il a vu, c’est l’oppression d’un peuple, c’est la détresse et la vieillesse dans les yeux des enfants ; c’est la haine dans les yeux des hommes. Et il a compris très vite que ce que revendiquaient ces hommes, ce n’était pas d’être des Français à part entière, mais des hommes à part entière. Et il a compris en même temps que la revendication de leur humanité par les Algériens passait nécessairement par la revendication de leur indépendance.
J’ai revu Jean-Claude à son retour d’Algérie et déjà j’avais compris qu’il ne pourrait plus vivre comme il vivait autrefois. Car il y a deux races d’hommes : ceux qui pensent qu’ils ne peuvent être des hommes qu’à condition d’avoir des dignités, des grades, des supériorités. C’est ce qu’il avait vu là-bas : la minorité européenne opprimant la majorité musulmane. Et puis il y en a d’autres, dont il est, qui, au contraire, n’arrivent pas à se sentir des hommes à partir du moment où ils savent que d’autres sont opprimés. Et, faisant cela, il n’était sûrement pas en contradiction avec ce pourquoi nous avions combattu pendant la Résistance et dont je lui avais moi-même parlé.
Je dis que mon ami Rouchon, élève de philosophie au lycée Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand, tué le 9 août 1944 à mes côtés, à Saint-Jacques-des-Blats, dans un maquis du Cantal, était le frère de Jean-Claude Paupert jugé ici par un tribunal militaire.
Me Likier. — M. Lanzmann, qui a bien connu M. Paupert, qui a vécu son drame de conscience, et qui a été tenu au courant de tout ce qu’il a vu en Algérie, peut-il nous dire s’il approuve son action ?
M. Lanzmann. — Totalement. Il me semble que cela ressort très clairement de ce que j’ai dit.
[marron] Dans le « Grand entretien » du 10 mars 2011 sur France inter, François Busnel interroge Claude Lanzmann sur l’appréciation qu’il porte vis-à-vis du général de Gaulle et aussi (dans la séquence de 13’50 » à 26’29 ») sur son anticolonialisme durant la guerre d’Algérie et sa relation avec le militant anticolonialiste Frantz Fanon. [/marron]

[marron] En même temps, Claude Lanzmann était « viscéralement attaché » à l’Etat d’Israël, au point de ne pouvoir porter un regard critique sur les pratiques coloniales dans lesquelles l’occupation des territoires palestiniens occupés après 1967 l’a plongé. Il ne séparait pas l’Etat d’Israël de la tragédie de la Shoah. Ne voyant pas que le projet sioniste dans les dernières années du XIXe siècle proposait non seulement un refuge à des persécutés mais s’inscrivait aussi dans le contexte de l’idéologie coloniale européenne qui a continué à marquer une partie des mentalités et de l’histoire de cet Etat. Son film « Tsahal », réalisé en 1994, a donné prise, sur ce point, à de sérieuses critiques. [/marron]
« Tsahal »,
réalisé par Claude Lanzmann
On n’aime pas
Critique parue dans l’hebdomadaire Télérama lors de la sortie en salle de ce film de Claude Lanzmann, le 12 novembre 1994,
par Vincent Remy, source
Avec « Shoah », Claude Lanzmann avait réalisé un film à la fois indispensable et sans appel. Indispensable, comme tout ce qui étaye la mémoire du génocide juif ; sans appel, du fait de sa méthode : pas d’images d’archives, pas de reconstitution, mais la force, irréfutable du témoignage et de la confrontation entre interviewer et interviewés. Grâce à cette méthode, Lanzmann avait trouvé l’image juste.
« Shoah » apparaît comme une œuvre unique. De fait, on a oublié que ce film était le deuxième volet d’un travail entamé avec « Pourquoi Israël ? » En revanche, « Tsahal », troisième volet de la trilogie, ne passera pas inaperçu. Parce qu’il arrive après l’admirable « Shoah ». Mais, surtout, parce que cet ordre chronologique ne doit rien au hasard : Lanzmann considère qu’Israël a été engendré par la Shoah. En posant l’armée israélienne (Tsahal) comme condition de l’existence d’Israël, il s’interdit — et nous interdit — tout regard critique sur elle.
De la Shoah à Israël, et d’Israël à Tsahal, la filiation est établie par un travail de montage : les premières images de Lanzmann sont pour les tombes des jeunes soldats morts pendant la guerre de 73. C’est cette guerre que Lanzmann choisit de mettre en avant et, plus précisément, ses toutes premières heures, où le sort d’Israël fut réellement menacé. Et ce sont les rescapés des bunkers du canal de Suez qui témoignent.
Parce que ces officiers, enfants des victimes de la Shoah, sont les survivants d’une « autre » extermination possible, qu’ils n’avaient pas, pour la plupart, la vocation des armes et que leur discours, intelligent et émouvant, échappe à l’habituelle rhétorique militaire, on leur est tout acquis. Et c’est en s’appuyant sur cette sympathie que Lanzmann nous emmène dans une entreprise, d’abord ennuyeuse, puis déplaisante.
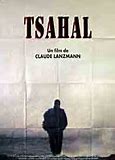
L’ennui, tout d’abord. Obnubilé par sa démonstration — Tsahal n’est pas une armée comme les autres —, Lanzmann s’attarde une demi-heure sur la fabrication du tank Markava, le nombre de blindages, l’épaisseur des tôles, son incomparable supériorité sur tous les chars du monde, et le fait qu’on s’y sent « comme à la maison ». Sur la lancée, on visite une école de l’armée de l’air, où les futurs pilotes d’hélicoptère ressemblent tristement aux pilotes d’hélicoptère du monde entier : cette fois, c’est Top Gun, sans les femmes (car, curieusement, dans ce documentaire très viril, Lanzmann occulte presque ce particularisme, réel celui-là, de l’armée d’Israël : la présence des femmes).
Les raccourcis déplaisants, maintenant. Tsahal, une armée pas comme les autres : est-ce pour cela que Claude Lanzmann filme le général Ariel Sharon, tel un patriarche de la Bible au milieu de ses moutons — l’image n’est pas innocente ! —, sans une question un tant soit peu critique sur son rôle dans la guerre du Liban ? Est-ce pour cela qu’il expédie cette guerre, à peine évoquée au détour d’une phrase ?
Il lui était impossible, en revanche, d’échapper à la question des territoires occupés. Admettre que Tsahal, armée d’occupation, ait pu être, comme toutes les armées d’occupation, conduite au pire ? Lanzmann ne s’y résout pas. Certes, il montre les fouilles humiliantes subies par les Palestiniens. Mais il se refuse à porter la contradiction à ses interviewés : d’où il ressort finalement que c’est parce que Tsahal est Tsahal qu’il n’y a pas eu davantage de victimes parmi les jeunes Palestiniens.
Ce n’est que dans les toutes dernières minutes de son film que Lanzmann retrouve son talent de contradicteur. Mais il a déplacé le sujet, et la cible, civile, est facile : un colon des territoires occupés, aux propos tellement caricaturaux qu’il constitue le bouc émissaire idéal. Ariel Sharon, grand ordonnateur de la colonisation des territoires, peut garder ses moutons tranquille…
Les cinq heures de « Tsahal », finalement, témoignent d’un syndrome attristant. La seule fois où Lanzmann s’adresse à un Arabe de Gaza, père de dix enfants, c’est pour demander, sur un ton qui se veut amical : « Pourquoi fait-il autant d’enfants ? » Question accablante. Et qui le devient encore plus lorsque, quelques instants plus tard, Lanzmann donne l’accolade au colon qui vient de nier l’existence possible des Palestiniens sur cette terre.
On sort accablé, en effet. Ni l’interview de l’écrivain David Grossman, ni celle d’un avocat des droits de l’homme ne dissipent le malaise. D’autant — on en est convaincu — que cette glorification de la force militaire ne reflète pas la diversité et les contradictions que tolère et suscite la société israélienne.
Vincent Remy