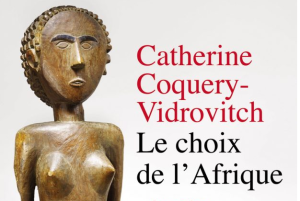L’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch, autrice d’une œuvre considérable consacrée à l’histoire de l’Afrique, notamment de Le choix de l’Afrique. Les combats d’une pionnière de l’histoire africaine paru aux éditions La Découverte en 2021, a répondu aux questions d’Éric Mesnard pour histoirecoloniale.net.
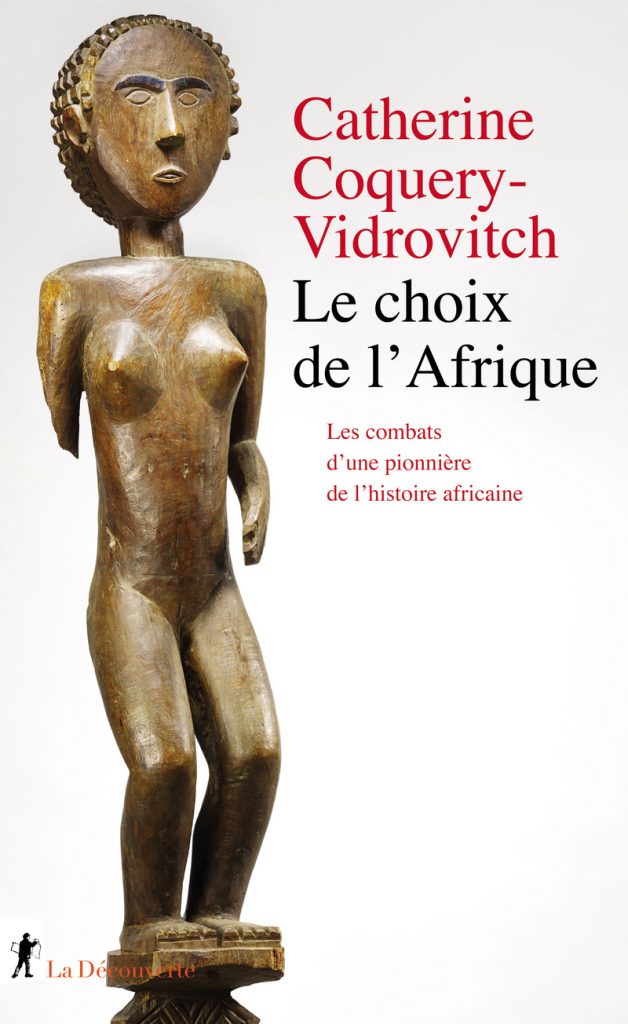
Entretien avec
Catherine Coquery-Vidrovitch
par Eric Mesnard
Une enfance « pas comme les autres » …
Eric Mesnard : En exergue de ton livre autobiographique, Le choix de l’Afrique, tu rends hommage à « Poupette », ta mère (1909-2004), alors jeune veuve dont « la force de vie », écris-tu, t’a permis de « survivre » alors que tu avais moins de 10 ans et que tu étais orpheline de père. Tu cites aussi Aharon Appelfeld : « Mes écrits ont poussé sur la terre constituée par ce qui m’est arrivé durant mon enfance et ma prime adolescence[1]. » Ceci m’autorise à te demander en quoi ton enfance – tu avais entre 5 et 9 ans lors de l’Occupation – a pu influer sur ton œuvre d’historienne.
Catherine Coquery-Vidrovitch : Plus je vieillis, plus je pense que cette enfance m’a marquée. C’est en écrivant mon « ego-histoire » que je me suis demandé ce qui m’a conduite à travailler sur l’Afrique, alors que, ni moi, ni ma famille, n’avions de lien avec ce continent.
Je me souviens, que lorsque j’étais une jeune enfant, je voulais devenir « bonne sœur » et adopter une petite fille noire. Quelle idée ? Pourquoi ? Dans un déménagement tardif, j’ai retrouvé une petite ménagère en porcelaine avec laquelle je jouais. Les petites assiettes étaient décorées avec une ribambelle de petites filles noires. Je vivais alors très isolée à Beauvais. Ce jeu a peut-être influé… Va savoir !
Tu écris que ta situation d’enfant juive (entre 5 et 9 ans) pendant l’Occupation t’a donné le sentiment de « ne pas être comme les autres » en cherchant « inconsciemment à ne pas faire comme les autres ».
C’est une hypothèse que j’ai énoncée plus tard, mais, en effet, je n’étais pas comme les autres puisque nous étions ma mère, ma grand-mère, ma sœur et moi, clandestines. Ma mère connaissait à Beauvais, une Allemande qui avait épousé le professeur d’allemand du lycée. Elle lui a dit que si elle était juive, ce qu’elle ne lui demanda pas, il ne fallait surtout pas aller se déclarer comme telle aux autorités. Ma mère l’a écoutée et nous n’avons jamais porté l’étoile jaune. Le plus surprenant, alors que nous avons quitté Beauvais pour aller à Paris, est que je n’ai aucun souvenir d’avoir vu quelqu’un la porter. Ce qui n’est pas possible, mais j’ai dû « évacuer ». Ma mère m’avait dit que c’étaient les « méchants » qui disaient des « sottises » sur les juifs et qu’il ne fallait pas les écouter.
Dès les premières lignes de ton livre, tu expliques que ton métier d’historienne de l’Afrique est lié à ton expérience d’enfant juive sous l’Occupation : « Ces « autres », en l’occurrence les Africains subsahariens sont étonnamment proches … ils ont été occupés ; comme les Français juifs, on leur a dénié leur qualité d’habitants ayant les mêmes droits que les autres »
C’est une réflexion faite alors que j’avais au moins 25 ans lorsque mon mari[2] dut faire une année de service militaire en Algérie. J’eus l’occasion, alors que j’enseignais dans un lycée, de le rejoindre quelques semaines à Oran. J’ai vu un pays colonisé et en guerre. A posteriori, j’ai eu le sentiment de reconnaître quelque chose que je connaissais : des gens soumis à un pouvoir étrangers à qui on ne reconnaissait pas les droits alors qu’ils étaient chez eux.
Tu as le sentiment n’étant pas « comme les autres » de ne pas faire « comme les autres » . Tu écris que tu te promènes seule dans les rues d’Oran, que tu te sens bien avec la population algérienne, alors que c’est la guerre. Par la suite, alors que tu es une jeune femme, tu voyages dans des conditions parfois épiques au Congo pour tes travaux de thèse.
Je crois avoir hérité de ma mère qui avait perdu son mari à 32 ans, dont le père a été assassiné à Auschwitz, dont le beau-père s’est suicidé et qui avait la charge de deux enfants, une grande vitalité. Elle voulait que ses deux filles, malgré les circonstances tragiques aient une enfance heureuse. Elle avait un instinct de vie extraordinaire.
Je me suis rendu compte que comme ma mère, j’ai eu la chance de ne pas avoir peur de faire des choses dangereuses, d’avoir quelques mésaventures, mais de m’en sortir toujours bien.
Une « pionnière » de l’histoire africaine
Alors qu’un de tes professeurs t’avait incitée à devenir médiéviste en te spécialisant sur Paris au XVème siècle, tu es devenue historienne de l’Afrique …
C’est l’Algérie où j’ai rejoint mon mari qui m’a incitée, dans un premier temps, à vouloir travailler sur l’Afrique du Nord. J’ai pris pendant trois ans des cours d’arabe aux Langues orientales, mais j’ai arrêté, lorsque du fait d’une série de hasards, j’ai commencé à travailler sur l’histoire de l’Afrique équatoriale.
Fernand Braudel, de retour des États-Unis, a eu l’idée de créer des centres de recherche consacrés à l’histoire extra-européenne, dont un consacré à l’Afrique pour lequel il cherchait à associer géographes, linguistes, anthropologues et un historien. Il fit appel à Henri Brunschwig (1904-1989), spécialiste de la Prusse qui avait publié en 1957 un livre sur l’expansion allemande outre-mer depuis le XVème siècle. Il est devenu en 1961 le premier professeur d’histoire de l’Afrique dans l’enseignement supérieur (VIème section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes – E.P.H.E.[3]). Ayant besoin d’un.e assistant.e, il demanda, sans que je le sache à trois personnes, dont Henri Moniot[4], d’écrire un article sur la politique franco-britannique sur les côtes du Bénin au XIXème siècle. C’est moi qui ai été recrutée. Je suis restée dix ans à l’EPHE où j’avais tout le temps d’écrire ma thèse.
Tu publies en 1965 ton premier livre dans la collection « Archives » chez Julliard, La Découverte de l’Afrique – L’Afrique noire atlantique, des origines au XVIIIème siècle, puis en 1969 aux éditions de l’EHESS, Brazza et la prise de possession du Congo – La mission de l’Ouest africain, 1883-1885 (ta thèse de 3ème cycle), et ta thèse d’État, en 1972, Le « Congo français » (AEF) au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930.
En 1972, on me proposa un poste à l’Université de Jussieu (Paris VII, puis Paris Diderot, aujourd’hui Paris Cité). Cette Université avait été choisie par des historiens qui souhaitaient transformer l’enseignement de l’histoire en refusant la traditionnelle division de l’histoire en 4 périodes (antiquité, moyen âge, temps modernes et époque contemporaine) et en ouvrant les enseignements à d’autres espaces que l’Europe. Nous étions alors une dizaine à travailler sur ce qu’on appelle aujourd’hui le Sud. En 1974, j’ai pris l’initiative, avec le soutien du Président de l’Université de créer un laboratoire de recherche que nous avons appelé « Connaissance du tiers-monde » . Il a perduré et existe encore sous un autre nom à l’Université Paris Cité[5].
Tu lances, en France, de nouveaux chantiers de recherche : les femmes africaines, les villes. Cet enseignement et ce laboratoire permettent à des étudiants venus d’Afrique francophone de venir faire leurs thèses à Paris…
Il n’y avait, alors, y compris à Dakar, aucun centre de recherche consacré à l’histoire africaine. Les étudiants qui voulaient travailler sur l’histoire de l’Afrique précoloniale pouvaient s’inscrire à Paris I, ceux qui voulaient faire une thèse sur l’Afrique contemporaine venaient à Paris VII où notre projet était de mener des études comparatives sur l’histoire contemporaine des pays du tiers-monde. C’est ainsi que j’ai reçu entre 1972 et les années 1980, de nombreux historiens africains francophones qui allaient encadrer les nouvelles Universités créées dans leurs pays depuis l’indépendance.
Une partie des universitaires qui ont, aujourd’hui, l’âge de prendre leur retraite sont passés par Paris VII, puis ont formé la génération suivante.Tu es ainsi à l’origine d’une chaîne qui perdure.
En 1971, Samir Amin[6] qui enseignait à la faculté de droit de Dakar m’a demandé de venir y faire un cours sur l’histoire africaine pendant six semaines. A cette occasion, les historiens de l’Université sont venus m’écouter et m’ont invitée à revenir pour le département d’histoire. J’ai été habilitée comme professeur invitée pour créer sur place un diplôme de 3ème cycle. J’y ai participé de 1972 à 2002, ce qui m’a permis de voir passer plusieurs générations d’étudiants dont la plupart sont devenus professeurs.
L’année dernière, encore, j’ai été invitée à Dakar, à Lomé et en Côte d’Ivoire pour participer à des colloques consacrés à des universitaires qui partaient à la retraite et qui avaient été mes étudiants. C’était très émouvant et marquait la fin d’un cycle.
Les engagements d’une historienne
Tu écris dans Le Choix de l’Afrique qu’un des « fils rouges » de tes « combats » c’est l’antiracisme et l’anticolonialisme. Tu as été présidente, en 2009-2010, du CVUH[7]. Tu as pris position contre le discours du Président Sarkozy à Dakar en 2007[8]. Ton engagement passe aussi par ton travail de diffusion des acquis de la recherche (voir ci-dessous ta bibliographie).
La synthèse des connaissances acquises s’est faite aussi grâce à Henri Moniot qui m’a proposé d’écrire avec lui L’Afrique noire de 1800 à nos jours en 1974. Ce livre a été régulièrement réédité jusqu’en 2005 en intégrant, au fur et à mesure, les apports de la recherche. J’aime le travail de recherche, mais il ne me suffit pas. J’ai voulu rédiger des synthèses pour faire le point sur ce que je savais sur l’histoire africaine. Il n’y a pas très longtemps, j’ai été invitée au Cameroun, à Yaoundé, pour y faire pendant six semaines, un cycle d’enseignement. Alors que j’ai peu travaillé sur les archives du Cameroun, j’ai eu la surprise d’y avoir été accueillie comme une star par des étudiants qui avaient utilisé pour s’initier à l’histoire de l’Afrique mes manuels de vulgarisation scientifique. J’ai été pendant six semaines photographiée par des étudiants qui voulaient avoir un souvenir de l’autrice de manuels sur lesquels ils avaient travaillé. J’étais connue sans le savoir, ce qui a été très gratifiant.
Merci Catherine pour cet échange. Ceux et celles qui voudront en savoir plus sur tes voyages en Afrique équatoriale et sub-saharienne, ton enseignement dans une Université américaine et tes travaux d’historienne liront Le Choix de l’Afrique ton livre d’égo-histoire et écouteront sur France Culture l’émission A voix nue qui t’a été consacrée en avril 2023.
- La Découverte de l’Afrique – L’Afrique noire atlantique, des origines au XVIIIème siècle, « Archives, Julliard, 1965.
- Brazza et la prise de possession du Congo – La mission de l’Ouest africain, 1883-1885, Mouton, 1969 (thèse de 3ème cycle).
- Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, Mouton, 1972 (thèse d’État).
- L’Afrique noire de 1800 à nos jours, avec Henri Moniot, »Nouvelle Clio », PUF, 1974.
- Afrique noire. Permanences et ruptures (Payot 1985) 2e éd. révisée, L´Harmattan 1992.
- Histoire des villes d´Afrique noire : Des origines à la colonisation, Albin Michel, 1993.
- Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique du XIXe au XXe siècle, Paris, Desjonquères, 1994. Réed. La Découverte, 2013.
- L’Afrique et les Africains au XIXe siècle, Paris, Colin, 1999.
- « Le postulat de la supériorité blanche et de l’infériorité noire », in Marc Ferro (dir.), Le livre noir du colonialisme. XVIe – XXIe siècles : de l’extermination à la repentance, Paris, Robert Laffont, 2003, p. 646-685
- Des victimes oubliées du nazisme : les Noirs et l’Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, Le Cherche-Midi, 2007.
- Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille, Agone, 2009.
- Petite Histoire de l’Afrique : l’Afrique au sud du Sahara de la préhistoire à nos jours, La Découverte, 2010.
- Être esclave-Afrique-Amériques XVe-XIXe siècle avec Éric Mesnard, La Découverte, 2013, réédité en poche, 2019.
- Mission Pierre Savorgnan de Brazza / Commission Lanessan (préface), Le Rapport Brazza, Mission d’enquête du Congo, Rapport et documents (1905-1907), Paris, Le Passager clandestin, 2014.
- Les Routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines VIe – XXe siècles, Paris, Albin Michel, 2018.
- Le choix de l’Afrique – Les combats d’une pionnière de l’histoire africaine , La Découverte, 2021.
[1] Aharon Appelfeld, Mon père et ma mère, L’Olivier, 2020, p.8.
[2] Michel Coquery (1931-2011) , agrégé de géographie, co-fondateur de l’Institut Français d’urbanisme, il enseigna à l’Ecole des Ponts et Chaussées et à l’Université de Paris 8. Il fut le directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud entre 1990 et1995. Il contribua à l’enseignement de l’urbanisme en Afrique.
[3] La sixième section de l’EPHE a d’abord été dirigée par Lucien Febvre puis, après sa mort en 1956, par Fernand Braudel. Pendant les années 60, elle devient un centre de recherche qui associe les sciences sociales. En 1975, la VIème Section devient l’École des hautes études en sciences sociales.
[4] Henri Moniot (1935-2017), historien et didacticien qui a, notamment, publié avec Catherine Coquery-Vidrovitch, L’Afrique noire de 1800 à nos jours dans la collection Nouvelle Clio des PUF en 1974. Cet ouvrage a été de nombreuses fois réédité.
[5] Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA).
[6] Samir Amin (1931-2018) fut un économiste politique franco–égyptien et un militant anti-impérialiste.
[7] Le 17 juin 2005, le Comité de Vigilance face aux usages publics de l’histoire a publié son manifeste : « Tout récemment, le gouvernement n’a pas hésité à adopter une loi (23 février 2005) exigeant des enseignants qu’ils insistent sur « le rôle positif » de la colonisation. Cette loi est non seulement inquiétante parce qu’elle est sous-tendue par une vision conservatrice du passé colonial, mais aussi parce qu’elle traduit le profond mépris du pouvoir à l’égard des peuples colonisés et du travail des historiens. Cette loi reflète une tendance beaucoup plus générale. L’intervention croissante du pouvoir politique et des médias dans des questions d’ordre historique tend à imposer des jugements de valeur au détriment de l’analyse critique des phénomènes (…) Le manifeste et textes de référence – CVUH
[8] Le discours de Dakar, écrit par Henri Guaino, a été et prononcé par Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007, à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Il y a, notamment, affirmé que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire ».