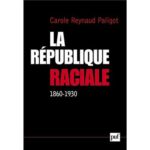Dans le cadre de ses ateliers « Les mots du politique », le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH) a organisé le 18 mars 2018 une réflexion sur le mot « Race », avec les historiennes Carole Reynaud-Paligot et Elsa Dorlin.

De g. à dr., Elsa Dorlin, Gilles Manceron et Carole Reynaud-Paligot.
L’historien Gilles Manceron a d’abord souligné en introduction que la réflexion sur le mot race et le racisme est d’autant plus nécessaire que, depuis le début du XXIe siècle, les antiracistes ont connu en France d’importants débats et même de profondes divisions. L’émergence de la question des discriminations post-esclavagistes et post-coloniales a modifié la définition même de l’antiracisme. Dans la première moitié du XXe siècle, de l’affaire Dreyfus jusqu’à l’ère des décolonisations, le mot « racisme » désignait, uniquement ou essentiellement, l’antisémitisme. En 1927, quand s’est constituée la Ligue contre les pogroms, qui deviendra la Lica, puis la Licra, de nombreux membres de la LDH, tel son président Victor Basch, appartenaient aux deux associations. Le mouvement qui, au sein de la Résistance, dénonçait les persécutions antijuives s’intitulait Mouvement national contre le racisme (MNCR). Jusqu’à la fin du XXe siècle, les associations « historiques » qui combattaient le racisme qu’étaient la LDH, la Licra et le Mrap étaient proches et partageaient, en gros, le même discours. Par exemple, quand, à la fin des années 1980, a été lancée la Semaine nationale d’éducation contre le racisme, elles l’ont, avec d’autres, animée en commun.
Bouleversements dans l’antiracisme
C’est au tournant du siècle que l’émergence de la question coloniale et post-coloniale les a divisées et que sont apparues des associations nouvelles constituées par des personnes héritières de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation, en marge des organisations antiracistes existantes qui, à leurs yeux, ne prenaient pas assez en charge leur situation et leur combat. En mai 1998, lors des 150 ans de l’abolition de l’esclavage de 1848, une marche autonome a été organisée par des « Domiens » et c’est à la suite de leur forte demande qu’a été adoptée la loi Taubira, en 2001, qui a qualifié l’esclavage de crime contre l’humanité. Depuis le début du XXIe siècle, des crimes coloniaux comme les massacres du 17 octobre 1961 à Paris et de mai-juin 1945 dans le Constantinois ont émergé dans la mémoire collective et des organisations spécifiques sont apparues parmi les personnes qui sont l’objet d’un « racisme de couleur » : le Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB), le Conseil représentatif des organisations noires de France (CRAN), le parti des indigènes de la République (PIR), et tout un ensemble d’associations, souvent locales, réagissant aux violences policières liées à ce type de racisme. La prise de conscience du racisme colonial a conduit aussi à reconnaître que celui-ci n’a pas été porté seulement par la droite et l’extrême droite mais aussi par la gauche républicaine. La colonisation par Israël de l’ensemble de la Palestine a accentué leur engagement. Depuis 2015, des marches ont été organisées auxquelles certaines des « associations historiques » refusaient de se joindre ou hésitaient à participer. Une « nouvelle mouvance antiraciste » s’est affirmée, mais elle s’est elle-même divisée : ainsi, le PIR, très présent lors de la première « Marche de la dignité » d’octobre 2015, s’est vu marginalisé et s’est retiré en mars 2018 de la récente « Marche des solidarités ». Car cette « nouvelle mouvance antiraciste » connait elle même des débats autour de l’articulation de « l’antiracisme post-colonial » avec les combats sociaux, avec l’engagement féministe et notamment la condamnation des violences sexuelles d’où qu’elles viennent, ou sur la question de la laïcité. Refusant de voir uniquement la dimension post-coloniale de notre société, certains, tout en restant autonomes par rapport aux « associations historiques », y posent le problème de l’« intersectionalité » de ces combats.
C’est dans ce contexte que les travaux de Carole Reynaud-Paligot sur le « racisme républicain » et ceux d’Elsa Dorlin sur les proximités et ressemblances entre sexisme et racisme sont particulièrement utiles. Leurs travaux, tous publiés en ce début du XXIe siècle, nous aident à penser les enjeux actuels de l’antiracisme.
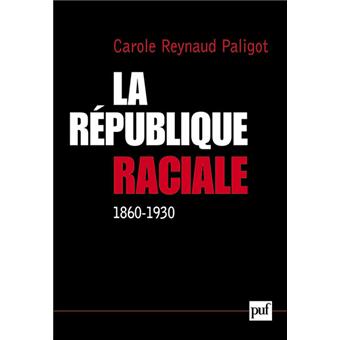 Carole Reynaud-Paligot a développé les questions soulevées dans ses ouvrages :
Carole Reynaud-Paligot a développé les questions soulevées dans ses ouvrages :
• La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930) , préface de Christophe Charle (PUF, 2006). Présentation de l’éditeur
 • Races, racisme et antiracisme dans les années 1930 (PUF, 2007). Présentation de l’éditeur
• Races, racisme et antiracisme dans les années 1930 (PUF, 2007). Présentation de l’éditeur
et, sous sa direction :
 • De l’identité nationale. Science, race et politique en Europe et aux États-Unis. XIXe-XXe siècle (PUF « Science histoire société », 2011). Présentation de l’éditeur
• De l’identité nationale. Science, race et politique en Europe et aux États-Unis. XIXe-XXe siècle (PUF « Science histoire société », 2011). Présentation de l’éditeur
Des questions qu’elle a également développées dans le cadre des Conférences du Cercle de l’IEP (disponible en podcast).
Extrait du texte de Carole Reynaud-Paligot, « Construction de l’identité nationale et raciale en France (XIXe-XXe) »,
paru dans l’ouvrage dirigé par Sylvie Laurent et Thierry Leclère, De quelle couleur sont les Blancs ? Des « petits blancs » des colonies au « racisme anti-blancs », La Découverte, 2013 (p. 227-231)
[…]
« Race blanche » versus « races de couleur »
La construction identitaire n’a pas seulement opéré en réaction à des rivalités entre puissances européennes voisines ; le contexte d’expansion coloniale lui a donné une seconde dimension qui s’est structurée autour de l’opposition entre deux mondes, le monde civilisé et le monde non civilisé. Le clivage n’était pas seulement perçu comme culturel, il s’appuyait également sur des représentations raciales alors en plein essor, en opposant la « race blanche » aux « races de couleur ». Sans ériger des barrières infranchissables, la politique coloniale distinguait les populations assimilables — les Européens —, qu’il s’agissait de « franciser », des populations locales — les « indigènes » —, qui formaient un monde à part, celui des « sujets » privés de nombreux droits et qui demeuraient en marge des valeurs républicaines.
L’étude de la législation sur la nationalité révèle ainsi une véritable racialisation du monde. Les autorités coloniales françaises y ont affirmé une volonté très nette de franciser les populations d’origine européenne jugées assimilables, en leur accordant le statut d’étranger, statut qui permettait — grâce à la loi de 1889 — à leurs enfants nés et résidant en France de devenir automatiquement citoyens à leur majorité. Cette loi a également instauré le double droit du sol en faisant des enfants nés en France — de parents étrangers nés en France — des Français. En Algérie, où les immigrants européens étaient nombreux, il s’agissait de franciser les enfants d’Espagnols, d’Italiens, de Maltais, d’Allemands. Les « indigènes » des colonies, c’est-à-dire les populations locales des possessions françaises d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, étaient quant à eux exclus du droit du sol et ne pouvaient accéder à la citoyenneté française qu’à travers la procédure de naturalisation, une procédure restée très restrictive tout au long de la période. La nécessité de connaître la langue française ne permettait en effet qu’à une très mince élite, francophone et francophile, d’accéder à la nationalité française – accession qui entraînait l’application du droit civil français et imposait la renonciation au statut personnel. Le système scolaire était également pétri de cette nouvelle racialisation du monde. L’école des colonies est restée, jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une école duale : l’école des Européens, avec un programme métropolitain, accueillait les enfants de colons venus de France et d’Europe, tandis que l’école des « indigènes » dispensait un enseignement « adapté », c’est-à-dire essentiellement pratique et professionnel afin de former une main-d’œuvre d’auxiliaires utiles à la colonisation.
Si les barrières entre les deux écoles n’étaient pas hermétiques et si les autorités coloniales se sont toujours défendu d’interdire l’accès à l’école française aux enfants « indigènes », les pratiques témoignent sans ambiguïté d’une volonté d’en limiter l’accès. Ainsi, l’africanisation des cadres n’était pas à l’ordre du jour, la scolarisation dans le secondaire et le supérieur étant perçue comme un danger, un risque de produire des « déclassés » trop qualifiés par rapport aux perspectives d’emploi et donc susceptibles de contester l’ordre colonial. Dans le domaine familial également, la volonté de limiter les mariages dits « mixtes » s’est bien souvent imposée au sein du monde colonial, mais il est vrai qu’une fois mariée, la femme « indigène » a pu bénéficier de l’accès à la citoyenneté. Par ailleurs, à partir des années 1920, la République s’est montrée généreuse avec les métis dont l’un des parents était français en leur octroyant également la nationalité française. Mais, là encore, la logique raciale prévalait, puisqu’il paraissait inconcevable de laisser au monde « indigène » un individu ayant du sang français dans les veines.
Plus tard, le régime de Vichy donna une inflexion notable à l’identité nationale construite sous la IIIe République en y insufflant un antisémitisme virulent, certes déjà présent dans la société française depuis la fin du XIXe siècle, mais qui était resté cantonné dans des franges circonscrites de l’opinion publique. Le régime refusa également les fondements de l’identité nationale qui s’étaient imposés avec l’avènement de la République et il tenta de faire célébrer la fête nationale le jour de la fête de Jeanne d’Arc plutôt que le 14 juillet. En revanche, le mythe impérial et la mission civilisatrice qui s’étaient peu à peu imposés chez les républicains du début du siècle pour devenir, dans l’entre-deux-guerres, un autre pivot de l’identité française resta en vigueur durant l’épisode vichyste.
Quels héritages dans la société française d’aujourd’hui ?
Il est incontestable que, dans le contexte de l’après-Seconde Guerre mondiale et plus encore dans celui de la construction européenne, la dimension raciale de l’identité française est devenue totalement obsolète. On peut être tenté d’établir une filiation entre les représentations identitaires opératoires durant l’ère coloniale et celles d’aujourd’hui. Dans un certain nombre d’études sur les sociétés postcoloniales, la survivance des représentations est effectivement présentée comme une évidence. Il est souvent affirmé que les représentations coloniales imprègnent encore profondément notre imaginaire, sans pour autant que les modalités de ces transmissions soient démontrées et donc au prix d’une certaine « essentialisation » de l’« imaginaire collectif » ou de la « culture coloniale », notion dont aucune définition claire n’est proposée. Les représentations et les pratiques se transmettraient de génération en génération, sans que les vecteurs soient connus : ni les hommes, ni les institutions, ni l’école ne sont pourtant aujourd’hui ceux de la IIIe République. À trop insister sur les continuités, à trop rechercher les héritages, on se dispense de la contextualisation des phénomènes et de leur explicitation. La faiblesse heuristique des approches analogiques et des héritages non démontrés a déjà été soulignée, de même que les différences entre les situations coloniales et postcoloniales ont été établies. Si certaines études ont effectivement montré que les coloniaux ont, après les indépendances, été intégrés dans certains services de l’État métropolitain et donc que les représentations et pratiques ont pu dans une certaine mesure perdurer, cela semble de moins en moins vrai au fur et à mesure que l’on s’éloigne de cette époque et que ceux qui l’ont vécue disparaissent. L’étude des politiques en matière d’immigration après 1945 montre également une hiérarchisation des immigrés selon leur capacité supposée d’assimilation à la société française, les plus assimilables étant les immigrés venus du nord de l’Europe et les moins désirés ceux venant d’Afrique du Nord. Si ces représentations ne trouvent pas de traduction juridique dans les ordonnances de 1945, elles sont présentes au sein des ministères et parmi les agents administratifs, donnant lieu à des pratiques discriminatoires : le « problème de l’immigration », c’est-à-dire le fait que l’immigration noire et maghrébine soit perçue comme un problème, est une réalité chez les hauts fonctionnaires dès les années 1960, avant même la crise économique de 1974. Cela s’est traduit par une volonté du pouvoir exécutif de limiter l’accès au territoire français et d’engager une politique de retours forcés qui n’a pu avoir lieu en raison de l’opposition de différents acteurs (le Conseil d’État, certains agents de l’État, l’opposition parlementaire, les syndicats…). D’autres analyses ont également montré la complexité des liens entre période coloniale et postcoloniale, tout comme la nécessité d’étudier les « processus sociaux de hiérarchisation et d’infériorisation ». Plutôt que de poser comme une évidence la continuité entre ces représentations, il convient d’essayer de comprendre pourquoi, dans un contexte intellectuel et politique (national et international) différent, la hiérarchisation entre population européenne et population africaine demeure opératoire pour une partie des élites françaises, alors que l’anthropologie sociale et culturelle a obtenu une reconnaissance incontestable rendant obsolètes les notions de race, de hiérarchisation raciale ou culturelle, et que le droit international proclame l’égalité des nations. Il semble plus pertinent de chercher à comprendre pourquoi certains types de représentations l’ont emporté à un moment donné, quelle fut l’utilité de ces représentations dans un contexte spécifique et de se demander, alors qu’on assiste à une offensive d’ethnicisation des relations sociales, quelles en sont les raisons, les commanditaires, les acteurs et à qui elles profitent.
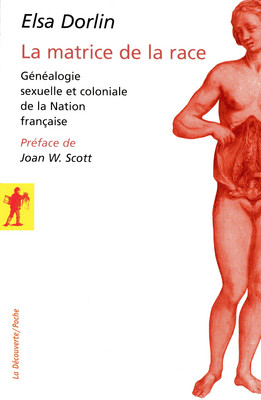 Elsa Dorlin est intervenue également sur les questions qu’elle aborde dans ses ouvrages : La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La Découverte, 2006). Présentation de l’éditeur.
Elsa Dorlin est intervenue également sur les questions qu’elle aborde dans ses ouvrages : La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La Découverte, 2006). Présentation de l’éditeur.
Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination (dir.) (PUF, coll. « Actuel Marx/Confrontations », 2009). Présentation de l’éditeur
Avant-propos à Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres de Ottobah Cugoano — publié à Paris en 1788 — (La Découverte, Zones, 2009). Présentation de l’éditeur
Se défendre. Une philosophie de la violence (La Découverte, Zones, 2017). Présentation de l’éditeur



A propos de La matrice de la race d’Elsa Dorlin
par Anna Terwiel, La Vie des idées, 3 décembre 2007. Source
En mars 2005, Elsa Dorlin publiait le manifeste « Pas en notre nom ! »1 pour protester contre l’instrumentalisation du féminisme par la droite française. La condition des femmes était devenue un sujet politique majeur, y expliquait-elle, mais à un prix élevé : son association à l’immigration. En affirmant que la liberté des femmes était menacée par les populations issues de l’immigration et plus spécifiquement les musulmans, la politique aurait racialisé la cause de l’égalité des sexes et des sexualités. Le féminisme servirait ainsi de prétexte à un discours raciste et permettrait d’occulter les discriminations subies par les femmes et les minorités sexuelles dans la France « autochtone ». Cette récupération politique aurait pour conséquence d’exclure les femmes musulmanes du féminisme, désormais défini comme mouvement de femmes occidentales « libérées ». Contre cette corruption du féminisme, Dorlin plaidait pour « un réel engagement anti-sexiste et anti-raciste ».
Un an plus tard, elle a répondu elle-même à cet appel en publiant La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, adaptation de sa thèse de doctorat2. La philosophe, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entreprend dans ce livre une « épistémologie de la domination » (p. 12), une analyse de « la progressive anthropologisation du politique » (p. 15) dont le but est de retracer la construction médicale de la différence sexuelle et raciale. Dans les deux cas, construire la différence signifie hiérarchiser : dès l’Antiquité, les médecins affirment que la différence entre les sexes réside dans le « tempérament », mais ils ajoutent aussitôt que le tempérament féminin, froid et humide, est inférieur au tempérament masculin et même pathologique. De même, les médecins qui se penchent au XVIIIe siècle sur la différence entre colonisateurs et esclaves élaborent une idéologie raciste et postulent la supériorité naturelle des blancs. L’altérité est définie par la non-conformité à une norme, qui est d’abord celle de la santé. Dorlin appelle « nosopolitique » cette instrumentalisation des catégories du sain et du malsain.
Les recherches de Dorlin se situent au croisement de la philosophie, de l’histoire de la médecine et de l’histoire de la science, ainsi que des études postcoloniales et des études sur le genre (gender studies). Dans sa méthode d’analyse des discours et dans l’attention qu’elle porte à l’histoire de la médecine et de la sexualité, elle s’inspire principalement de Michel Foucault, mais aussi de Colette Guillaumin, auteur de L’idéologie raciste (Paris, 1972). Plus largement, le livre s’insère dans une tradition d’histoire des sciences inaugurée par Bruno Latour, et dans l’histoire du corps de Georges Vigarello et Alain Corbin. On y retrouve également l’influence de penseurs d’outre-atlantique tels que Thomas Laqueur, professeur à l’Université de Berkeley et auteur de plusieurs livres sur l’histoire du genre, dont La fabrique du sexe, paru chez Gallimard en 1992.
De l’aveu même de l’auteur, c’est le Black Feminism américain (représenté par des auteurs comme Angela Davis, Hilary Beckles et Hazel Carby) qui l’aurait conduite à formuler sa thèse. « Tout mon travail consiste à faire la généalogie des acceptions modernes du « sexe » — de la différence sexuelle — et de la « race », en mettant en évidence leur rapport génétique, c’est-à-dire leur engendrement réciproque. Le sexisme et le racisme ne sont pas tant théoriquement comparables qu’inextricablement liés d’un point de vue historique. » (p.12) La transposition se produit au XVIIIe siècle, avec la mise en place des politiques natalistes : c’est alors que la vision d’un corps féminin malsain devient un obstacle au renouveau de la nation française, et c’est cette contradiction qui expliquerait la réévaluation du statut de la femme. Face à la mortalité infantile effrayante, la critique de la mise en nourrice et de l’allaitement mercenaire va de pair avec la valorisation de l’allaitement et des soins maternels. Le corps maternel devient symbole de santé et même symbole de la nation : « Bien plus encore que l’allaitement maternel, qui est au fond une préoccupation très ancienne des médecins, c’est la figure de la mère en son entier qui porte et incarne l’ensemble des traits nationaux. » (p. 200).
Toutefois, cette revalorisation de la femme par le biais de la maternité a servi une autre politique d’exclusion, tournée cette fois-ci contre les esclaves dans les colonies. D’après Dorlin, « la société coloniale constitue… l’un des hauts lieux de la formation d’une idéologie nationale » (p.198). Il s’agit de la naturalisation de la nation, de son essentialisation, puisqu’on affirme, contre Hippocrate, que ce ne sont pas les facteurs extérieurs comme le climat qui déterminent le caractère des hommes, mais bien des facteurs innés. Un Français vivant dans une colonie reste bien et bel un Français, même après plusieurs générations, parce que son « tempérament » n’a pas changé. La notion de tempérament qui, auparavant, était au cœur de la domination masculine, est ainsi redéployée pour justifier l’esclavage et donner naissance à la catégorie moderne de la race.
Ici encore, différenciation signifie hiérarchisation, puisque le tempérament des Noirs est aussitôt déclaré « pathologique » par les médecins. Il y aurait des maladies propres aux Noirs, telles que la « pica », caractérisée par la consommation du charbon, de la cendre ou de la terre (p. 248), et les Noirs seraient plus susceptibles d’attraper le tétanos que les blancs3. Mais l’homme noir pouvait aussi être représenté comme physiquement supérieur aux blancs : il serait plus fort et plus résistant aux maladies. Un autre exemple de la même contradiction concerne la sexualité, les hommes Noirs étant à la fois dévirilisés et survirilisés par le discours médical de l’époque. « Athlétique ou débile, le corps des esclaves est toujours pathogène et c’est précisément cet attribut constant qui permet aux médecins de conclure systématiquement à une infériorité de nature. La logique de ce discours est toujours duelle et ne craint pas la contradiction ; la stigmatisation fonctionne toujours sur deux propositions contraires, sans que la conclusion change. » (p. 254)
Pourtant, plus frappante que l’incohérence des discours médicaux est l’audace de certaines propositions, comme celle d’un M. Bourgeois, auteur du traité Mémoire sur les maladies les plus communes à Saint-Domingue : leurs remèdes ; le moyen de les éviter ou de s’en garantir moralement et physiquement (1788) :
« Le travail, auquel on occupe perpétuellement les Nègres, contribue beaucoup, à mon avis, à les débarrasser, par la voie de la transpiration, des sucs grossiers que doivent amasser en eux les aliments dont ils usent. Ils font avec cela des diètes forcées, qui ne nuisent point à leur santé : car ce sont tous les repas que nous accumulons inconsidérablement les uns sur les autres qui nous rendent si valétudinaires, en dérangeant nos estomacs. »4
L’esclavage, un régime de santé ? A Saint-Domingue, où le nombre de décès parmi les esclaves dépassait de 75 000 celui des naissances entre 1784 et 1791 ? Autre exemple : le topos de la femme noire comme mauvaise mère. Dorlin rappelle que la politique esclavagiste a opté pour un renouvellement constant des esclaves, le coût d’entretien d’un jeune enfant esclave dépassant de beaucoup le coût d’achat d’un esclave en âge de travailler. En d’autres termes, une esclave enceinte nuisait aux intérêts économiques des colons : « Entre l’exploitation sexuelle des esclaves et l’inutilité des enfants nés en esclavage, on comprend donc mieux les intérêts que sert le discours des colons qui accusent les esclaves d’être non seulement des femmes lubriques, mais aussi de mauvaises mères, malveillantes. » (p. 257)
Dorlin prend ainsi nettement parti dans le débat sur le rapport de causalité entre l’esclavage et le discours raciste. « [C]’est bien à partir du moment où le système esclavagiste européen se développe aux Antilles et aux Amériques, où il engage un nombre considérable de capitaux européens et où il bouleverse l’équilibre entre colons et esclaves dans les colonies, qu’apparaissent les premières théories racistes » (p. 262). Exploitation économique d’abord, donc, justifications théoriques – même incohérentes – après. Le risque d’une telle analyse est de pousser trop loin le fonctionnalisme : quelle que soit la nature du propos tenu à l’égard d’un groupe discriminé, il doit forcément être un outil de domination. Mais Dorlin prête attention, dès le début du livre, aux discours hétérodoxes et aux incohérences non productives. Son épistémologie concerne moins la domination qu’une de ses modalités : celle de la science médicale naturalisant des différences entre groupes humains. Le discours médical a été un instrument pour justifier et pérenniser une domination de fait, de façon inconsciente ou consciente – comme dans le cas de Daniel Lescallier, ancien administrateur de la Guyane hollandaise, qui écrivait en 1791 que, pour que les esclaves respectent leurs maîtres, « le moyen le plus infaillible était de leur faire croire que les Blancs sont une espèce supérieure à la leur ; que la couleur nègre est vouée à la servitude, etc. (…) »
Le livre de Dorlin soulève un certain nombre de questions. Quel a été le statut social du discours médical dans l’histoire prémoderne ? La notion de « génotechnie », qu’utilise l’auteur pour parler des projets de politiques eugénistes, n’est-elle pas une exagération ? Et la représentation du corps féminin « pathogène », ne ressurgit-elle pas en France métropolitaine pendant la Révolution française ? Toutefois, La matrice de la race est un livre important. Il signale l’ouverture des sciences sociales françaises à la pluridisciplinarité, au thème de la construction de l’altérité et à la recherche universitaire américaine. La matrice de la race est le premier livre paru aux éditions La Découverte dans la série « genre & sexualité » dirigée par Eric Fassin, sociologue et professeur à l’Ecole Normale Supérieure. La deuxième publication dans cette série est une traduction d’un travail du feu sociologue américain Laud Humphreys. L’ouverture française pourrait bien s’avérer durable.
Anna Terwiel
L’émission de France Culture, « La Suite dans les idées » par Sylvain Bourmeau, du 26 décembre 2009. Source
- Lancé le 8 mars 2005 par le réseau féministe NextGenderation. Texte disponible en ligne : www.nextgenderation.net/projects/notinournames/fra
- Elsa Dorlin, « Au chevet de la Nation : sexe, race et médecine, XVIIe-XVIIIe siècle », sous la direction de Pierre-François Moreau, université Paris IV-Sorbonne, 2004. Par ailleurs, elle a publié L’évidence de l’égalité des sexes : une philosophie oubliée du XVIIe siècle (Paris, l’Harmattan, 2000).
- Ces idées ont resurgi récemment outre-Atlantique ; voir Augustin Landier & David Thesmar, « Le sexe des mathématiciens. L’anthropologie génétique dans le débat américain ».
- M. Bourgeois, dans Voyages intéressants dans différentes colonies françoises, espagnoles, anglaises, etc. ; contenant des observations importantes relatives à ces contrées et un Mémoire sur les maladies les plus communes à Saint-Domingue, édité par M. N. Jean-François Bastien, Londres et se vend à Paris, 1788, p. 435-436. Cité p. 245.