Michèle Audin, écrivaine, mathématicienne et historienne, dont nous avons publié un portrait, est morte le 14 novembre 2025. Née en 1954 à Alger, elle était la fille de Josette et Maurice Audin. Nous remercions les éditions de l’EHESS pour ces bonnes feuilles de son dernier livre, paru après sa mort, en janvier 2026 : Berbessa. Mes ancêtres colons.
On lira aussi sur ce site la page consacrée à Charlye Audin-Buono (1926 – 2026), dont il est beaucoup question dans le livre de Michèle Audin.
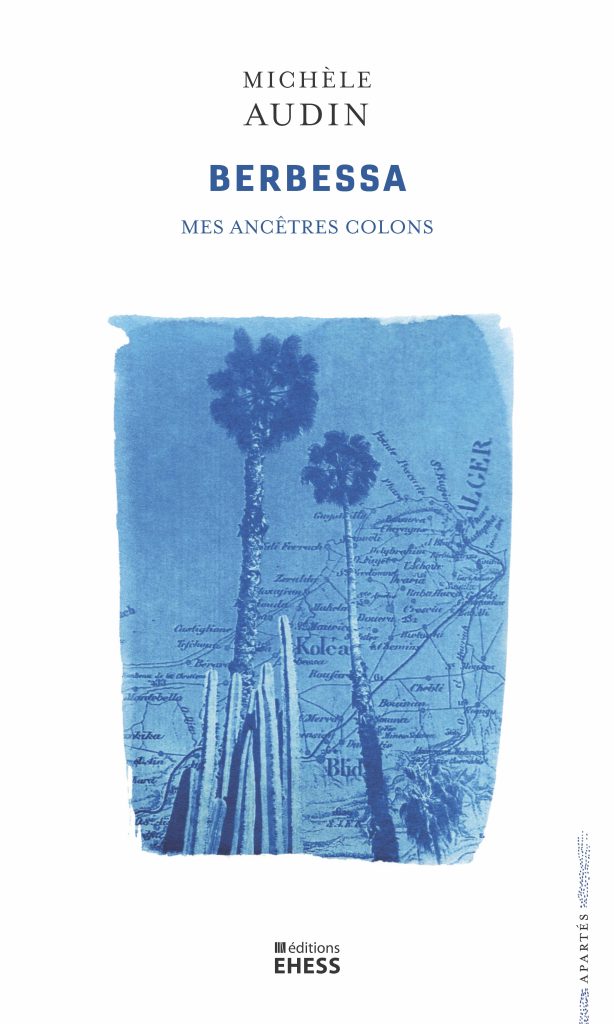
Prologue
J’ai déjà écrit et publié deux livres sur l’histoire de ma famille[1]. Celui-ci est le troisième. Je vais essayer d’expliquer de quoi il s’agit.
Dans le premier, Une vie brève, je racontais la vie de mon père, Maurice Audin. Il avait vingt-cinq ans en 1957 quand il a « disparu », après avoir été arrêté et torturé par l’armée française. C’était à Alger, pendant ce que l’on a appelé la « bataille d’Alger ». Ma motivation principale était qu’on ne parlait jamais que de sa mort, et que je souhaitais parler de sa vie.
Le deuxième livre, Oublier Clémence, était consacré à sa grand-mère paternelle, Clémence Janet, une ouvrière en soie lyonnaise morte à l’âge de vingt et un ans.
On m’a peu parlé de mon père – ceux qui n’ont pas cette expérience n’imaginent peut-être pas qu’une disparition puisse être aussi complète. Pour écrire Une vie brève, j’ai utilisé des archives familiales, principalement des papiers que ma mère avait conservés et des souvenirs de son enfance que ma tante Charlye, sœur aînée de mon père, m’avait envoyés. Pour Clémence, je n’avais absolument rien. Personne ne m’avait jamais parlé d’elle. Il n’y avait même pas de source familiale. J’ai dû apprendre à rechercher dans les archives de l’état civil français (en ligne) et, du peu que j’avais appris, j’ai écrit ce tout petit livre.
Si Une vie brève est une histoire algérienne et du xxe siècle, Oublier Clémence est une histoire française du xixe siècle – Saône-et-Loire, Lyon… Dans l’une, la guerre d’Algérie, dans l’autre, l’exode rural et la classe ouvrière. Dans l’une, un militant anticolonialiste assassiné, dans l’autre, une de ces ouvrières qui n’ont « pas d’histoire ».
Presque à l’opposé, dans ce troisième livre, je vais parler de colons, et précisément des grands-parents de ma grand-mère paternelle et de leur installation, au xixe siècle, en Algérie, dans la Mitidja. Bizarrement, je ne savais rien de leur histoire. Dans les souvenirs que je viens d’évoquer, Charlye parle bien sûr de sa mère – ma grand-mère Alphonsine – et de ses grands-parents, et en particulier de Berbessa, le village algérien d’Alphonsine, où elle, Charlye, s’est rendue une première fois en 1934 et une deuxième en 1940 (elle avait alors quinze ans). Sur nos « ancêtres » et précisément sur ceux dont je voudrais raconter l’histoire, elle écrit :
Je sais que les grands-parents paternels de ma mère avaient émigré de Savoie où ils étaient éleveurs. Celui qui s’est installé en Algérie le premier est d’abord venu découvrir les terres qu’on lui proposait. Ses vaches supporteraient-elles le climat ? Ensuite, il a déménagé avec toute sa famille et ses bêtes. J’en conclus qu’ils ne devaient pas être de pauvres gens.
Une sorte d’agitation officielle[2] a fait arriver, au cours des années 2010, des copies de documents d’archives chez ma mère, parmi lesquelles une lettre que ma grand-mère avait adressée, à l’été 1957, au ministre de la Justice, pour demander des nouvelles de son fils disparu, mon père, dans laquelle elle se présente comme « algérienne de naissance » et précise :
fille de colons, petite-fille de Savoyards établis en Algérie depuis 1848 et dont les descendants exploitent et habitent le même lopin de terre, la même maison que leurs ancêtres.
J’ai publié cette lettre en 2019[3], sans me douter que la réalité était un peu différente. Les ancêtres en question étaient bien des colons, et c’est l’essentiel, mais n’étaient pas exactement des Savoyards, et d’ailleurs ils n’étaient pas arrivés en 1848. C’est cette minuscule divergence qui m’a incitée, après l’avoir découverte, à aller regarder leur histoire de plus près.
Une autre raison d’écrire ce livre, c’est que je ne trouve pas inutile, en 2024, de parler de colonisation. Il m’a même semblé que l’actualité – Nouvelle-Calédonie, Cisjordanie, Gaza… – m’incitait à le faire.
Comment cela s’est-il passé ? Par hasard, comme souvent. Au cours de mes activités d’écrivaine, il m’arrive de consulter le site des Archives nationales d’outre-mer (ANOM), surtout parce qu’on y trouve des « archives du bagne ». Celles-ci incluent tous les déportés en Nouvelle-Calédonie après la Commune de 1871 à Paris, même ceux que l’on n’envoyait pas au bagne (c’est-à-dire qui n’étaient pas condamnés aux travaux forcés). Elles constituent une source d’information sur des centaines et des centaines d’inconnus, et même sur quelques inconnues, un sujet qui m’importe et m’intéresse particulièrement. Les « instruments de recherche en ligne » (IREL) des ANOM donnent aussi accès à l’état civil (colonial). Parce que les femmes condamnées à mort à la suite de la Commune ont vu leur peine commuée en travaux forcés et ont été envoyées à Cayenne, et parce que quelques-unes y ont été mariées à des forçats « libérés » et y sont mortes, j’ai consulté celui de la Guyane. Et voilà qu’un jour, je me suis égarée dans l’arbre qu’est cette page « état civil ». « Choisissez un territoire », la première option du menu déroulant était, bien avant « Guyane », dans l’ordre alphabétique, « Algérie ». J’ai choisi cette branche et m’y suis arrêtée. « Choisissez une commune », j’ai hésité, je sais que les « registres » en ligne sont plutôt anciens. Je me suis souvenue que j’avais des ancêtres nés en Algérie au xixe et au début du xxe siècle, j’ai alors fait défiler ce nouveau menu jusqu’à « Koléa », la commune dans laquelle ma grand-mère est née en 1902 : ce mot, Koléa, revenait souvent dans les histoires que je lui avais entendu raconter. Les IREL m’ont alors proposé d’indiquer un nom, j’ai tapé le sien, « Fort », les IREL ont aligné une liste d’actes, j’ai cliqué sur l’acte de naissance d’Alphonsine Fort et je l’ai lu, puis je suis revenue à la liste. Et j’ai continué à lire des actes d’état civil. Jusqu’au moment où j’ai lu une information qui m’a surprise, non pas tant parce que je l’ignorais que parce qu’elle me semblait en contradiction avec ce que ma grand-mère avait dit et écrit.
Cela aurait dû faire l’objet d’un bavardage familial : — Regarde ce que j’ai appris… — Mais non, ce n’est pas possible, Mamye disait que… — Et pourtant si. — Tu es sûre ? — Regarde, lis ça, voilà, tu me crois, maintenant ? — Malheureusement… Je me suis trouvée un peu désemparée de découvrir, à l’âge de soixante-dix ans, cet aspect de l’histoire de mes ancêtres, et de n’avoir personne à qui le dire. Mes grands-parents sont morts au siècle dernier. De la génération de mes parents, il ne reste que ma tante Charlye, qui n’a plus beaucoup de souvenirs. Mes deux frères et mon cousin Michel sont morts… J’en ai parlé avec ma cousine Lise, la plus jeune fille de Charlye, plus tard avec nos cousins Voisin, les enfants d’Aline, la jeune sœur de Charlye et de mon père, qui, doublement originaires de Berbessa, en savaient davantage.
C’est une des raisons pour lesquelles j’écris ce livre. De même qu’il n’y a plus personne pour écouter ou commenter ce que je dis, il n’y a plus personne qui pourrait en être blessé. Je n’ai utilisé, comme archives familiales, que le texte de Charlye, dont une version courte a été publiée[4], quelques phrases écrites par ma tante Aline, que ses enfants m’ont transmises pendant que j’écrivais ce livre, et des photographies. Tout le reste est public[5].
Il ne s’agit pas d’une autobiographie. Pourtant, il me semble préférable, parce qu’il est question de colons et de colonisation, de situer ma subjectivité en disant quelques mots de mon enfance en Algérie – dans l’Algérie coloniale, puis dans l’Algérie indépendante. Je parlerai ensuite, parce que c’est ma source principale, de mon expérience avec l’état civil et donc de mon arrière-grand-mère « française », Clémence, ainsi que de mes arrière-grands-mères « algériennes ». Je vous emmènerai ensuite « visiter » Berbessa – aujourd’hui et au xxe siècle.
J’en viendrai enfin à l’installation des grands-parents de ma grand-mère à Berbessa en 1851. Puisque cette histoire a commencé, pour moi, par des informations que ma grand-mère elle-même semble avoir ignorées (ou oubliées ?), j’en ajouterai quelques-unes qui ont dû jadis entrer dans la catégorie « secrets de famille », catégorie envers laquelle j’éprouve une profonde répulsion.
Tout cela sera accompagné, comme entrelardé, de digressions que j’ai trouvées indispensables, en particulier parce que, que je le veuille ou non, c’est dans la langue coloniale que j’écris, que je ne suis pas la première à le faire, et aussi sur les images ou plutôt leur absence.
[1]. Michèle Audin, Une vie brève, Paris, Gallimard, 2015 [2012] et Oublier Clémence, Paris, Gallimard, 2018.
[2]. Menant, en 2014, le président François Hollande à reconnaître, pour le moins timidement, que « Maurice Audin est mort en détention ».
[3]. M. Audin, « Maurice Audin et son arrestation – dans une lettre de sa mère », dans Sylvie Thénault et Magalie Besse (dir.), Réparer l’injustice. L’affaire Maurice Audin, Bayonne, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2019, p. 19-25.
[4]. Charlye Audin-Buono, Les roses d’Alphonsine. Jeunesse errante, Touques, Tangerine nights, 2020.
[5]. Il y a dans ce livre beaucoup de noms de personnes, en général de ma famille. Je précise qu’il y a des arbres généalogiques (derrière le rabat de couverture, p. 99 et 101), ainsi que deux index, des noms de personnes et des noms de lieux (p. 143 et 149).
Départ pour l’Algérie (extrait du chapitre 3)
Car c’est bien de Suisse qu’ils sont venus, ces grands-parents de ma grand-mère Alphonsine, ce qu’apparemment certains de leurs petits-enfants ignoraient. La participation de la population pauvre suisse à la colonisation de l’Algérie est presque négligeable (numériquement). C’est pourtant d’elle que je vais parler, et pas de la moins négligeable participation de la Suisse au « fait colonial ». Dans une exposition consacrée à celle-ci et présentée par le Landesmuseum (Musée national suisse) de Zurich en 2024, il est dit que « des entreprises individuelles et des familles ont sans aucun doute profité du colonialisme tandis que, vers 1900, la majeure partie de la population était encore pauvre et défavorisée[1] ».
Il est probable que Pierre Marie et Marguerite étaient pauvres. Comme, en ce temps-là, beaucoup plus d’un Suisse sur onze. Lorsqu’il a traversé la Suisse et le Piémont quelques années plus tôt, Michelet a mentionné dans son journal goitres et crétinisme (Berne, 15 juillet 1838), il s’est souvenu des Suisses mercenaires venus des cantons les moins riches et, en montant au col du Saint-Gothard, il a rencontré des vieillards et des enfants qui mendiaient[2]. L’historien plus récent Éric Maye parle bien de pauvres (et d’ailleurs aussi de goitres, c’est pourquoi je les ai mentionnés) dans le canton du Valais[3].
Les parents de Pierre Marie avaient quitté Saint-Maurice, au pied des dents du Midi, sur le Rhône, et étaient descendus à Collombey-Muraz, huit kilomètres plus bas, toujours sur le Rhône. C’est ce que l’on appelle le Bas-Valais. Ils y ont eu encore un fils, et puis ils sont morts. Je doute qu’ils aient changé de lieu parce qu’ils étaient riches. C’est à Collombey-Muraz que Pierre Marie et Marguerite se sont mariés. La tradition veut que le mariage ait lieu dans le village de la mariée. Elle habitait donc peut-être déjà Collombey-Muraz, mais elle était née à Vacheresse, dans le Chablais.
Ce nom de lieu s’accorde bien avec le patronyme de Marguerite, qui était une Bouvier de Vacheresse… La proximité d’Abondance semble un peu ironique. Marguerite est le « côté savoyard », par sa naissance, mais elle vivait en Suisse. Pour quelles raisons Marguerite avait-elle quitté son village ? De Vacheresse à Collombey-Muraz, il y a vingt-cinq ou trente kilomètres, mais à vol d’oiseau – et Marguerite n’était pas un oiseau. Il y a aussi une frontière : le Chablais, partie de la Savoie, était alors italien.
Les origines de la famille de ma grand-mère sont donc aussi savoyardes. Je n’ai utilisé que l’état civil. Des généalogistes[4] qui ont remonté dans les actes paroissiaux affirment que la famille du père de Pierre Marie était venue naguère d’assez loin en Savoie, mais pas celle de sa mère, qui était dans le Valais depuis des générations.
Personne n’a écrit leur histoire. Pourtant, ils ont existé, eux aussi.
Un recruteur (un bonimenteur ?) français leur a promis la richesse en Algérie. C’était le temps où la France (ou en tout cas ses dirigeants) renonçait à la colonisation pénitentiaire (les ouvriers parisiens insurgés de 1848 « transportés » là ne devenaient pas des cultivateurs…) et militaire (les « soldats-laboureurs » cultivant la terre prise à l’ennemi, chers à Bugeaud[5], n’étaient pas non plus un grand succès) et visait des Allemands, des Russes et des habitants de quelques cantons suisses. Dont le Valais. D’après Julien Franc, six cents personnes originaires du Valais ont débarqué à Alger au cours du premier semestre de 1851[6]. C’était moins cher que l’Amérique et puis… un éventuel retour serait plus facile.
Ils sont partis trois frères, Joseph, l’aîné, vingt-huit ans, Pierre Marie, vingt-cinq ans, avec Marguerite, qui en avait vingt-sept, et le benjamin, Jean, qui n’avait que vingt ans. Avec quels bagages ?
Selon les généalogistes, Pierre Marie (avec sa famille ?) a quitté « la Suisse » (à Saint-Gingolph ?) le 23 octobre, il a eu un visa à Marseille le 29 novembre. Plus d’un mois, donc, pour cette première partie du voyage. Sans doute en est-il de même des siens, quatre adultes en le comptant.
D’autres Valaisans étaient partis en famille déjà nombreuse, comme les Voisin, des voisins de Muraz, qui étaient deux parents avec au moins neuf enfants. Ils étaient peut-être tout un convoi, ils ont quitté les dents du Midi et la vallée du Rhône, passant sous les Cornettes de Bise et le lieu même où l’organisation caritative catholique Caritas-Suisse a affiché, un siècle et demi plus tard, la richesse à venir de ce qui n’était déjà plus leur pays. C’est là qu’ils ont quitté la Suisse. Peut-être un rideau de pluie leur a-t-il dissimulé leurs montagnes. Ils ont gagné Genève puis Lyon, ont longé le Rhône de France, qui ne ressemblait pas beaucoup au Rhône de Suisse près duquel ils avaient grandi, ou alors ils l’ont descendu en bateau jusqu’à Arles – c’était le plus rapide, la ligne de chemin de fer n’allait encore que d’Arles à Marseille. À Marseille, ils ont vu la mer pour la première fois et peut-être l’ont-ils trouvée bien différente de « leur » lac. Ils ont embarqué sur un navire, sans doute une corvette à vapeur. La traversée était gratuite, notamment pour les agriculteurs[7]. Je les imagine expérimenter le mal de mer, peut-être subir une tempête, ce qui ajoutait à leur angoisse – car ils étaient anxieux, ils avaient quand même quitté leur pays ! –, mais aussi s’amuser à regarder les marsouins suivre le navire. Ils ont aperçu des collines verdoyantes en approchant d’Alger, dont la blancheur et la beauté du site les ont impressionnés et peut-être ont conforté leur espoir d’échapper à la misère. Ils ont débarqué et on les a conduits à Koléa, à quarante kilomètres de là par une route alors dans un état déplorable[8]. À pied ? En diligence ? Plutôt dans des chariots ou des carrioles, plusieurs familles ensemble, les enfants dans les jambes.
Les généalogistes nous disent encore que Pierre Marie est parti d’Alger le 4 octobre 1852 et est revenu, quittant Marseille le 23 novembre. Cela pourrait être cohérent avec ce qu’a raconté Charlye : il est venu voir et est retourné chercher ses vaches.
[1]. Exposition au Landesmuseum Zürich, du 13 septembre 2024 au 19 janvier 2025, intitulée Colonialisme. Une Suisse impliquée.
[2]. J. Michelet, Journal, op. cit., p. 291.
[3]. Éric Maye, « L’émigration valaisanne en Algérie au xixe siècle », Annales valaisannes, 1997, p. 131-232, ici p. 198. En bon colonialiste raciste, Julien Franc s’autorise même « des Suisses goitreux et dégénérés du Bas-Valais, proie toute désignée pour les fièvres » (J. Franc, Le chef-d’œuvre colonial…, op. cit., p. 696).
[4]. Ce « généalogistes », que je vais utiliser plusieurs fois, fait référence au contenu de « Du Valais suisse à la région de Koléa », un CD compilé et transmis par Suzette Granger, passionnée de généalogie, à mon cousin Denis Voisin il y a déjà plus de vingt ans.
[5]. Thomas Robert Bugeaud (1784-1849), sinistre gouverneur général de l’Algérie de 1836 à 1847.
[6]. J. Franc, Le chef-d’œuvre colonial…, op. cit., p. 427.
[7]. On trouve des comptes rendus de la descente en bateau à vapeur sur le Rhône jusqu’à Avignon, quelques années plus tôt (en 1844), par Charles Dickens (Images d’Italie, trad. par Henriette Bordenave, Avignon, Alain Barthélemy, 1990 [1846]) ; voir aussi Flora Tristan, Autour de la France. État actuel de la classe ouvrière sous l’aspect moral, intellectuel et matériel : 1844, éd. par M. Audin, Paris, Libertalia, 2024. Pour la traversée de la Méditerranée, voir A. Ruscio, La première guerre d’Algérie, op. cit., p. 516-561.
[8]. L’Atlas, 26 mai 1850 (2e année, no 131, p. 1).

