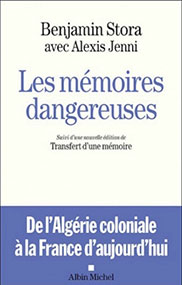
Les mémoires dangereuses. Extrait d’un dialogue
Benjamin Stora : Aujourd’hui, l’histoire du Sud n’est appréhendée que dans un rapport conflictuel par rapport à l’histoire de la France, c’est-dire à travers le prisme de la guerre d’Algérie. Or, c’est une histoire que l’on ne regarde que par la fin, et une histoire qui a longtemps été occultée de part et d’autre de la Méditerranée. Dans un premier temps, les groupes porteurs des différentes mémoires, parfois rivales, n’ont pas ou peu parlé, et au sein des sociétés, des phénomènes de déni et de refoulement ont dominé. Dans la société française, dans les années 1970, un premier groupe a fait entendre ses revendications mémorielles à travers ce que l’on a appelé « l’indemnisation des rapatriés », c’est celui des Européens d’Algérie (que l’on a appelé pieds-noirs). Un second groupe, celui des appelés du contingent de l’armée française, et des soldats, a fait valoir, pour une partie, une autre mémoire, notamment par la voie d’associations comme la FNACA. Mais dans les années 1980, un nouveau groupe a surgi dans la société, formé par les enfants ou petits-enfants issus de l’immigration algérienne, qui sont, eux, porteurs d’une mémoire différente.
Aujourd’hui, la mémoire de cette guerre fait retour, massivement, dans les deux sociétés, algérienne et française, et elle est désormais portée, sous des formes extrêmement diverses, par les enfants de ces millions de Français qui ont connu, d’une manière ou d’une autre, l’Algérie française 1. Mais cette part mémorielle en France fait écran à un autre pan d’histoire, bien plus gigantesque, celui de la colonisation. Ce « bloc » d’histoire, qui se trouve précisément à l’origine de la guerre d’Algérie, reste encore largement à explorer, à étudier. Car, en dépit de l’immense travail accompli par les historiens dans le champ des études postcoloniales, la société française n’a pas vraiment mémorisé l’histoire coloniale. Elle est demeurée une question périphérique. Cette histoire du Sud n’était pas vraiment intégrée à l’histoire intérieure française. La France se considérait comme le centre d’une histoire profondément européenne, occidentale, absolument pas comme partie prenante d’une histoire venant de l’Afrique ou du monde arabe. Là se trouve, en partie, le refoulement dans la société, ou plutôt la dénégation de la guerre d’Algérie : dans la méconnaissance de l’histoire coloniale. C’est très sensible dans le cinéma, et la littérature, et à cet égard, votre roman, L’Art français de la guerre est très révélateur d’un désir français, nouveau, de s’approprier cette histoire pas si lointaine.
Alexis Jenni : Au cours des rencontres qui ont été organisées pour parler de ce roman, j’ai souvent témoigné de mon étonnement : même si on connaît les faits qui constituent la guerre d’Algérie, celle-ci n’est toujours pas racontable. Pire : nous fantasmons sur des choses très simplifiées. Cet épisode est relégué à la périphérie de notre histoire, alors qu’il est fondateur de ce que nous vivons.
Je pense aussi que l’histoire des Maghrébins doit faire partie de l’histoire de France : j’avais l’habitude de dire que si l’on veut sortir de cette crise identitaire où nous sommes, il faut agrandir l’histoire de France. Pour que nous puissions avoir une histoire commune avec tous ceux qui composent la France, et empêcher que se perpétuent ces tensions dues à un passé impossible à raconter, il nous faut agrandir notre passé, que l’histoire de notre ancien Empire colonial fasse pleinement partie de l’histoire de France. Par la voie du romanesque, d’une façon plus intuitive, j’arrivais donc à peu près aux mêmes conclusions. Cette réécriture est indispensable, parce que cette part de notre histoire a profondément et silencieusement infusé dans l’imaginaire français, bien plus que nous pouvons le croire.
B. S. : Cet « agrandissement de l’histoire » est d’autant plus nécessaire que nous assistons aujourd’hui à une forme de cloisonnement inédit des mémoires qui prend la forme de la communautarisation du souvenir. Désormais, les différents groupes de mémoires n’adressent plus leur demande d’intégration à l’histoire à l’État, mais la revendication se fait dans une concurrence victimaire par rapport aux autres communautés. Or, dans cet abandon à la périphérie, les religieux se sont engouffrés pour capter la génération des trentenaires-quarantenaires à qui l’on n’a jamais appris l’histoire coloniale. Le risque est donc réel d’une prépondérance des mémoires communautarisées, qui ne permettent pas la circulation, ni le métissage des mémoires, alors que c’est là seul moyen que l’histoire, d’une manière ou d’une autre, ne se rejoue pas.
La France se trouve aujourd’hui face à la violence des mémoires. Au cœur de cette violence, il y a le souvenir de la guerre d’Algérie qui n’a pas été l’objet d’un récit national, à la fois unifié et laissant place à la pluralité. Le problème soulevé par la date du 19 mars, comme moment de commémoration signifiant la fin de la guerre d’Algérie, est à cet égard symptomatique. Les Européens d’Algérie considèrent que la guerre ne s’est pas terminée le 19 mars 1962. Ils invoquent à juste titre le massacre de la rue d’Isly du 26 mars 1962, à Alger, où 46 Français d’Algérie ont été tués, et les enlèvements d’Européens à Oran le 5 juillet. Cette absence de consensus sur une date signifie qu’il est difficile de se réconcilier, que la mémoire retrouvée ne suffit pas. Aujourd’hui cette absence est exploitée politiquement et donne lieu à des affrontements mémoriels d’une grande violence symbolique : en 2015, les maires de Béziers et de Beaucaire, tous deux affiliés à l’extrême-droite, ont ainsi choisi de débaptiser des rues du « 19 mars 1962 », à grand renfort de références à l’Algérie française. Ces conflits mémoriels réinstaurent quelque part une sorte de hiérarchie des communautés liées à l’histoire de l’Algérie coloniale.
A. J. : Cette bataille culturelle, qui porte sur la connaissance de l’histoire des pays du Sud, et donc du lien historique indéfectible que la France entretient avec eux, c’est un programme fort. Cela permettra de remettre les tensions sociales dans le cadre de l’histoire, et l’histoire est le milieu réel dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des débats fumeux, c’est la prise de conscience que nous sommes dans l’histoire, et que nous sommes des acteurs de l’histoire. Et tout le délire actuel – car il s’agit bien d’un délire – sur l’identité nationale, notre identité perdue, l’identité malheureuse à la Finkielkraut, ou cette identité fixe et définitive que l’on prête aux autres, tout ceci est un essentialisme agressif. L’identité nationale est quelque chose qui n’existe pas, ou bien qui est en débat permanent, ou bien est toujours à construire, mais il n’y a pas une identité comme il y aurait un programme génétique inscrit dans l’ADN : ça n’existe pas dans une société. En revanche, le discours dominant en France actuellement est de « croire » à l’identité, mais une identité qui serait toujours perdue, ou menacée, par le fantasme menaçant de celle de l’autre. C’est terrible, car c’est totalement détaché du réel, ça ne produit que de la violence, et ça ne contribue pas à construire une nation commune où vivre ensemble.
C’est ce qui se passe depuis des années, et encore plus depuis les évènements de janvier 2015 : on va chercher dans le Coran, comme s’il s’agissait de l’ADN des sociétés arabo-musulmanes, les signes d’une violence qui serait inhérente à l’islam et qui pourrait expliquer le terrorisme, ou bien on recherche des exemples historiques pour faire des musulmans des acteurs par essence violents, ou bien on croit sur parole les islamistes de Daech quand ils disent appliquer l’islam à la lettre, pour démontrer la nature violente de l’islam. Ce qui est terrible, c’est que ceux qui se livrent à ces hypothèses essentialistes se donnent l’air d’érudits, qui connaissent bien la question, qui ont bien lu les textes. Ces supputations sur la prétendue nature des musulmans sont tout à fait absurdes, car jamais une religion ne se vit comme c’est écrit dans les textes. Ceux qui appartiennent aux religions dites du Livre ne peuvent pas suivre le Livre, parce que ni la Bible, ni les Évangiles, ni le Coran ne sont très clairs sur comment vivre, malgré ce que prétendent ceux qui en font une interprétation rigide et unique, en niant le fait qu’ils interprètent. Tout croyant, qu’il soit juif, chrétien, ou musulman, va négocier en permanence sa vie par rapport à des grands principes culturels, religieux, moraux, qui varient énormément dans l’histoire. Or, le problème aujourd’hui, c’est qu’on parle d’identité avec une grande assurance, en ne se rendant pas compte qu’il s’agit d’une fiction, assez idiote dès qu’on essaie de la préciser. C’est une ignorance de l’histoire, une ignorance du fonctionnement de la société, une ignorance de la vie réelle des gens, qui ne suivent pas les textes, Dieu merci…
Ce qu’il faut affirmer c’est sans doute l’existence de liens transméditerranéens : affirmer qu’une part de l’histoire de France est du côté de la Méditerranée. Et puis, par rapport à ces populations qui sont ressenties comme étrangères par toute une partie de l’opinion publique, réaffirmer régulièrement qu’elles ne sont pas des émanations d’un autre pays, mais qu’elles sont constituantes de la population française. C’était le sens de votre discours au Musée de l’Histoire de l’Immigration2 : cette histoire n’est pas une histoire extérieure, ni périphérique, elle est centrale dans l’histoire de France. La question de l’immigration, aviez-vous dit, n’a pas à être reléguée dans les banlieues de l’histoire. Nous nous sommes constitués de ces différentes vagues d’immigration, et les quelque quatre ou cinq millions de musulmans en France, que l’on ne sait pas exactement compter, et tant mieux, qui sont si divers, sont citoyens français.
B. S. : Après ce choc gigantesque de janvier 2015, ceux qui appartiennent à la tradition, à la culture musulmane se sont dit : « on est Français 3 ». Tous. Même s’ils ont dit « on n’est pas tous Charlie », même s’ils ne défendent pas les caricatures qui ont été faites du Prophète, sur la base du sacré que l’on ne peut attaquer, tous ont dit, « notre pays, c’est la France, on n’a pas d’arrière-pays. » Les musulmans de France se sont « réveillés » dans le choc en disant : « nous aussi, nous sommes là pour défendre la République, mais à notre manière. » À notre manière, c’est cela la grande question à laquelle il nous faut être attentifs. Leur position est bien celle d’une défense de la République française, mais une défense qui s’opère à partir de cette histoire du Sud, qui n’est pas forcément l’histoire européenne. C’est cela que j’ai ressenti profondément dans les rencontres qui ont suivi ces jours terribles : il n’y a eu aucune remise en cause de l’appartenance française et républicaine, mais la revendication d’inscription de l’histoire du Sud dans le récit national français. Dans le « choc de Janvier », il y a le fait de se découvrir en étant profondément attaché à la République, à la France, il y a la volonté de rentrer en politique, de trouver des alliés et de s’investir davantage dans la gestion de la cité, de l’école. Une prise de conscience s’est opérée dans le fait de réaliser que l’on ne peut pas demeurer immobile, après cette dérive terrifiante.
Aujourd’hui, il nous faut entendre que les musulmans veulent défendre la République « avec leur histoire ». Cela signifie que nous devons chacun connaître cette histoire du Sud. Si on veut comprendre ces populations de cultures musulmanes différentes, il nous faut aussi faire l’effort de savoir quelle est leur histoire, quelles sont leurs élites antérieures, leurs parcours, quelle est l’histoire de leur rapport avec la France. Sans quoi, les uns comme les autres vont retomber dans le « eux » et le « nous », cette dichotomie distillée dans le langage le plus ordinaire… Alors le rappel de début 2015, c’est que ces Français, Républicains, sont dans le « nous », un « nous » profondément républicain.
Je pense à cet égard que notre modèle républicain est plutôt une réussite : ces dernières décennies, ces Français « nouvelle manière » sont entrés dans la société, tout en maintenant un profond attachement à leurs cultures d’origine. Bien sûr, il y a des individus radicalisés qui entendent détruire le système, mais ils ne doivent pas faire oublier l’immense majorité des descendants des immigrations maghrébines postcoloniales qui ne se vit pas autrement que comme française.
A. J. : J’ai écrit L’Art français de la guerre en me documentant par moi-même, mais après sa parution, j’avais été très frappé de réaliser l’ignorance extraordinaire des gens sur l’histoire coloniale en général : notre propre histoire nous est totalement méconnue. Je tombais des nues : moi qui ne suis pas historien du tout, je me suis rendu compte que tout ce que j’avais trouvé facilement était ignoré par le public – je n’étais pas chercheur, je n’avais pas fréquenté des bibliothèques universitaires pour trouver ce dont j’avais besoin pour écrire sur l’Algérie coloniale, j’ai seulement ramassé ce qui était accessible au grand public. Je me suis rendu compte de l’ignorance à l’égard de notre histoire, et aussi de l’ignorance à l’égard de l’histoire des autres, qui est encore plus profonde.
Heureusement, en France, les ressources intellectuelles sont nombreuses, et diffuser ce savoir est possible. Il existe encore de nombreuses zones confuses à explorer, à éclairer. Pour les pays du Sud, la plupart des États ont tout intérêt à effacer soigneusement les traces de l’histoire pour fonder un récit national qui les légitime. Mais il existe des institutions universitaires qui cherchent, et des communautés de chercheurs qui contribuent à éclairer ces zones confuses. La diffusion de ces savoirs est cruciale pour sortir des fantasmes. Même si le fantasme a la peau dure, et ne cède pas facilement…
B. S. : Cette bataille culturelle pour connaître l’histoire du Sud représente un effort difficile car les Français ne sont pas armés. Ils se sont vécus depuis toujours comme formant une Grande Nation, au centre du monde ; ils n’ont pas ressenti la nécessité de connaître les langues étrangères, ne se référant qu’à des auteurs français. Il ne faut pas minimiser l’importance de ce souvenir de la grandeur française, du xixe siècle, qui était le grand siècle de la littérature française – et qui contribue encore aujourd’hui au rayonnement de la littérature contemporaine française et francophone à l’étranger. Il y a encore ce souvenir ineffaçable de la grandeur historique passée de la France, qui a rayonné avec les Lumières et la Révolution française. Nous avons du mal à voir que nous sommes aujourd’hui dans un univers de la mondialisation culturelle et qu’il nous faut affronter les défis propres à cette mutation majeure. Aujourd’hui, il y a de grandes puissances qui émergent : il faut connaître les langues étrangères, voyager, circuler. Il y a aussi d’autres histoires que celles européennes : il faut les posséder ou tout au moins les approcher, faire l’effort de les comprendre. Cela signifie qu’il faut réformer des programmes scolaires, et penser des lieux de savoir différents. J’avais proposé des lieux de savoir ouverts où l’on puisse venir enseigner l’histoire des civilisations différentes. Car je crois qu’il y a là un travail de fond à mener pour que les Français s’ouvrent au monde.
Car les Français sont appelés aujourd’hui à cette ouverture, et ne peuvent pas rester dans une sorte de repli, d’entre-soi. Le défi, c’est l’ouverture au monde. Il s’agit d’un défi compliqué, mais le repli serait un choix paresseux.
A. J. : D’autant plus que se replier sur soi, c’est se replier sur rien. La France étroite n’a pas de contenu. La République a vocation à être universelle, à accueillir tout le monde, d’où que ces personnes viennent, elle a accueilli beaucoup de personnes et elle en accueillera d’autres. Le choc de janvier a permis de prendre conscience de cela.
B. S. : Il faut au plus vite resserrer le lien entre la nation et la République. Parce qu’il y a un vrai risque de dilution, de distanciation entre les communautés et entre les générations. J’ai parlé de la nécessaire réforme des programmes scolaires, mais il faut également s’attaquer à la non-représentation de la nouvelle génération. Alors que la société française a profondément changé depuis vingt ans, alors qu’ils sont frappés de plein fouet par le chômage et l’insécurité, les moins de 25 ans sont totalement oubliés. Ils ne sont pas représentés dans les partis politiques (en France, tous leurs leaders ont entre 50 et 70 ans, très loin de Matteo Renzi ou d’Aléxis Tsípras) ni dans les syndicats, pas davantage dans les médias. Or non seulement ils ne sont pas représentés, mais on ne les écoute pas. Ils sont dans une panne d’avenir. D’où cette colère de la jeunesse voire cette forme de hargne, terrible, à l’égard des anciennes générations. Cela explique en partie le phénomène Dieudonné, comme le mouvement du « je ne suis pas Charlie » chez certains des moins de 25 ans. Cela ne veut pas dire qu’ils approuvent les terroristes mais ces prises de position constituent autant de défis à l’autorité et au consensus bien-pensant.
Aujourd’hui, c’est le moment ou jamais. Il faut une prise de conscience et une volonté très forte, de favoriser enfin les nouvelles générations. C’est bien plus important encore que la parité hommes-femmes, la diversité et la réforme des institutions. Dans cette bataille, nous ne pourrons pas nous contenter de symboles. Il faut une révolution culturelle – presque un Mai 68 – pour que les partis, les syndicats, les médias, les établissements publics, les mouvements associatifs laissent plus de place aux jeunes. C’est très compliqué, très long, mais il faut bien prendre la mesure du danger. Le fossé générationnel est à haut risque. Une société ne peut pas oublier ceux qui représentent l’avenir.
Et elle ne peut pas non plus faire l’économie d’une mise en récit qui les inclue, tous, dans l’Histoire. D’un récit qui s’interroge sur ses racines, sur les mots, comme celui d’« intégration », d’« assimilation », car ces termes ont une histoire, souvent surprenante, que l’on ne peut pas nier derrière des discours simplificateurs.
- Ce sont trois millions de personnes environ qui sont en Métropole en 1962 après avoir connu l’Algérie française : essentiellement des soldats (1,2 million), des pieds-noirs (1 million), immigrés (400 000) ou harkis (100 000).
- Benjamin Stora, « Discours prononcé à l’occasion du vernissage de l’exposition permanente Repères », le 15 septembre 2014, Cité nationale de l’histoire de l’immigration : « C’est une façon de concevoir l’histoire de France qui est nouvelle, en rupture avec une vision de l’immigration située manière éternelle en dehors, dans les banlieues de l’histoire, en dehors de l’histoire nationale. Alors qu’elle est précisément une part constitutive de la nation, de l’histoire française. »
- Un exemple dans Libération, daté du 13 février. « Le Portrait » de la dernière page est consacré à Farid Abdelkrim, ancien membre de l’UOIF, la branche proche des Frères musulmans en France, désormais humoriste et disciple de Tareq Oubrou, il dit : « Comme le dit Tareq Oubrou, on ne peut pas penser l’islam en France sans les non-musulmans, soutient-il. [Moi] je refuse d’être pris en otage dans un “nous”, du genre, “nous les musulmans, nous ne serrons pas la main des femmes”. Au plus profond de moi-même, je suis français. »

