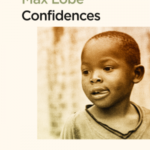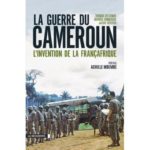La question de la violence coloniale repensée par l’artiste Sylvie Blocher et l’écrivain Max Lobé
Les Inrockuptibles, source
Qu’ont à dire les artistes et écrivains de la question de la violence du processus colonial ? Si elle reste souvent un point aveugle du débat public, elle fait aussi l’objet de travaux approfondis. C’est le cas de l’artiste Sylvie Blocher, qui a exposé à Douala une œuvre demandant pardon au peuple camerounais pour les crimes de la colonisation française, et de l’écrivain camerounais installé en Suisse Max Lobé. Les deux partagent ici leurs points de vue dans une conversation engagée.
La question de la mémoire occultée, contre laquelle se sont élevées les luttes anticoloniales des années 1960 dans le champ politique, puis les études postcoloniales dans le champ des sciences sociales dans les années 1980-90, reste un angle mort dans la société française. Malgré les progrès récents du savoir sur ce passé ombrageux, une majorité de citoyens ne prend pas encore la mesure des violences du processus colonial. En quoi, selon vous, les artistes peuvent-ils s’emparer de cette question et participer, à leur manière, au dévoilement d’une réalité historique ?
Sylvie Blocher – Oui, c’est troublant de voir à quel point la société française n’a aucune idée des exactions et des massacres commis par notre pays dans nos ex-colonies. Ce passé est resté confidentiel. Nous n’avons pas non plus réussi à accueillir ceux qui venaient des pays que nous avions volés et exploités. Nous n’avons même pas réussi à les nommer ! On appelle encore « fils ou filles d’émigrés de 1ère ou 2e génération » ceux qui sont français. Nous ne sommes pas arrivés non plus à nous imaginer hors d’une hégémonie blanche. Ce blocage a fonctionné dans les entreprises, les banlieues, à l’université, dans les syndicats, dans les mairies, à la télévision, dans la culture. Notre passé colonial s’est muré dans le silence ou les non-dits et c’est dans cet angle mort que reposent les cadavres et les crimes impunis. Nous le payons aujourd’hui en amertumes communautaires et en extrême droite populiste. Pire, durant toutes ces années, n’accueillant pas les savoirs qu’apportaient « ceux qui ne nous ressemblaient pas », notre pays a fait de l’exception française un « entre soi ».
Les artistes peuvent s’emparer de ces questions d’une autre façon que les politiques. Dans les années 80, quand je confrontais ma mémoire familiale au récit national, ça ne collait pas. C’est en montant Nuremberg 87 pour le festival d’Avignon en 1987, que j’ai été confrontée à la difficulté du droit à parler de l’extermination. Mon travail a toujours été hanté par la reconstruction de soi, à cause d’une enfance meurtrie. Comment faire pour se reconstruire quand les bourreaux courent toujours, qu’il n’y a pas d’excuses, de sanctions ou de réparations ? On pourrait faire une cartographie mondiale des communautés meurtries. C’est une des fonctions de l’art de toucher aux ombres des humains, de dévoiler, infiltrer, de forcer le passage.
Max Lobé – Je suis plutôt d’accord avec Sylvie. Je comprends qu’elle veuille mettre la France face à ses responsabilités : c’est le moins qu’on puisse faire. Cependant, je voudrais questionner le rôle des gouvernants camerounais dans cette histoire. Est-ce donc à la France d’introduire ce passé trouble dans les livres d’histoire au Cameroun ? Est-ce donc à la France de le programmer dans les manuels scolaires camerounais et de l’enseigner aux nouvelles générations ?
Bien sûr, la France est toujours aux affaires et je la comprends. Je la comprends d’autant plus qu’il s’agit là de défendre ses intérêts nationaux (militaires, économiques, etc.) et surtout, de choyer son image. Pense-t-on un seul instant que la France présentera des excuses à tous ces morts et cet océan de sang ? Je le souhaite vivement. Mais je suis lucide : cela est loin de se produire. J’ai même envie de dire que cela ne se produira jamais. On a vu l’actuel président français (Emmanuel Macron) évoquer la guerre d’Algérie (qui se passe au même moment que la guerre du Cameroun) puis rebrousser chemin sur la pointe des pieds. Ce sont des questions hautement politiques qui, je dois l’avouer pour m’y être frotté, dépassent dans une certaine mesure — si ce n’est largement — le champ d’action de l’artiste.
En revanche, l’artiste devrait avoir la liberté qui lui permette de revenir sur ces épisodes critiques de notre histoire commune. Il est le témoin de son époque, de l’évolution de la pensée à laquelle il participe. Il questionne. Il refuse l’oubli. Il crée des ponts mais n’oppose pas. Je m’explique. Sylvie parlait de montée des communautarismes et des populismes de droite à la suite de l’omerta sur les pans sombres de l’histoire coloniale de la France. Je pourrais ajouter à cette liste le terrorisme. La colonisation est un facteur important dans l’enrôlement des jeunes au sein des groupes radicalisés comme Boko Haram : j’ai pu le « voir » sur place à l’extrême-nord du Cameroun. Ces terroristes visent l’Occident, la France entre autres. Ils tuent de nombreux innocents occidentaux (ou pas, d’ailleurs). Aussi, je ne crois pas que l’artiste doive rajouter de l’huile au feu. La situation est déjà assez sensible pour qu’on pointe untel ou untel du doigt. Ce serait trop facile, d’ailleurs. Je crois que l’artiste doit justement créer des ponts en travaillant avec les historiens pour informer, pour tuer le silence et redonner de la dignité aux peuples meurtris.
Les artistes peuvent et « doivent » aider à faire de petits pas, des tout petits pas vers la lumière, vers la reconnaissance de « la » vérité. Ils peuvent amener les politiciens à avoir le courage de prendre leurs responsabilités. Ça prendra du temps.
Sylvie Blocher, vous avez récemment participé à Douala, au Cameroun, au festival d’art contemporain « Salon urbain » où vous exposiez une œuvre demandant pardon au peuple camerounais pour les crimes de la colonisation française. Comment vous est venue cette envie de réactiver cette histoire douloureuse ?


S. B. – J’ai participé à la triennale SUD 2017 en décembre à Douala. Tout a commencé par la lecture du livre La guerre du Cameroun. L’invention de la Françafrique (1948-1971) de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa. Ça été comme un uppercut dans l’estomac. J’ai appris comment, à partir de 1948, des militaires français, pour combattre toutes velléités d’indépendance, ont participé, ou ont aidé, à exterminer des milliers de Camerounais en pays Bassa, Bamiléké, en Sanaga Maritime, à raser des villages, violer des femmes, exécuter des enfants, enflammer au napalm depuis des hélicoptères le quartier Congo à Douala, liquidant une population encerclée.
J’ai appris que des responsables français sous le général de Gaulle puis sous Georges Pompidou — comme Jacques Foccart et Pierre Messmer — ont promu la torture et le meurtre pour imposer une fausse indépendance avec la nomination d’un président sanguinaire à leur botte. J’ai appris comment les services secrets français ont liquidé les uns après les autres les dirigeants indépendantistes de l’UPC (Union des Populations du Cameroun) en toute impunité. Mais j’ai surtout appris quelque chose qui me touchait personnellement et qui m’a engagée dans cette histoire : des résistants français, qui étaient là à l’ouverture des camps de concentration nazis, ont tué à leur retour des Camerounais. A cause de mon passé familial, la figure du résistant était intouchable. Ça m’a rendu malade et une nuit j’ai fait un rêve étrange : je présentais mes excuses au Cameroun.
M. L. – C’est bien que Sylvie souligne tout cela. C’est fondamental. Dans ce qu’elle vient de mentionner, je retiens deux choses. La première étant la figure de Charles de Gaulle. Il est intouchable en France. Qui pourrait, dans la classe politique française actuelle, se permettre de critiquer le Général ? Et pourtant, faites un tour dans les villages camerounais rasés au napalm sous ses ordres… Il y est honni ! Le héros des uns n’est rien d’autre que le bourreau des autres. Et puis, est-ce qu’il faut préciser que Pierre Messmer, ancien administrateur colonial au Cameroun ou encore en Côte d’Ivoire, connu pour ses méthodes violentes, a été « promu » premier ministre sous Pompidou ? Quelle belle récompense après avoir massacré des foules entières !
La deuxième chose que j’aimerais souligner est liée aux camps de concentration au Cameroun (j’en parle très bien dans mon roman Confidences). Il y a eu des camps de concentration au Cameroun. Il faut, d’emblée, faire une différence entre les camps de concentration et d’extermination. Au Cameroun, les camps de concentration étaient joliment appelés : Zones de pacification ! La technique ici est celle utilisée dans une certaine mesure pendant la guerre d’Indochine, mais aussi par les Nazis contre les Alliés : on concentre les populations dans un camp pour mieux les contrôler et mettre la main sur les leaders. Et donc tuer la résistance.
Comment les Français qui se sont-ils fait aider par des Africains (qu’on a grossièrement appelés : tirailleurs sénégalais, même si en réalité ils venaient de toutes les colonies françaises d’Afrique) ont-ils retourné leurs armes contre ces derniers en leur appliquant des méthodes de Nazis ? C’est quand même un manque de loyauté incroyable. Comment peut-on l’expliquer ? La sauvegarde des intérêts nationaux de la France. On est prêts à tout pour les intérêts de la nation.

Votre œuvre, Sylvie Blocher a suscité une controverse et a été détruite par des activistes. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette controverse et en quoi elle participe d’une censure à la fois artistique et historiographique ?
S. B. – Au Cameroun, la mémoire est sous l’embargo d’un état autoritaire. Parler de Ruben Um Nyobé, le jeune juriste UPC qui a lutté et donné sa vie pour l’indépendance dans les années 50 — plaidant à l’ONU pour un pays libre et égalitaire entre hommes et femmes — a été un délit puni de prison. Aujourd’hui, c’est toujours le silence.
Après son exécution, son corps a été défiguré. Le philosophe Achille Mbembe, écrit que les forces coloniales ont voulu « détruire l’individualité de son corps et le ramener à une masse informe et méconnaissable ». Il repose à Éséka sous un bloc de béton. Ses funérailles ont été interdites alors qu’au Cameroun, il y a un attachement quasi-divin à l’enterrement des morts pour établir des rapports bienfaisants avec les parents disparus. Même chose pour Félix Roland Moumié, empoisonné à Genève le 3 novembre 1960 par les services secrets français ou pour Ernest Ouandié, fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam à la demande de Jacques Foccart, pour « préparer » le voyage de Georges Pompidou au Cameroun !
Lors mon premier séjour à Douala, j’ai rencontré David Ekambi, un combattant UPC des années 70, qui a passé trois années dans la terrible prison politique de Tcholliré. Il m’a appris l’histoire de son pays. Nous avons développé une amitié. Il attend toujours l’arrêt de la fausse indépendance du Cameroun et les excuses de la France, persuadé que la démocratie ne pourra venir qu’à ce prix.
J’ai alors commencé à le filmer et à imaginer une œuvre éphémère pour la triennale : une silhouette me représentant tenant un panneau portant l’inscription suivante « Bien que je n’en aie pas le droit, je vous présente mes excuses », où je prenais le droit de dire ce que je n’avais pas à dire. Je crois que je ne l’aurais jamais réalisée si, au moment de présenter le projet à la direction de la Triennale, les artistes camerounais présents n’avaient pas tous plaidé pour qu’elle soit réalisée. Puis, le directeur d’une entreprise de Douala m’a proposé de la construire gratuitement pour la Triennale, sous couvert d’anonymat, sa famille ayant violemment souffert des pratiques mafieuses de la Françafrique. C’est à eux que je l’ai dédiée.
La silhouette devait être posée sur le rond-point de Bonakouamoua, où il y avait eu déjà une tentative de l’activiste Blaise Essama de mettre la statue d’un résistant anglophone. Puis, Blaise, que je connaissais et à qui j’avais proposé de poser l’œuvre ensemble, a instrumentalisé la situation. Je ne savais pas qu’il collaborait avec Radio-TV Equinoxe et que la destruction de ma pièce avait été programmée pour être filmée en direct et faire le buzz. Il a réussi et son action lui a rapporté de l’argent. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.
Les Camerounais se sont divisés autour de l’œuvre — pour ou contre — et les journalistes aussi et sa disparition l’a rendue encore plus présente. Radio Equinoxe a fait machine arrière en m’invitant à venir parler de ce geste artistique pendant 52 minutes, à une heure de grande écoute, avec l’excellent journaliste Duval Fangwa, alors que l’œuvre n’était plus visible. Un moment important.
A l’inverse le représentant de l’AFP à Yaoundé a fait une dépêche « pro-gouvernement » de la situation — reprise par le journal Le Monde — présentant la destruction comme une demande de tout le peuple Camerounais et moi comme une sorte de colonialiste un peu naïve (Ha ! Ha ! forcément les femmes ça ne comprend rien). Il est venu s’excuser ensuite en évoquant la pression de sa hiérarchie, etc. Ce qui est indéniable, c’est que cette silhouette de moins de 3 mètres de hauteur a fait riper le silence imposé autour de la question de la mémoire et est devenue, d’un seul coup, une sorte d’objet de transfert de toutes les douleurs et frustrations d’un passé colonial effacé. Mais cette œuvre interpellait aussi le président de la République française.
Max Lobé, vous qui êtes né au Cameroun, et vivez aujourd’hui en Suisse, comment analysez-vous la manière dont l’Etat camerounais lui-même tend à étouffer ce passé et à éradiquer ses souvenirs blessés ?
M. L. – L’État camerounais d’aujourd’hui (et sans doute depuis sa naissance) est dirigé par des profils plutôt compatibles à la politique étrangère de l’Élysée. Ces dirigeants ont en quelque sorte une dette envers ceux qui leur ont « confié » le pouvoir. Ils ne peuvent pas cracher dans la soupe. Les gagnants de la guerre (la France et une certaine élite camerounaise sortie du moule français) ont pris le pouvoir. Ils n’ont aucun intérêt à raconter cette histoire. Cela me semble logique !

À la limite, ils la raconteront comme les vainqueurs de la guerre racontent la guerre. Ils n’ont jamais rien fait de mal. D’ailleurs, François Fillon en visite au Cameroun en 2009, parlait des exactions camerounaises comme de pures affabulations. Mais, je me demande aussi si les Camerounais eux-mêmes veulent en parler. Lorsque j’ai été dans les villages Bassa de la forêt du Cameroun en 2014, il n’a pas été facile d’avoir les témoignages des rescapés. Le fait que je parle Bassa m’a certainement aidé. Mais en général, je crois que les survivants et rescapés ne souhaitent pas vraiment en parler. Est-ce à cause de la honte que l’on ressent après une telle humiliation ? Quel grand parent voudrait raconter à son petit enfant, assis sur ses genoux, que son peuple a été (et est) tué par des forces étrangères ? Chez nous, c’est une honte extrême. Ça se cache !
Les Camerounais sont trop fiers pour s’ouvrir comme ça et raconter qu’ils ont été martyrisés. Je me demande s’il n’y a pas là une explication à ce qui s’est passé à Douala avec l’œuvre de Sylvie. Ils ne veulent pas qu’on s’empare de cette question — qui plus est, que ce soit une Blanche, une Française qui le fasse. Vous savez, il a fallu beaucoup de temps aux survivants des grandes crises — je pense notamment au génocide des années 1940 — pour dire la douleur qu’ils avaient vécue. Laissons donc peut-être du temps aux Camerounais (je pense notamment aux familles qui l’ont vécu dans leur chair). Peut-être voudront-ils en parler… lorsque leur gouvernement les encouragera à le faire. Leur gouvernement à eux, pas celui qui leur a été « proposé ».
S. B. – Est-ce pour cela que tu as écrit depuis la Suisse où tu vis que j’avais du courage alors que l’on ne se connaissait pas ? A Douala, les personnes contre disaient : « C’est une blanche. On ne peut pas croire les blancs ». D’autres qu’il « ne faut pas parler de cette époque », ou qu’il « faut être des hommes forts et ne pas demander d’excuses ». Mais d’autres disaient « les excuses sont nécessaires pour commencer à apprendre à la jeune génération notre passé », ou « nous attendons depuis toute une vie des excuses et une réparation financière », ou « si on ne commence pas à parler entre nous de notre histoire rien ne changera jamais ». Le terrorisme de Boko Haram permet de cacher tout ce qui ne va pas au Cameroun. Dans le reste du monde aussi.
Dans l’un de ses livres, Sortir de la grande nuit, essai sur l’Afrique décolonisée, le philosophe Achille Mbembe, d’origine camerounaise, estime que « le colonisateur est parti mais reste présent partout et en tout ». Cette présence opaque vous semble-t-elle, Max Lobé, un obstacle au développement souverain de l’Afrique ?
M. L. – Oui. Je réitère que tout cela dépend de la force des acteurs en jeu et surtout de la volonté des uns et des autres de défendre leurs intérêts. La France est forte par rapport au Cameroun. C’est un constant. Elle peut donc imposer les règles du jeu.
Le colonisateur n’est jamais parti et il serait quand même un peu sot de croire le contraire. Pourquoi partirait-il ? Pourquoi s’en aller quand on a encore beaucoup d’intérêts à défendre dans son ex-colonie ? On parle aujourd’hui de restitution des œuvres d’art volées à l’Afrique. Laissez-moi donc sourire. Pourquoi les œuvres d’art seulement ? Il y a bien de choses à restituer au continent : or, uranium, pétrole, diamant, et j’en passe tant la liste est longue. Non, je ne crois pas que ce dont les Africains ont le plus besoin aujourd’hui, ce soient les œuvres d’art. Pourquoi pas légiférer sur le secret fiscal entre les pays d’Afrique et leurs colons ? On pourrait peut-être rapatrier ainsi bien des deniers publics volés et cachés quelque part en Occident…
Après, s’ils réussissaient vraiment à retourner les œuvres d’art africaines à la maison, ce serait peut-être une bonne chose. Une voix me souffle que l’instabilité socio-politique dans ces pays ne garantira pas forcément la protection nécessaire à ces œuvres, une fois de retour à la maison.
Le colon ne pliera jamais ses valises tant qu’on ne l’y oblige pas. Or ces pays n’ont pas les moyens nécessaires de contrainte pour demander le départ du colon. Pire, on lui tend toujours la main pour demander de l’aide internationale pour l’aide au développement. Belle mascarade, non ? La Banque mondiale et les autres institutions de Bretton Woods supervisent l’opération comme ils peuvent, tout en garantissant, bien sûr, les intérêts d’une partie et pas forcément de l’autre. C’est dommage.
A quelle fonction — critique, politique, mémorielle, subversive — rattachez-vous votre conception de l’art ?
S. B. – Je ne fais partie d’aucun groupe. Dans mon enfance je baignais dans les romans de Faulkner. Je me suis passionnée très tôt pour Angela Davis, son féminisme ouvert aux autres cultures et ses analyses du fonctionnement de l’économie capitaliste américaine, basée sur l’enfermement de la communauté afro américaine. J’écoutais Nina Hagen, Janis Joplin, Patty Smith, les Stones et m’envolais sur les solos de Jimi Hendrix. J’ai été nourrie à Hannah Arendt et à Michel Foucault. Je suis de la génération qui a forcément lu Surveiller et punir.
Après, ça a été la rencontre avec les écrits d’Edouard Glissant, et ses théories sur la créolisation et le décentrement grâce au concept d’archipel. Il m’a réconciliée avec une philosophie qui ne niait ni le corps, ni les affects, ni la poésie. Annie Ernaux et Didier Eribon m’ont aidé à déconstruire l’endroit d’où je viens et à ne pas l’oublier. Jacques Rancière, Achille Mbembe sont avec leurs écrits des compagnons de route. Ma famille d’adoption est mémorielle, colorée, émancipatrice, radicale. Elle m’a permis de m’inventer autrement et d’imaginer des protocoles artistiques pour y arriver.
M. L. – Je me sens très proche des courants de pensées que Sylvie vient d’énoncer. J’ajouterai bien Mongo Beti. L’essayiste et romancier camerounais s’est posé toutes ces questions dont nous discutons bien avant vous. Un de ces textes, Main basse sur le Cameroun, Autopsie d’une décolonisation, a été censuré en France de 1972 à 1976. Je voudrais aussi dire qu’au-delà de ces intellectuels qui nous aident quotidiennement à structurer davantage notre pensée, je fais partie du groupe du citoyen ordinaire. Celui qui se pose des questions, qui refuse le prêt-à-penser, la voix hégémonique et parfois bête des médias. Pour moi, l’art doit raconter la vie des gens. L’artiste est le témoin de sa génération, de son époque.
Quelle filiation artistique revendiquez-vous en la matière ?
S. B. – Jeune, j’étais curieuse de tout, avide de rencontres à cause de la solitude de mon enfance ardéchoise. Je n’ai pas fait d’école d’art, mais l’université à Strasbourg. Je me sentais libre car sans père artistique. Je suis arrivée à l’art contemporain par l’art médiéval et la critique contemporaine des images. Le premier m’a laissé une attirance particulière pour la « présentation » des corps et la puissance de leurs présences, et le second m’a poussée vers une éthique de l’esthétique.
J’ai surtout eu la chance d’être engagée très jeune par Jean-Pierre Vincent, au Théâtre National de Strasbourg, où de magnifiques créateurs venaient en résidence. Le TNS a été mon Black Mountain College. Puis le Squat Theater (groupe underground de comédiens hongrois émigrés aux USA) m’a inspiré mes « spectacles pour rendre la vie présentable ». Ensuite, il y a eu ma belle rencontre avec Dan Graham et sa façon de mettre de l’autre dans chacune de ses œuvres. J’ai aussi des souvenirs forts d’œuvres qui ont été comme des lumières éclairantes. L’art est un lieu où on peut encore accueillir l’autre. Il n’en reste pas beaucoup ! C’est aussi un lieu où il reste de l’amour, même s’il peut être violent.
M. L. – Je n’en vois pas trop si ce n’est peut-être Ahmadou Kourouma, Mongo Beti… Mais je dois dire que je ne veux pas confiner mes écrits aux désastres de la grande Histoire. Non. Comme je l’affirmais plus haut, l’artiste doit être témoin de son époque. Aussi, je voudrais écrire des romans sur la vie quotidienne en Suisse ou au Cameroun. Vous savez, la vie quotidienne est politique. Très politique même. Tout ce que nous faisons est politique, du matin au soir. Il n’est donc pas imaginable que mon propos cesse d’être politique. Si je dis : « Je suis né à Douala », ou alors « Je suis Genevois », ou « Je suis fumeur », ce sont toutes des affirmations politiques. Et je voudrais retourner à ces choses simples… c’est peut-être ainsi qu’on comprendra mieux la grande Histoire, car tout est lié, évidemment.
En quoi l’art peut-il enrichir et élargir le rôle des historiens ? Par quels types de médiums l’art peut-il toucher les publics en alertant leurs consciences ?
S. B. – Par exemple, le roman policier de Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire, à travers un médium populaire, est une enquête sur Papon sous l’Occupation et son rôle dans le massacre des 200 algériens en 1961 à Paris. Son livre a été lu par des milliers de personnes. Le film Shoah de Lanzmann a soulevé la chape de plomb du silence sur l’extermination et a ouvert la porte aux témoignages des survivants. Je me souviens du fou rire du coiffeur démuni devant son manque de mots pour décrire l’horreur de sa vie dans le camp de concentration et qui a fait que tout à coup, nous le public, on était lui.
On pourrait citer tous ces films, interdits, sur la guerre d’Algérie. Guernica n’a pas arrêté la dictature de Franco mais le tableau a contribué à le disqualifier à jamais dans l’histoire du monde. Les artistes et les historiens participent au dévoilement de façon différente et parfois ils travaillent ensemble ou les uns à la suite des autres. Ici, ce qui nous a fait nous rencontrer, Max Lobé et moi, c’est le livre La guerre du Cameroun. C’est finalement grâce à ces trois historiens — que nous avons lu au même moment a des km de distance, sans nous connaître — que nous nous sommes sentis tous les deux l’obligation « de faire ». Lui a écrit un livre et moi j’ai fait une œuvre éphémère.
M. L. – Je crois qu’il existe une différence entre l’écrivain, l’historien et le journaliste par exemple. Imaginons qu’il y a une dizaine de morts dans une manifestation à Bamenda, ville d’expression anglaise du Cameroun. Le journaliste, en 2 minutes, nous fait le bilan en présentant un peu le contexte du bras de fer entre le gouvernement et les sécessionnistes de la région. C’est l’information. L’historien nous décrira plus tard la constellation des acteurs en jeu et leurs différents intérêts. Pour les morts, l’historien nous en citera comme s’il s’agissait de cailloux. D’ailleurs je m’étonne toujours de lire dans les livres d’histoire le nombre de morts balancés comme ça… Ils disent : « il y a eu un million de morts ». Ils le disent comme ça, comme si c’était évident, puis le paragraphe suivant, ils passent à autre chose.
Eh bien, le romancier demande de faire une pause. Stop ! Le romancier se demande : alors dans la manifestation de Bamenda, qui est ce jeune-là qui est décédé ? Pourquoi a-t-il fait la manif ? Pourquoi n’a-t-il pas abandonné l’affaire lorsque les militaires se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants ? Mon rôle de romancier est de rentrer dans sa vie, de comprendre la petite histoire. Car c’est là, dans la petite histoire qu’on trouve l’explication à la grande histoire. Il y a des choses, dans notre vie familiale, dans notre enfance, dans notre parcours de vie, qui explique nos décisions. Celles qui « influenceront » la grande Histoire. C’est sans doute à ce niveau que réside la différence entre le travail de l’artiste et de l’histoire. Mais ces travaux se complètent. J’étais bien content lorsque Thomas Deltombe m’a dit que j’avais su, dans Confidences, expliquer des sentiments et des petits riens de la vie quotidienne que lui historien n’avait pas su dire dans ses essais.
S. B. – Oui, tu as raison de préciser, mais tous les historiens ne sont pas des corps froids. Ils essaient de décoller le réel des mensonges, des fantasmes, des contre-vérités, etc. Bien sûr, il y a aussi des historiens qui enseignent que la Shoah n’a jamais existé, ou qui disent que Nyobe était un dangereux terroriste ! A nous les artistes de donner la parole sous d’autres formes, de questionner les récits qui font la vie du monde, de donner place aux trésors de rien, « aux riens friables ».
Le monde de l’art vous semble-t-il, dans ses grandes largeurs, concerné par ces questions de mémoire occultée ?
S. B. – Il y a des artistes préoccupés par les mémoires occultées, soit par ce qu’elles relèvent de leur vécu, soit parce qu’elles relèvent de leur engagement politique, soit qu’elles relèvent d’événements qui leur ont fait entrevoir l’effroi. L’intérêt actuel pour les archives montre le besoin de produire d’autres versions de l’histoire du monde. Felwin Saar dit que les archives appartiennent à tous, au-delà de nos États Nations, car elles permettent de repenser le monde différemment.
Tous ces dispositifs nous aident à faire de l’histoire que l’on n’a pas forcément vécue, la nôtre. Concernant Nuremberg, en 1987, la direction du festival d’Avignon ne comprenait pas que nous voulions parler d’extermination : c’était un problème juif. Au même moment, l’épouse d’un ministre du gouvernement m’avait interpellée en m’expliquant que puisque je n’étais pas juive, je ne pouvais pas comprendre la douleur des juifs. Le jour où les exactions, les massacres, les exterminations seront la peine de nous tous, nous sortirons de l’obscurantisme. Les massacres au Cameroun appartiennent aux archives du monde. Comme d’autres massacres. Je suis pour une défense internationale des victimes.
M. L. – Je suis entièrement d’accord avec Sylvie. L’histoire des uns est dans une certaine mesure l’histoire des autres. C’est un tout. Il faut un peu plus de curiosité. En revanche, il ne faut pas tomber dans le piège de la hiérarchisation des douleurs. On ne devrait pas considérer, avec nos lentilles euro-centrées, les souffrances d’autres peuples, comme moins importantes. On devrait revoir la maxime « loin des yeux, loin du cœur ». On ne doit pas attendre le pire pour se réveiller. Et là, l’artiste devient important.
Plus globalement, comment appréciez-vous la manière dont la société française affronte aujourd’hui ces questions ? Sur quels obstacles bute, selon vous, la reconnaissance de sa politique coloniale sanglante ?
M. L. – Je l’ai déjà évoqué plus haut. Je ne pense pas que la société française veuille forcément affronter ces questions. Pardonnez-moi l’expression : mais les Français ont d’autres chats à fouetter. On parle beaucoup aujourd’hui de croissance. Croissance ! Croissance ! Croissance ! On parle aussi de progrès. Oui, c’est bien beau. Mais il faut bien que quelqu’un en paye le prix.
On nous parle de voitures électriques, d’un futur high tech, etc. Regardez autour de vous, l’électricité partout. On ne voit même plus le noir de la nuit. Eh bien, pour avoir tout cela, il faut que quelques villages soient rasés quelque part pour y puiser de l’uranium. Quelles ressources renouvelables nous permettront donc de subvenir à tous nos besoins énergétiques sans allumer une petite centrale ? Si même nous ne le faisions pas, d’autres pays émergents le feraient, à cœur joie. Je martèle, c’est une question d’intérêts à défendre.
J’ai pris là l’exemple de l’uranium, mais je pourrais parler de coltan ou de l’or sans quoi nous ne pourrions pas avoir nos ordinateurs super puissants, nos téléphones et j’en passe. Le bonheur des uns semble décidément se faire sur le malheur des autres. C’est étrange comme constat. C’est peut-être défaitiste. Mais c’est « la » triste réalité. Ni la France, ni aucun pays occidental ne ratera son « progrès » parce qu’il pense à des peuples autochtones quelque part dans une forêt africaine…
En France, tout un attirail a été utilisé pour fabriquer du silence autour du processus colonial : une presse sous influence, une lenteur à accéder à certaines archives, une volonté d’oubli judiciaire, une condescendance intellectuelle, une minoration culturelle, du racisme banalisé etc. Il faudrait un geste symbolique très fort pour renverser ce silence. J’aimerais qu’un de nos présidents aient la vision et le courage de faire un tel geste.
Qu’est-ce que le discours d’Emmanuel Macron sur les rapports de la France avec l’Afrique, privilégiant les projets économiques à l’examen de conscience sur son passé, suscite-il chez vous ? Le signe d’un aveuglement, l’indice d’une culpabilité étouffée, la volonté d’inventer un nouveau type de partenariat ?
S. B. – Quand j’étais à Douala, le Président de la République, Emmanuel Macron, disait des choses qui heurtaient les Camerounais et j’imagine beaucoup d’Africains. Le coup des femmes avec huit enfants a été violent. Une camerounaise m’a dit avec un humour noir ce jour-là : « Vu comme vous nous avez massacrés, on a encore de la marge ! ». Emmanuel Macron a ignoré le Cameroun pendant son voyage en Afrique et cela a ravivé les plaies.
Sur place, je voyais combien il plaisait à la jeunesse de Douala qui avait envie de l’aimer, mais qui ne le pouvait pas. « Yes you can », dit un jeune Camerounais devant ma caméra à Douala. Il disait « Vous êtes jeune comme nous, M. Macron, vous pouvez y arriver. Yes you can ? Présentez des excuses », avec un immense sourire. La jeunesse d’Emmanuel Macron leur a fait croire qu’il allait les traiter d’égal à égal. Mais parler de partenariat économique ne cicatrise pas les plaies par miracle. Il n’y a que les personnes qui n’ont jamais été meurtries qui peuvent croire ça. Une aide économique ne remplacera jamais des excuses. Cela me fait penser aux parents qui punissent injustement leur enfant, puis se sentant coupables, le couvrent de cadeaux au lieu de lui dire qu’ils ont mal agi.
Le député et mathématicien Cédric Villani a dit l’autre jour à la radio que « si on ne peut pas regarder son passé en face, on ne peut pas avancer ». Il doit plaider cela auprès du président. A Douala, tout le monde dit « les Camerounais sont malades ». Oui, le Cameroun a été rendu fou de mauvais traitements. Moi-même l’art ne m’a pas suffi à me sauver de la violence paternelle. J’ai dû travailler à me déconstruire pour me reconstruire. Au Cameroun, des Français et des Africains qui étaient à leurs bottes ont testé de nouveaux procédés d’exterminations, de tortures, de soumissions. C’est là qu’a été inventé la Françafrique qui a gangréné le pays, puis le reste de l’Afrique. Je n’aimerais pas finir ma vie sans que les Camerounais suivent enfin les funérailles de Ruben Um Nyobé. Sa mère attend elle aussi depuis 1958.
Ce que je veux dire c’est que « Bien que je n’en aie pas le droit, je demande à M. le Président de la République française, M. Emmanuel Macron », par l’intermédiaire de votre journal, moi artiste sans aucun droit d’état, « de présenter des excuses au peuple Camerounais ». Ce serait le signe d’une possible « reconstruction » de ce pays, mais aussi du nôtre. Une autre façon, à mon avis, de lutter contre la montée de l’extrême droite.
M. L. – Tout ce que je peux dire c’est wait and see. Mais Macron est président de la France, pas du Cameroun et encore moins de l’Afrique. Il pense d’abord à son pays. Souvenez-vous de l’élection d’Obama en 2008 et des espoirs qu’elle a fait naître chez les Africains. Non, Macron n’est pas là pour sauver le monde ou l’Afrique. Il a été élu par les Français pour s’occuper de la France. À chacun son métier et surtout son territoire.
Lorsqu’on voit le temps qu’il a fallu à la société française pour affronter son passé collaborationniste — les débats sur Vichy —, mais aussi la réalité de la guerre d’Algérie dans les années 1950-60, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour reconnaitre par exemple les crimes de la France au Cameroun ?
S. B. – Je ne sais pas. Mais j’avance en âge. Je n’aimerais pas mourir avant.
M. L. – Ah beaucoup de temps ! Je crois être simplement lucide. Je crois. Il faudra beaucoup de temps. Que ce soit la gauche, la droite, les extrêmes ou même les ni-gauche-ni-droite-ni-extrême, cela prendra beaucoup de temps. La France et ses ex colonies entretiennent des rapports amicaux aujourd’hui, bien verticaux. Quand on a fait du mal à un ami, on lui présente ses excuses. Non ?
Propos recueillis par Jean-Marie Durand