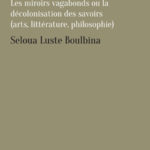Seloua Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie), Les presses du réel, 2018.
Seloua Luste Boulbina est philosophe, ex-directrice de programme « La décolonisation des savoirs » au Collège International de Philosophie (2010-2016), actuellement chercheuse (HDR) à l’Université Paris Diderot. Elle a été professeure à l’université de Pékin et de Brasilia. Théoricienne de la décolonialisation, elle travaille sur le colonial et le postcolonial dans leurs dimensions politiques, intellectuelles et artistiques. Elle a collaboré avec des artistes et conçu les Transphilosophies (Alger, New York, Dakar). Elle a publié de nombreux ouvrages dont Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie (2008), Les Arabes peuvent-ils parler ? (2011) ou L’Afrique et ses fantômes (2015).

Présentation de l’éditeur : Source
Penser la décolonisation des savoirs et des pratiques intellectuelles, littéraires et artistiques demande à réfléchir sur les lieux et les formes de cette grande transformation. Pour la dire, il faut réfléchir in concreto : elle a déjà commencé. Elle n’est ni devant nous, telle un programme à initier, ni derrière nous, telle un processus achevé. Elle est à l’œuvre mais plus ou moins, de façon différenciée, dans le travail d’écrivains et d’artistes qui irriguent ici la réflexion philosophique. La décolonisation prend ainsi sens dans ses grandes lignes comme son détail.
Autrefois, la métropole et la colonie apparaissaient comme deux espaces tout aussi distincts en principe qu’entremêlés en réalité. Les indépendances africaines ont profondément modifié ce paysage, créant des entre-mondes de la philosophie, de la littérature, des arts. Le sud peut déloger le nord. L’étrange(r) voisiner avec le familier, le vivant cohabiter avec le fantôme. Les affranchissements, les franchissements sont multiples, divers. Comment les lignes se déplacent-elles et dans quels mouvements ? Les arts visuels, la musique, la littérature montrent des chemins.
Ce livre est un parcours plus qu’un itinéraire, une critique plus qu’une doctrine : une migration. Il est une philosophie de la décolonisation qui entend montrer comment, dans les savoirs, le passé peut être dépassé.
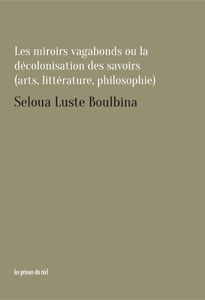
Introduction
[/« Telle, dis-je, Vénus sortit du sein de l’onde, Et promit à ses yeux la conquête du monde, Quand elle eut consulté sur leur éclat nouveau, Les miroirs vagabonds de son flottant berceau. »
Corneille, Andromède1./]
[/« Il me fallait une littérature qui donne aux mots
une autre forme, un autre agencement, une littérature
dont les mots sont des objets par exemple, ou des sons,
des surfaces et des volumes, il me fallait cette littérature-là
avec des mots qu’on peut rencontrer dans la rue, des mots qui n’ont pas attendu que l’on ouvre le livre qui les contient. »
Sinzo Aanza, Pertinences citoyennes/]
Je n’ai jamais séparé la philosophie de la littérature et des arts. La porosité est grande, non seulement dans ma tête, mais aussi dans la réalité. La théorie, notamment philosophique, peut contenir du poétique comme intuition, association, style. À l’inverse, la poésie, au sens large, peut contenir du théorique comme trace, empreinte ou spectre. En outre, tout travail de décolonisation des savoirs inclut nécessairement les arts et la littérature. Les questionnements d’une époque traversent en effet les frontières établies entre les savoirs, entre philosophie et poésie. C’est avec la littérature et les arts — surtout les arts visuels et la musique — que ma pensée s’élabore, trouvant dans tels thèmes récurrents ou dans telles associations originales matière à penser et manières de penser. L’arrivée, depuis un certain nombre d’années, d’artistes, de galeristes, de commissaires d’exposition et de collectionneurs du continent africain sur le marché globalisé de l’art contemporain, et, surtout, dans l’art contemporain, a modifié le paysage colonial d’antan de façon à la fois profonde et irréversible. Le saut s’était déjà produit, précédemment, avec la littérature. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis les indépendances de l’après-Bandung. Des métissages nombreux et serrés ont déplacé les frontières, les migrations postcoloniales se sont développées et ont transformé tant les pays d’arrivée que les pays de départ, sans même parler des changements des individus eux-mêmes. Les face-à-face d’autrefois ont laissé place à l’intervention de tiers parfois inattendus.
Les talents ont pu se déployer sans être contraints par d’absurdes dispositions empêchant certains de faire ce que d’autres avaient plaisir à accomplir : lire et écrire, peindre et dessiner, photographier, et jouir du monde. Un tableau du monde s’est effacé derrière un nouveau tableau sur lequel cependant les traces ou les marques de l’ancien n’ont pas entièrement disparu. Les indépendances ne signifient pas fin des inégalités. Quoi qu’on puisse en dire, le passé ne s’efface pas d’un coup de gomme. Les disséminations multiples et successives ont éloigné les « origines » mais les concentrations de capitaux, tant réels que symboliques, n’ont pas disparu pour autant, produisant des effets d’autant plus importants qu’ils sont discrets et à long terme. Sur le continent africain, la ligne qui distingue le monde francophone et le monde anglophone est toujours visible, ne serait-ce que parce que, mondialement, l’anglophone est « majoritaire » quand le francophone est « minoritaire ». Bonne nouvelle : l’art contemporain, dans les sud, a, positivement, perdu la tête: il a rompu avec le logocentrisme, la religion de l’un, le culte de la clôture. L’image de la mangrove me vient à l’esprit: son allure est rhizomatique. Elle s’étend en arborescences. Elle se développe dans la zone de balancement des marées, l’estran. Elle croît maritimement mais sur le littoral. Elle est composée de végétaux abreuvés par le sel de la mer. La flore s’y enracine dans un sol peu stable et pauvre en oxygène. Les entre-mondes gagnent en étendue, et donc, par voie de conséquence, les univers créolisés et métissés. Philosophiquement, l’hétérogénéité est féconde. Le nouveau ne peut surgir de l’endogamie, du croisement ou du couplage du même avec le même, c’est-à-dire de l’homophilie, mais de l’exogamie et de l’hétérophilie.
Pourtant, ces artistes, ces écrivains sont parfois réunis, en France, sous des bannières discutables qui ont plus à voir avec ce qu’ils sont censés représenter qu’avec ce qu’ils sont. En nommant un pays, je nomme un lieu, celui où je vis et où je travaille. Cette localisation n’est pas neutre car il ne revient pas au même de vivre à Berlin ou à Londres, à Abidjan ou à Alger, au Caire, à Johannesburg ou à New York, à Dakar ou à Lagos. Les conditions de travail et les conditions de vie — faut-il le préciser ? — déterminent la manière dont nous avançons. L’initial se prolonge indéfiniment dans ses effets et, proprement, initialise. Ainsi, les romans et récits de Mouloud Feraoun, de Mouloud Mammeri, de Mohamed Dib puis de Kateb Yacine et d’autres que je lisais durant mon enfance, à Alger, ont été pour moi comme des antidotes à Albert Camus et à tant d’autres: ils m’ont servi à faire la part des uns et des autres, des mots et des choses, des grandes idées et des réalités concrètes. Important (salutaire) quand on se destine ensuite à la philosophie… Paradoxe également pour un pays qui n’adhère pas à l’organisation de la francophonie mais donne à la littérature d’expression française certains de ses plus grands auteurs. Pensons à Assia Djebar. Qui, aujourd’hui, parlerait, comme autrefois, de «littérature d’instituteurs» pour dévaluer les écrits français d’au- teurs extra-européens? Les peintures de Farès, de Issiakhem, de Martinez et de bien d’autres m’ont appris combien la « modernité » avait de poids aux lendemains des indépendances. Car l’indépendance nationale devait s’accommoder — tant bien que mal — de l’indépendance de ses artistes.
Ces écrivains, ces artistes sont, partout, le terreau, rhizomatique, des arborescences d’aujourd’hui avec ses vidéos, ses installations, ses performances. Les écrivains, artistes et penseurs d’aujourd’hui sont des héritiers. Un réseau de fils invisibles les relie à des interrogations, des actions, par générations successives. Une transmission horizontale vient s’ajouter à la transmission verticale de la succession des générations. Du commun émerge qui fait, par exemple, du maritime, un espace partagé. Des volontés s’unissent pour inverser la tendance qui consistait à exposer l’art africain à l’étranger sans toujours l’exposer sur son propre continent. Des fondations se créent pour soutenir ce qui ne pourrait, sans risque colonial majeur, n’être soutenu que par des Européens. Des maisons d’éditions naissent pour diffuser, sur place, ce qui s’y écrit. Inégalement selon les pays et les régions. L’internationalité n’est pas seulement externe au continent africain. Elle est aussi interne. Certains auteurs publient dans d’autres pays d’Afrique que leur pays d’origine. La Camerounaise Leonora Miano, le Togolais Sami Tchak, le Guinéen Tierno Monénembo, l’Ivoirienne Tanella Boni, le Congolais Patrice Nganang, le Malien Yambo Ouologuem — ou le Haïtien Louis-Philippe Dalembert — ont ceci en commun d’avoir été publiés aux éditions algériennes Apic. Certains ne publient qu’en dehors du pays où ils vivent (et lisent) tel l’Algérien Boualem Sansal.
Cela étant, le soupçon d’une corruption est toujours sousjacent à propos tant des penseurs que des artistes et des écrivains des — anciennes — subalternités.
La migration des mots
C’était déjà le cas pour Richard Wright. Émigré en France à partir de 1946, familier de Sartre et Camus, Mannoni et Bataille, l’écrivain a été perçu comme ayant été contaminé par eux. Son authenticité a été considérée comme corrompue. Paul Gilroy l’a bien compris :
Pour nombre de critiques africains-américains, il semble que le visage le plus séduisant de Wright soit celui que James Baldwin a immédiatement reconnu: celui du “Négrillon du Mississipi”. La question de savoir pourquoi cet aspect de Wright devrait être le plus séduisant mérite d’être posée. Aurait-il dû, comme le suggèrent à la fois ceux qui exaltent l’écrivain contestataire et ceux qui le conspuent, se satisfaire de rester confiné dans le ghetto intellectuel où la littérature nègre est si souvent consignée2 ? »
Parmi la multiplicité des facettes de l’écrivain, une seule semble digne d’attention et de respect. Celle qui semble la plus «fondamentale». Dans une perspective transculturelle et trans- nationale, ce n’est pas un hasard que la mobilité remplace l’immobilité associée à l’enracinement. Keep on Moving, (Reste en mouvement), le titre des Funki Dreds londoniens, apparaît ainsi moins comme un mot d’ordre que comme une nécessité. Car, dans l’entre-mondes et dans l’espace flottant, on ne doit la vie qu’en bougeant. Le sur-place est impossible. L’écart, façon d’ouvrir l’espace, invente l’entre. L’entre est discret mais concret : il existe en creux. C’est un lieu de passage, un milieu de communication. L’entre est une atopie. Le plaisir de vivre y cède la place à des tourments tels que le doute, l’impression d’être à contre-voie, de se tenir du mauvais côté, « en un lieu, dit Said, qui semblait m’échapper alors même que j’essayais de le définir ou de le décrire3 ». La déprise, le sentiment de l’insaisissable, l’impression de ne pas maî- triser ses mouvements ou son parcours apparaissent comme les impressions les plus immédiates de l’absence de lieu propre.
Le « que suis-je ? » occulte bien souvent le « où suis-je ? ». Pourtant, on saisit mieux une activité à partir de l’espace, plus ou moins élargi, plus ou moins globalisé, dans lequel l’interrogation s’élève qu’à partir d’une identité à la fois supposée et postulée que l’activité viendrait confirmer ou, comme avec Wright, éventuellement infirmer. Le temps de la maison est passé et les « retours » imaginaires (au Cameroun, au Congo, aux sources) de descendants d’émigrés restaurent, autrement, les « Négrillons du Mississipi ». Comme si ceux-ci étaient, per se, un parti auquel il fallait adhérer. C’est un risque. Si les entre-mondes m’intéressent autant, c’est parce qu’ils sont la caractéristique d’un univers postcolonial dans lequel les mondes sont en voie d’égalisation. Parce qu’ils sont la marque de l’aventure et de l’incertitude. Les entre-mondes sont un milieu particulier : le flottant l’emporte sur le fixe, le mouvant sur l’immobile, le liquide sur le solide et le maritime sur le terrestre. Pour le dire vite, être entre deux mondes revient à nager entre deux eaux. L’expression, apparue au XIVe siècle, vient de la marine. À cette époque, « nager » voulait dire « conduire un bateau ». Et l’équipage qui savait « nager entre deux eaux », était celui qui arrivait à garder le cap malgré les courants (les « eaux », à l’époque) qui pouvaient l’entraîner dans une mauvaise direction. L’entre-monde désigne donc non seulement un milieu mais aussi un itinéraire, la capacité à avancer dans un environnement aux courants divers et quelquefois opposées.
« In between » a un rapport avec « out of place » : déplacé ou hors de propos. Or le plus intéressant peut-être dans ce que nous faisons d’artistique, de littéraire et de philosophique, est de faire du déplacé le lieu même de l’art, de la littérature et de la philosophie ; de faire de ce qui est semble-t-il hors de propos l’objet même du travail. Autrement dit, alors que la norme sociale indique une porte de sortie, ou une façon d’éjecter ce qui est « déplacé » et « hors de propos », ces activités humaines, à l’inverse, montrent une voie d’entrée, une façon d’incorporer les subjectivités. À la condition, toutefois, d’intégrer le sujet de l’énonciation dans ses énoncés. Philosophiquement, cela revient à faire d’une pensée une critique, non une doctrine. Artistiquement et littérairement, les énoncés sont imitables, comme en témoigne le pastiche. L’énonciation, elle, demeure inimitable. La découverte ou l’invention du geste n’est pas reproductible. On peut bien contrefaire un enfant, non refaire sa conception. Il faut alors « bricoler ». Claude Lévi-Strauss a fait l’éloge du bricolage. En français, « bricoler s’applique au jeu de balle et de billard, à la chasse et à l’équitation, mais toujours pour évoquer un mouvement incident : celui de la balle qui rebondit, du chien qui divague, du cheval qui s’écarte de la ligne droite pour écarter un obstacle4. C’est ainsi que des ignorances se transforment en savoir : incidemment.
Pas de migration sans détournement ou, pour employer un terme normatif, de dévoiement. Les migrants ont une « science du concret ». Ils bricolent avec ce qu’ils sont, avec d’où ils viennent et où ils vont. La migration montre des trajets compliqués bien plus que des trajectoires linéaires. Par où passent les migrants, quels sont les espaces qu’ils traversent ? Les mouvements incidents font et le mythe, le bricolage et la science du concret. Migrer : divaguer, écarter l’obstacle, rebondir. La décolonisation procède par migration, bricolage, pensée sauvage et mouvement incident. Elle ne saurait être un programme sauf à se gorger de mot creux : décoloniser l’être, le savoir, le pouvoir. Beaucoup (notamment les « spécialistes ») disjoignent énonciation et énoncé, ce qu’ils sont (et où ils sont) et ce qu’ils disent. Un discours d’institution est ainsi un énoncé totalement disjoint de son énonciation. Un énoncé sans réflexivité. Du coup, que l’autodidacte ne soit pas imitable se comprend mieux : on peut reprendre en effet des énoncés, non des énonciations. L’écriture prend alors le pas sur le simple écrit et suspend toute allégeance.
Cette écriture, qu’elle soit artistique, littéraire, ou philosophique, procède, comme les langues, par emprunts c’est-à-dire par migration de mots d’une langue dans une autre langue, de l’intelligible vers le sensible, et du sensible vers l’intelligible. Distinguer ici emprunt et héritage est utile. Par exemple le mot table est issu du latin tabula : c’est une évolution de la langue, un héritage. Au contraire, certains mots, surtout des mots savants, ont été empruntés au latin et refaits sur le modèle morphologique français : nullité est ainsi un emprunt du latin médiéval nullitas. L’emprunt marque nos langages comme nos écrits. À qui sont-ils destinés ? « Qui écrit ? Pour qui écrit-on ? Dans quelles circonstances5 ? » Ces questions que Said soulève dans « Opposants, auditoires, circonscriptions et communautés » trouvent en moi un profond écho. En effet, on n’écrit pas nécessairement pour ceux qui nous lisent, bien au contraire. L’écriture est habitée de fantasmes et de fantômes. On peut imaginer s’adresser à des gens qui ne savent pas lire. On aimerait que le texte qu’on écrit puisse leur parvenir. On peut vouloir écrire pour des personnes éloignées, qui parlent d’autres langues et habitent d’autres pays. Le lecteur imaginaire remplace, dans l’écriture, l’auditeur réel qu’on peut avoir en face de soi et qui nous pose des questions.
- Dans la mythologie grecque, Andromède est une princesse éthiopienne. Enchaînée nue à un rocher près du rivage, sacrifiée à un monstre marin, elle est aperçue par Persée qui la sauve et l’épouse.
- Paul Gilroy, L’Atlantique noir (1993), Amsterdam, 2010, p. 245.
- Edward Said, « Dans l’entre-mondes », Réflexions sur l’exil (2000), Actes Sud, p. 691.
- Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Plon, 1962, p. 26 ».
- Edward Said, «Opposants, auditoires, circonscriptions et communautés», Réflexions sur l’exil, Actes Sud, p. 175 sq.