Arlette Heymann-Doat, professeure émérite de droit public à l’Université de Paris-Sud et juriste engagée dans la défense des droits de l’homme est décédée le 25 novembre 2024, à l’âge de 81 ans. Elle a été l’autrice d’une thèse sur « Les Libertés publiques et la guerre d’Algérie », commencée en 1966 et soutenue en 1972, publiée peu après à Paris par la Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ). Sur le même sujet, elle a publié ensuite un ouvrage destiné notamment aux étudiants, Guerre d’Algérie, droit et non-droit, aux éditions Dalloz, plusieurs fois réédité.
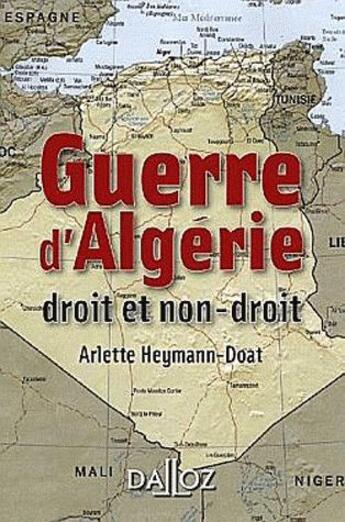
Elle s’est engagée aussi dans cette période au sein de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et en a été élue vice-présidente sous la présidence d’Henri Leclerc (1995-2001). Spécialiste de la question des libertés publiques, autrice, avec Gwenaël Calvez, en 2008, de Libertés publiques et droits de l’homme (LDGJ) plusieurs fois réédité, elle a publié en 2016, lorsque, dans le contexte des attentats terroristes du XXIème siècle, des théories sécuritaires se sont propagées au risque de mettre à mal ces libertés, un article critique important : « L’état d’urgence, un régime juridique d’exception pour lutter contre le terrorisme ? » dans la revue Archives de politique criminelle 2016/1 n° 38, p. 59 à 74.
Lors de la fermeture des archives de la guerre d’Algérie qui a suivi les promesses d’Emmanuel Macron après sa visite en septembre 2018 à Josette Audin, Arlette Heymann-Doat a joué un rôle essentiel dans la réaction des historiens, des juristes et des archivistes contre cette fermeture qui a voulu utiliser une instruction interministérielle, l’IGI 1300, pour entraver considérablement leur consultation (1). Son intervention lors d’une journée d’études à l’Assemblée nationale, le 20 septembre 2019, a été décisive dans le déclenchement de cette mobilisation.
Pendant près de deux ans au sein d’un Collectif intitulé « Accès aux archives publiques », elle a participé à la réaction citoyenne qui a obtenu du Conseil d’Etat, le 2 juillet 2021, l’annulation de cette procédure administrative illégale, même si de nouveaux obstacles à la libre consultation des archives ont été aussitôt insérés par le gouvernement au sein d’une loi relative à la prévention d’actes de terrorisme (2).
Catherine Teitgen-Colly, qui lui était proche et avec qui elle a souvent travaillé, revient ci-dessous pour notre site sur son travail pionnier.
Gilles Manceron.
(1) Arlette Heymann-Doat, contribution à la journée d’études du 20 septembre 2019, in Catherine Teitgen-Colly, Gilles Manceron et Pierre Mansat, Les disparus de la guerre d’Algérie, suivi de La bataille des archives 2018-2021, L’Harmattan, 2021, p. 83-87.
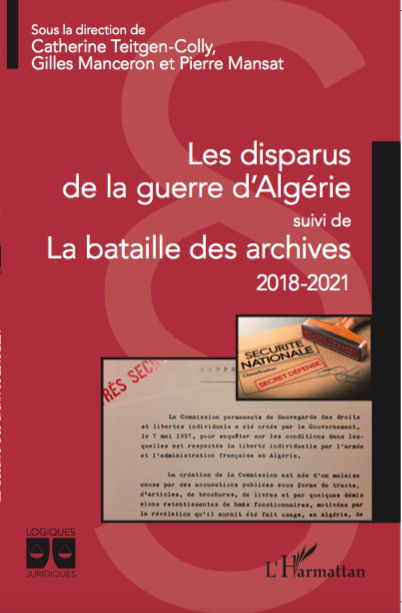
(2) Ouvrage cité, p. 224-240.
A mon amie Arlette Heymann-Doat
par Catherine Teitgen-Colly.
D’abord assistante puis maitre de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Arlette Heymann-Doat a été nommée en 1990 professeure à la Faculté de droit de Sceaux – Université Paris Sud (devenue depuis Université Paris-Saclay)qu’elle a quittée comme professeure émérite de droit public.
Soucieuse de faire la place que mérite le droit public dans la formation d’un étudiant en droit, elle a contribué à la création du DEA de droit public, dans lequel elle a notamment assuré le cours de Droits et libertés, prélude à son manuel « Régime juridique des droits et libertés » et aux « 50 libertés et droits fondamentaux » dans la dont le mini-format Dalloz permet, comme l’a relevé Christian Vigouroux, conseiller d’Etat, d’avoir toujours dans sa poche cette arme contre l’arbitraire.
Bouquet d’idées et de fermes convictions, Arlette Heymann-Doat a marqué par son dynamisme, son intelligence, sa curiosité et sa gaité, ses collègues et ses étudiants et étudiantes en contribuant notamment au développement de la recherche en droit public par la co-fondation de l’Institut d’études de droit public (IEDP) et du Centre de recherches internationales sur les droits de l’homme – le CRIDHOM –, un nom qui constituait tout un programme et une source certaine de fierté… Dans ce cadre, la recherche collective en droit public a pu se développer, des thèses ont été soutenues, des colloques ont été organisés, des débats partagés.
Arlette Heymann-Doat a été notamment à l’origine de la première collaboration interdisciplinaire au sein de l’Université Paris Sud par la conception d’un important colloque « Génétique et droits de l’homme », organisé conjointement par les facultés de droit de Sceaux, de médecine de Kremlin-Bicêtre et des sciences d’Orsay, qui donna lieu à une publication remarquée aux éditions L’Harmattan en 2000. Elle a, dans cette même perspective, co-fondé et co-dirigé le diplôme d’université Ethique médicale et droits de l‘homme associant juristes et scientifiques.
Mais le parcours universitaire d’Arlette Heymann-Doat est aussi celui d’une juriste courageuse qui s’est risquée à entreprendre une thèse de doctorat sur « les libertés publiques dans la guerre d’Algérie » pour dire l’indicible, alors que celle-ci venait de s’achever et qu’il faudra attendre 30 ans pour qu’enfin le mot de « guerre » et non plus d’« événements » soit officiellement retenu. A l’instar de Roger Errera, conseiller d’Etat, dénonçant en « les libertés à l’abandon » dans son ouvrage qui demeure une référence, Arlette Heymann-Doat n’a eu de cesse de rappeler la gravité des atteintes portées aux droits et libertés dans ces périodes d’urgence, de pleins pouvoirs, en bref de crise où la raison d’Etat l’emporte sur l’Etat de droit. Elle a par ailleurs rassemblé de façon tout à fait précieuse les textes clefs en la matière dans « Guerre d’Algérie – Droit et non droit », publié chez Dalloz en 2012.
L’on ne s’étonnera donc pas de la part active qu’elle a prise dans le comité d’organisation de la Journée d’études du 20 septembre 2019 dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale sur « les disparus de la guerre d’Algérie du fait des forces de l’ordre françaises » dont les actes ont été publiés chez l’Harmattan, ni de l’idée qu’elle lançait, lors des débats, d’une bataille juridique à mener pour l’ouverture des fonds d’archives de l’Etat concernant tous les disparus de la guerre d’Algérie.
Elle a participé à cette bataille pour l’ouverture de ces archives qu’entravait une instruction interministérielle (l’IGI 1300) relative à la protection du secret défense dont le Conseil d’Etat relèvera la complète illégalité, soit une bataille gagnée mais en partie seulement ainsi que la retrace la seconde partie des « disparus de la guerre d’Algérie » précité. L’on ne s’étonnera pas davantage de sa signature de l’appel du 4 mars 2024 pour la reconnaissance par l’Etat du « système » de torture institué pendant la guerre d’Algérie.
C’est assez dire la chance de ceux qui ont eu l’occasion de la côtoyer, en particulier dans ces temps universitaires qui furent à la fois féconds et heureux.

