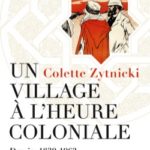Trois essais d’histoire coloniale :
les colonisés dans le non-dit des archives
par André Loez
La colonisation européenne des XIXe et XXe siècles a généré des archives surabondantes : lois et règlements, directives et rapports, recensements et statistiques, plans cadastraux et relevés fiscaux. Un imposant édifice de papier, illustration en son temps de l’apparente solidité du projet colonial, laissant mal présager la rapidité de son effacement dans la quinzaine d’années suivant la seconde guerre mondiale.
Le regard porté sur ces sources est aujourd’hui renouvelé, comme l’atteste la journée d’études prévue en juin aux Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence) : « (Dé)construire les archives coloniales ». Un titre qui indique la volonté actuelle de dépasser une lecture immédiate, politique ou juridique, de ces documents, pour en sonder les conditions de production, les non-dits, les ambiguïtés. Trois livres récemment parus invitent pareillement à parcourir ces gisements documentaires pour renouveler notre compréhension de ceux qui administrèrent les empires, et approcher, autant que possible, des populations colonisées qui n’y figurent souvent qu’en filigrane.
Le fait structurel de la domination coloniale
Tel est l’enjeu d’Un village à l’heure coloniale, la belle étude que Colette Zytnicki consacre à un village ordinaire de l’Algérie française, Draria, près d’Alger, des années 1840 à 1962, au terme de la guerre d’indépendance. Le choix de ce terrain restreint ne s’explique pas seulement par de lointaines origines familiales : l’échelle locale permet d’y scruter avec précision, à l’aide de nombreux documents, les mécanismes par lesquels les populations autochtones furent dépossédées de leurs terres, mais aussi l’installation, au lendemain de la conquête, de colons allemands, suisses ou nivernais. Au fil du XIXe siècle, le livre décrit leur enracinement, les progrès de la viticulture, les premières élections municipales, la vie ordinaire en somme, qui figure au cœur de l’enquête : « La vie d’un village colonial se déroule dans un quotidien qui s’ancre dans toute une série d’exceptionnalités », écrit l’historienne.
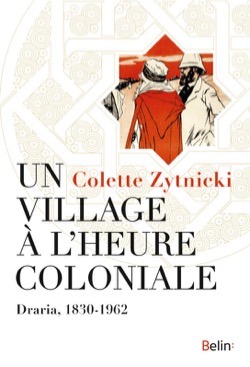
Car ce quotidien repose sur le fait structurel, normal et anormal à la fois, de la domination coloniale. Dès lors, il s’agit de comprendre comment vivent, inégaux et côte à côte, Européens et Algériens, dans une tension qu’on ne fait souvent que deviner : ici, un litige portant sur l’accès à un cimetière « indigène » en lisière du champ d’un colon ; là, une attaque nocturne de ferme ; à la fin de la période, la question de la scolarisation des enfants arabes, qui commence à se poser. Sans que jamais, ou presque, les colonisés figurent comme sujets dans les sources : aux questions de l’auteure sur leur expérience, les documents opposent un désespérant silence.
Les angoisses et les incertitudes des colonisateurs
A partir des archives de la colonisation néerlandaise en Indonésie, qu’elle étudie depuis trois décennies, Au cœur de l’archive coloniale, le livre de l’anthropologue et historienne américaine Ann Laura Stoler entend ne pas en rester à ces constats lacunaires, et relire ces sources « dans le sens du grain », comme on poncerait une pièce de bois pour en ressentir, au plus près, la forme, et non les aspérités. Along the Archival Grain, tel est le titre original de ce livre très remarqué à sa parution, en 2009. Véritable appel à comprendre la spécificité des archives coloniales, il manifeste une ambition théorique forte : rien de moins qu’inverser nos habitudes de lecture de ces documents, pour ne pas y trouver l’affirmation d’un pouvoir hégémonique et omniscient mais comprendre, à travers eux, les angoisses et les incertitudes des colonisateurs.
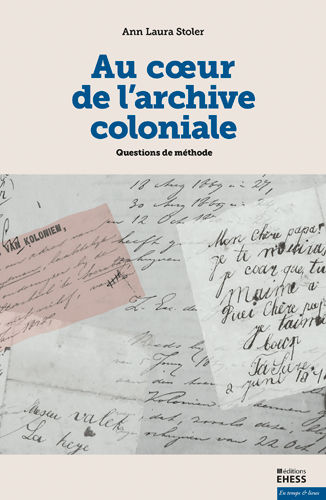
Aujourd’hui, les traces de la colonisation s’érodent à Draria, à Jakarta ou à Dakar. Restent des archives, matériau presque inépuisable.
Une approche notamment illustrée par une singulière étude de cas, celle de Frans Carl Valck, administrateur colonial dont les rapports, lors de troubles à Sumatra en 1876, ne cadraient pas avec le « sens commun colonial », et qui fut pour cela renvoyé. L’auteure entend approcher ses sources en ethnologue, laissant volontiers cours à un lyrisme non exempt d’afféteries : « Je cherche le pouls de l’archive dans le ralentissement et la cadence accélérée de sa propre production, dans le rythme constant et effréné des incantations répétées, des formules et des trames. »
La démarche est originale, mais également risquée. A trop insister sur les incertitudes, c’est le savoir produit par la chercheuse qui devient lui-même instable. L’usage immodéré des métaphores (« le sentiment est l’empreinte négative de la surface raisonnée de l’archive coloniale ») fait souvent perdre de vue les outils plus ordinaires et plus consistants des historiens, ceux de l’histoire sociale et de la contextualisation.
Romain Tiquet a su les employer dans Travail forcé et mobilisation de la main-d’œuvre au Sénégal, livre tiré de sa thèse de doctorat. Montrant l’omniprésence, dans le Sénégal des années 1920 à 1960, de la coercition des travailleurs par les autorités pour réaliser les infrastructures routières ou rentabiliser les plantations, le chercheur procède à d’éclairants jeux d’échelles afin de cerner, au plus près des pratiques, le rôle des administrateurs français, des chefs locaux, ainsi que la marge de liberté ou d’évitement des Africains assujettis.
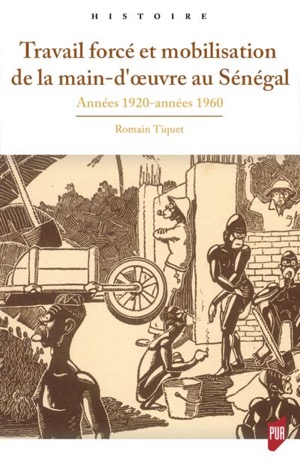
L’étude déploie, elle aussi, une grande finesse dans la lecture des sources, notamment quand il s’agit de décoder les dossiers de prisonniers s’étant donné des « blessures volontaires » pour échapper aux corvées. Le dernier chapitre révèle que, après la période coloniale, une même rhétorique visant à mobiliser la main-d’œuvre pour moderniser et développer le pays fut reprise, sous d’autres modalités concrètes, au Sénégal indépendant.
A Draria, aujourd’hui dans la banlieue d’Alger, rien ou presque ne subsiste du village viticole de l’Algérie française. Les traces de la colonisation s’érodent de même à Djakarta, l’ex-Batavia des Néerlandais, ou à Dakar. Restent des archives, matériau presque inépuisable pour renouveler cette histoire, à condition de savoir, comme les trois livres ici étudiés, prêter une attention sensible à leur « grain » particulier, bribes d’expériences celées au creux des documents.
Le travail forcé colonial, un crime contre l’humanité ?
Dans une tribune publiée le 10 avril par Le Monde, le politiste Olivier Le Cour Grandmaison et l’ancienne ministre malienne Aminata Traoré plaidaient pour que le travail forcé colonial soit reconnu comme un crime contre l’humanité. Le travail de Romain Tiquet n’adopte pas cette position dénonciatrice mais révèle les ressorts et le fonctionnement ordinaire d’un système dont bien des acteurs savaient qu’il contrevenait aux règles de droit, telles que le Bureau international du travail (Genève) a commencé à les édicter à la fin des années 1920. Jugé indispensable à la réalisation des routes et des chemins de fer devant « mettre en valeur » les colonies, commode substitut à l’impôt dans des économies peu monétarisées, il est alimenté en hommes par les chefs indigènes eux-mêmes, dans un « despotisme décentralisé ». Si une loi de 1946 l’abolit, l’historien montre aussi comment le recours à une main-d’œuvre carcérale permet de contourner une interdiction restée théorique.
André Loez, historien et collaborateur du Monde des livres.
« On a beaucoup écrit sur l’Algérie coloniale et l’on continue de le faire. On insiste aujourd’hui sur la construction des identités sociopolitiques parce qu’elles résonnent dans notre société. (…) Mais on s’est finalement fort peu intéressé à ce que nous appellerons le quotidien colonial. Par quotidien, on entend ici la trame de la vie, cette banalité qui fait le fil de nos jours. Comment la situation coloniale a-t-elle été vécue par les femmes et les hommes qui l’ont connue ? Et au cœur de l’interrogation gît la question la plus importante et qui me taraude le plus : comment, dans ce régime d’exception que fut la colonisation, les divers groupes ont-ils pu vivre non pas ensemble, mais du moins côte à côte, en situation de voisinage ? Dans la mémoire et dans l’histoire, on a privilégié les temps de crise, d’affrontements violents. Mais que se passait-il quand, justement, il ne se passait “rien”, peu de choses ou rien de marquant ? »
Un village à l’heure coloniale, p. 9.
• Un village à l’heure coloniale. Draria, 1830-1962, de Colette Zytnicki, Belin, 320 p., 24 €.
• Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode, d’Ann Laura Stoler, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet et Joséphine Gross, préface d’Arlette Farge, Editions de l’EHESS, « En temps & lieux », 390 p., 26 €.
• Travail forcé et mobilisation de la main-d’œuvre au Sénégal. Années 1920-1960, de Romain Tiquet, préface d’Alexander Keese, postface d’Andreas Eckert, PUR, 282 p., 26 €.
28 juin 2019 : journée d’étude
aux Archives nationales d’Outre-mer (Aix-en-Provence) :
(Dé)construire les « archives coloniales » :
enjeux, pratiques et débats contemporains
Cette journée d’étude, organisée par le Groupe de recherche sur les ordres coloniaux (GROC) à Aix-en-Provence le vendredi 28 juin 2019, a pour objectif d’alimenter une réflexion à la fois épistémologique, théorique et pratique sur les usages des archives coloniales. Elle aura lieu au cœur d’une institution centrale pour les recherches portant sur le passé colonial français et le passé de nombreux autres pays : les Archives nationales d’Outre-mer (ANOM). Elle permettra ainsi de faire dialoguer les approches archivistes et historiennes, autour de trois axes de réflexion principaux : « Qu’est-ce qu’une archive coloniale ? » ; « Comment articulier l’“archive coloniale” à d’autres archives ? » ; « Les “archives coloniales” comme lieux d’histoire et de mémoire ». En plus des panels de discussions, cette journée d’étude prévoit une présentation des ANOM et de certains de ses fonds par les archivistes de l’institution.
Les « archives coloniales » : un sujet d’actualité
Qu’il s’agisse de la restitution d’archives aux pays anciennement colonisés ou de la déclassification de certains fonds jusqu’ici non-consultables, ces vingt dernières années ont été marquées par des controverses vives dont les « archives coloniales » ont été le centre. L’expression « archives coloniales » a désormais fait son entrée dans le débat public, corollaire de la prolifération du terme « colonial ». Ces dernières semaines, les médias se sont ainsi emparés d’une polémique scientifique, autour de la publication de Sexe, Race, et Colonies1, reproduisant et diffusant des archives coloniales bien particulières : celles issues de la domination sexuelle en situation coloniale. Certain-e-s chercheurs-euses2 ou/et militant-e-s3 ont avancé que cette démarche, insuffisamment appuyée sur un appareil critique spécifique, tendait au voyeurisme et, ce faisant, reproduisait en partie le geste colonial.
La parution de ce livre prend place dans un contexte marqué par l’actualité d’une réflexion épistémologique sur les archives coloniales. Il y a près de dix ans, Ann Laura Soler publiait Along the Archival Grain4 (qui attend toujours sa traduction) au retentissement encore important de nos jours. Dans cet essai, l’anthropologue s’oppose à l’approche, devenue dominante, de prendre « à contre-pied » des archives coloniales, ou de les contourner par « l’invention » d’autres sources (entendues comme « non-coloniales »), à la recherche des voix des colonisé-e-s5. L’auteure propose en effet de plonger frontalement dans les archives coloniales et, au moyen d’un appareil critique ajusté, de les prendre au sérieux dans ce qu’elles nous apprennent sur leur contexte de production, les catégories sociales et administratives mais aussi les affects qui les traversent, ainsi que la manière dont les institutions archivistiques coloniales se construisent et se structurent au sein des sociétés coloniales.
Axes de réflexion
À l’image du passé colonial qu’elles interrogent, les archives coloniales sont des matériaux historiques qui font constamment l’objet de controverses. Cette journée a donc pour objectif d’alimenter une réflexion, à la fois épistémologique, théorique et pratique sur les usages des archives coloniales. Elle aura lieu au cœur d’une institution centrale pour les recherches portant sur le passé colonial français et le passé de nombreux autres pays ; elle permettra également de faire dialoguer les approches archivistes et historiennes.
Qu’est-ce qu’une « archive coloniale » ?
Cette dénomination cache, en effet, une multiplicité de documents souvent (mais pas exclusivement) écrits. Qui les produit ? Si les archives sont constituées par les autorités coloniales elles-mêmes, les matériaux qu’elles regroupent peuvent être de simples saisies, originellement produits par d’autres groupes et donc, parfois, par les populations colonisées (courriers, brochures, pamphlets, etc.). Dès lors, comment user des catégories « coloniales » qui les structurent ? Sont-elles toutes marquées par un rapport de domination coloniale comparable ? Quelles méthodes, pratiques, voire précautions les historien-ne-s doivent-ils adopter face, et avec, ces dites « archives coloniales » ?
Comment articuler l’ « archive coloniale » à d’autres archives ?
Si le premier axe vise à identifier les catégories coloniales de même que les précautions à prendre à leur égard, il s’agira, dans un second temps, de souligner l’articulation avec, d’une part, des documentations « non-coloniales » (en interrogeant la pertinence de cette catégorisation). Ainsi, le recueil de témoignages oraux par les historien-ne-s, de même que la recherche des écrits de l’intime sont souvent mobilisé-e-s pour obtenir des alternatives aux récits des archives coloniales. D’autre part, dans le cadre de l’étude des archives coloniales, les fonds abrités aux Archives nationales d’Outre-mer (ANOM) peuvent être mis en regard avec ceux d’autres lieux de conservation (archives d’autres puissances coloniales, archives coloniales conservées localement ou fonds « diplomatiques » comportant un nombre important de volumes produits durant la colonisation). C’est notamment ainsi que peuvent s’observer les tensions, divergences ou cohérences entre différentes branches des administrations coloniales. Il s’agira donc ici d’interroger l’articulation de corpus archivistiques distincts, de décloisonner les approches, d’interroger l’unilatéralité des « archives coloniales », de saisir le « colonial » à travers des archives résultant de divers contextes de productions. L’établissement de tableaux synoptiques de répartition des archives, encore souvent difficile à saisir, voire de premiers « inventaires bilatéraux6 » pourra être abordée.
Les « archives coloniales » comme lieux d’histoire et de mémoire.
En témoignent les événements scientifiques (congrès de la French Colonial Historical Society), et grand-publics (journées du patrimoine) organisés aux ANOM : l’institution abritant les documents issus de la colonisation française a une place centrale dans la production de discours sur le passé colonial exclusivement. Quelle est l’histoire de ces archives7 ? Quelles sont les continuités et les ruptures dans l’histoire de l’institution ? Plus largement, comment ont cheminé les documents aujourd’hui consultables aux ANOM depuis leur production et leur organisation dans les armoires des institutions coloniales ? Quels gestes, quelles intentions et quels hasards ont conduit à la constitution des fonds ? Au-delà du moment de production et de classification des documents, quels usages en ont été faits et en sont faits à l’heure actuelle ? Qui les consulte et pourquoi ? En plus de ces interrogations d’ordre scientifique, quels sont les enjeux politiques et mémoriels entourant une institution rarement évoquée dans le débat public alors même qu’elle abrite des documents sensibles ? Comment mobiliser ces archives dans le cadre de la transmission et de l’enseignement de l’histoire de la colonisation française ?
En plus des panels de discussion, cette journée d’étude prévoit une présentation des ANOM et de certains de ses fonds par les archivistes de l’institution.
Le GROC
Le Groupe de recherche sur les ordres coloniaux (GROC) est un collectif d’une quarantaine de jeunes chercheurs et chercheuses en sciences sociales, fondé au printemps 2017. Nous avons tou-te-s en commun de travailler sur les « ordres coloniaux », c’est-à-dire sur la façon dont sont élaborés les Empires coloniaux (sans exclusive chronologie ni géographique), et dont l’ « ordre public » y est maintenu et contesté. Présent-e-s dans plusieurs universités, nous organisons à Paris des rencontres mensuelles de lectures, de dialogue et de travail.
• Élise Abassade (IDHES, Paris 8 – LAH, La Manouba, Tunis),
• Vincent Bollenot (CHAC, Paris 1),
• Quentin Gasteuil (Centre d’histoire du XIXe siècle – ISP, Sorbonne Université – ENS Paris-Saclay),
• Thierry Guillopé (ACP – CHS, Paris Est Marne-la-Vallée – Paris 1),
• David Leconte (IDEES – LARHRA, Le Havre – ENS Lyon),
• Sara Legrandjacques (CHAC, Paris 1),
• Julie Marquet (ICT – CHAC, Paris 7 – Paris 1),
• Baptiste Mollard (CESDIP, Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines).
- Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Pascal Blanchard, Jacques Martial, Achille Mbembe, Leïla Slimani, Christelle Taraud et Dominic Thomas (dir.), Sexe, race et colonies, Paris, La Découverte, 2018.
- Philippe Artières, « Sexe, Race et Colonies : livre d’histoire ou beau livre ? », Libération, 30 septembre 2018 ; Kaoutar Harchi, « Quand l’art est l’autre nom de la violence », Le nouveau magazine littéraire, 12 octobre 2018.
- Collectif Cases Rebelles, « Les corps épuisés du spectacle colonial », 27 septembre 2018 ; Mélusine, « Un ouvrage sans ambition scientifique », Libération, 30 septembre 2018.
- Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Commonsense, Princeton, Princeton University Press, 2009.
- Voir Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the subaltern speak ? », Social theory : the multicultural and classic readings Colonial discourse and post-colonial theory : a reader, in Cary Nelson et Lawrence Grossberg (dir.), Marxism and the Interpretation of Culture, Londres, Macmillan Education, 1988, p. 271 – 313.
- Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 15.
- Dans le prolongement des réflexions initiées par plusieurs auteurs dans Isabelle Dion et Benoît Van Reeth (dir.), Histoires d’Outre-mer : les Archives nationales d’outre-mer ont 50 ans, Aix-en-Provence et Paris, ANOM et Somogy, 2017.