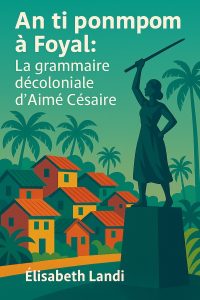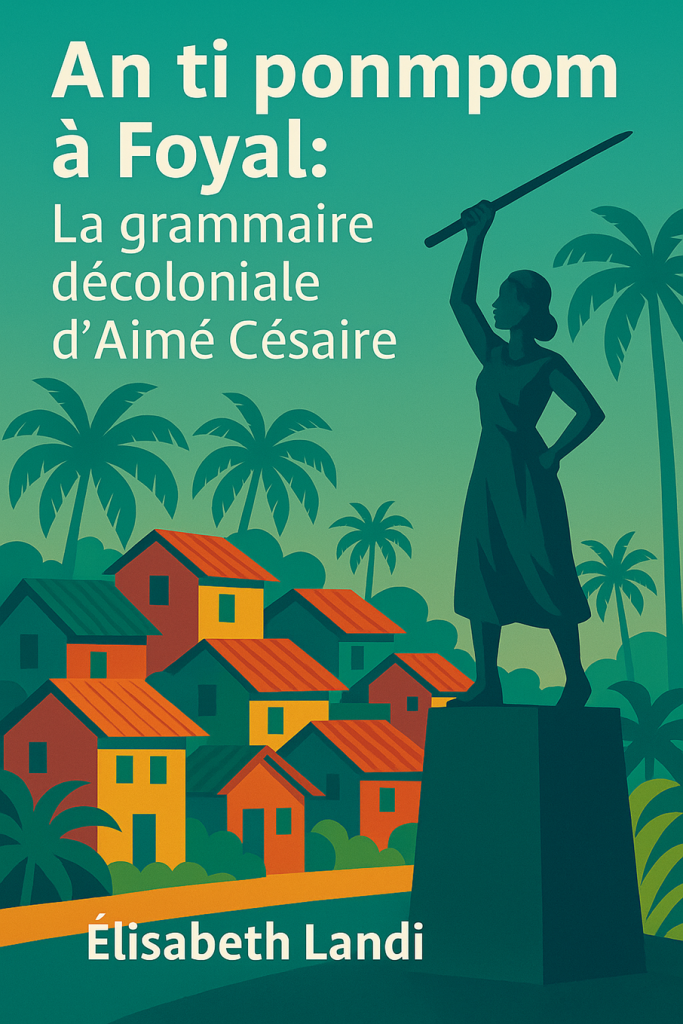
Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses « au-delà » de lèpres, de consomption, de famines, de peurs tapies dans les ravins, de peurs juchées dans les arbres, de peurs creusées dans le sol, de peurs en dérive dans le ciel, de peurs amoncelées et ses fumerolles d’angoisse,
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1939.
Bonnes feuilles
Prologue : Lire la ville autrement
Fort-de-France n’est pas seulement une capitale administrative, un nœud de circulation, ou un centre commercial caribéen. Elle est un texte spatial, une ville à lire, à déchiffrer, à interpréter. Son architecture, ses noms de rues, ses places, ses vides et ses pleins racontent une histoire faite de tensions, de ruptures, d’empreintes coloniales et de tentatives de réappropriation. Sous le béton, sous les plaques commémoratives, sous les statues, gisent les strates d’une mémoire disputée.
Cette mémoire, Aimé Césaire l’a habitée, questionnée, renversée. Poète de la Négritude, penseur de la décolonisation, mais aussi maire de Fort-de-France pendant plus de cinquante ans, il a conçu la ville comme un lieu d’inscription d’une parole politique et poétique. Loin de la simple gestion municipale, son action urbanistique s’est voulue une entreprise de réécriture symbolique de l’espace postcolonial, un effort pour faire exister une autre grammaire urbaine, non plus dictée par l’ordre colonial ou républicain imposé, mais enracinée dans la dignité retrouvée du peuple martiniquais.
Ce livre propose une lecture de Fort-de-France à partir de la politique patrimoniale conduite par Aimé Césaire lorsqu’il en fut maire, de 1945 à 2001. Loin d’un simple inventaire ou d’une mise en valeur touristique, il s’agit ici de comprendre comment Césaire a pensé la ville comme un texte à écrire, à corriger, à transmettre. Son action municipale s’inscrit dans une vision cohérente et patiente, où chaque choix de nomination, de statuaire, de mémoire ou d’espace culturel participe d’un projet de réappropriation historique et identitaire[1].
Ce livre propose de suivre les traces de cette réécriture, en empruntant la forme d’une balade urbaine. À chaque arrêt, une place, une rue, une statue, une absence aussi parfois. À chaque halte, une décision politique, un geste mémoriel, une tension historique. La ville devient ainsi archive vivanteetdiscours spatial, et le parcours physique s’articule à une lecture critique. Il ne s’agira pas de retracer l’histoire complète de Fort-de-France, ni de dresser l’inventaire de ses monuments, mais de saisir le geste césairien dans ce qu’il a de plus discret, de plus ambitieux, et parfois de plus paradoxal : faire d’une ville coloniale un espace d’émancipation.
Fort-de-France fut pour Césaire un laboratoire de la mémoire, un champ d’expérimentation où la pensée décoloniale s’est concrétisée dans les noms, les formes, les usages et les récits. Cette ville, il ne l’a pas seulement dirigée : il l’a pensée, il l’a habitée poétiquement, il l’a inscrite dans une grammaire nouvelle, à la fois politique, esthétique et symbolique. Lire cette grammaire, c’est entrer dans un monde de signes à la fois visibles et souterrains ; c’est apprendre à voir autrement.
Ce livre est donc une invitation à marcher dans les pas d’Aimé Césaire, non pour commémorer, mais pour comprendre. Car la ville, lorsqu’elle est pensée comme un texte, ne se lit jamais de manière neutre. Elle engage, elle interpelle, elle résiste. Et c’est dans cette résistance que se construit la conscience décoloniale.
La notion de grammaire décoloniale sert ici de fil conducteur. Elle emprunte au langage une métaphore forte : une grammaire est un ensemble de règles, explicites ou implicites, qui organisent les relations, les significations, les formes. Parler de grammaire urbaine et patrimoniale, c’est postuler que la ville, comme toute langue, dit quelque chose de ses habitants, de son histoire, de ses dominations, mais aussi de ses possibilités d’émancipation. Ce que Césaire a entrepris, c’est une réécriture stratégique de cette grammaire, à partir de son engagement politique, de sa pensée décoloniale, et de sa fidélité aux luttes des opprimés.
Ce travail prend la forme d’une promenade urbaine commentée, méthodiquement structurée. Chaque halte correspond à un lieu emblématique, un toponyme, un monument, une place, une œuvre. Le lecteur est invité à circuler dans Fort-de-France comme dans un espace de mémoire active, où l’histoire coloniale n’est pas gommée, mais travaillée, déplacée, resignifiée. Loin d’un discours surplombant, l’ouvrage propose une lecture située, au plus près des gestes politiques de Césaire, de ses discours, de ses silences, et de ses choix concrets.
Les sources mobilisées sont multiples : discours d’Aimé Césaire, procès-verbaux du conseil municipal, récits de presse, archives visuelles, extraits d’ouvrages historiques et littéraires. Mais la démarche est aussi ancrée dans une expérience vécue de la ville, dans l’observation fine de ses strates, de ses usages, de ses lieux négligés ou réinvestis. C’est pourquoi ce livre se veut aussi un outil de transmission pour les jeunes générations, un manuel d’arpentage du présent à partir des combats du passé.
Introduction : grammaire, grammaire urbaine et patrimoniale, grammaire césairienne et décoloniale.
Une grammaire est un ensemble de règles et de principes qui régissent le fonctionnement d’une langue. Elle permet de structurer et d’organiser les mots pour produire des énoncés compréhensibles et corrects selon les normes linguistiques d’une communauté donnée. Dans tous les cas, la grammaire est essentielle à la compréhension, à l’apprentissage et à la transmission d’une langue, qu’elle soit écrite ou orale. Elle constitue le cadre structurel qui permet de produire un discours cohérent, intelligible et conforme aux attentes linguistiques d’un groupe donné. La grammaire est à la fois un outil de communication, d’apprentissage,de réflexion et de construction identitaire. Elle permet de faire fonctionner la langue, de la transmettre et de la comprendre dans ses usages et ses évolutions.
La grammaire urbaine désigne l’ensemble des règles, structures et principes qui régissent la composition, l’usage et la perception de l’espace urbain. Elle permet de comprendre comment une ville est « construite », « agencée » et « interprétée », à la manière dont la grammaire structure une langue.
La grammaire urbaine est utilisée mais dans un sens métaphorique ou transposé du terme « grammaire ». Il ne s’agit pas ici de règles linguistiques, mais d’un système d’organisation et de lecture de l’espace urbain. Le terme a été popularisé par les urbanistes, les architectes et les sociologues, notamment à partir des années 1960-1970. La grammaire urbaine permet d’analyser les formes urbaines (rues, places, bâtiments, parcs, etc.), de comprendre les logiques d’aménagement (zonage, hiérarchies spatiales, mobilité), de lire les relations sociales dans l’espace (inclusion, exclusion, frontières symboliques) et de concevoir des projets urbains respectant ou modifiant cette « syntaxe » urbaine.
Comme la grammaire linguistique, la grammaire urbaine peut être descriptive (constater les structures existantes) ou prescriptive (orienter la conception urbaine). Elle est souvent mobilisée dans des réflexions sur l’identité d’un territoire, la mémoire urbaine, les inégalités spatiales et les dynamiques de transformation (gentrification, rénovation, etc.).
Parler de grammaire urbaine, c’est reconnaître que l’espace urbain possède une logiquepropre, faite de règles, de rythmes, de structures lisibles ou implicites, qui organisent la vie en société. C’est un outil conceptuel riche pour penser la ville non comme un simple décor, mais comme un langage complexe, porteur de sens et d’histoire.
La grammaire patrimoniale dans une ville, bien que peu usitée dans le langage courant, peut être mobilisée de manière rigoureuse pour désigner l’ensemble des codes, des formes et des logiques qui structurent la présence, la mise en valeur et l’activation du patrimoine urbain.
À l’image de la grammaire d’une langue ou de celle qui structure l’espace urbain, on peut parler d’une grammaire patrimoniale pour désigner l’ensemble des règles, souvent invisibles mais bien présentes, qui déterminent la façon dont une société choisit ce qu’elle souhaite conserver, valoriser, raconter. Cette grammaire, faite de pratiques, de récits, de classements et de gestes symboliques, guide nos regards : elle décide de ce qui mérite d’être protégé (comme un monument historique), de la manière dont un lieu est mis en scène (par l’éclairage, une plaque, un musée), de l’usage qu’on peut encore en faire aujourd’hui, et du rôle qu’il joue dans l’image que la ville donne d’elle-même, dans ce qu’elle veut transmettre de son histoire, de ses identités, de sa mémoire[2].
Cette grammaire patrimoniale peut se lire à travers plusieurs dimensions, qui se croisent et se répondent. Il y a d’abord la dimension matérielle, celle des formes visibles : le bâti, les matériaux, les traces, les styles – tout ce qui compose l’aspect physique du patrimoine et la manière dont il s’insère dans la ville. Vient ensuite la dimension narrative, qui interroge les récits dominants : quelles figures met-on en avant ? Que choisit-on de raconter – ou d’oublier ? Le patrimoine peut glorifier les héros, mais aussi passer sous silence[3] des mémoires plus douloureuses, comme celles de l’esclavage ou du monde ouvrier.
Il y a aussi une dimension symbolique, plus invisible, qui touche à la valeur que l’on accorde à certains lieux : un cimetière, une place, un monument deviennent parfois des marqueurs d’identité ou de mémoire collective. La dimension institutionnelle, elle, concerne les politiques de conservation, les lois, les classements, mais aussi les jeux d’acteurs : État, collectivités, experts, habitants, chacun ayant son mot à dire – ou non. Enfin, la dimension usagère rappelle que le patrimoine n’est pas qu’un objet figé : on y vit, on y circule, on y consomme, on s’y recueille. C’est ce que les gens font du patrimoine qui le fait vivre[4].
Cette grammaire n’est jamais neutre. Elle révèle des choix culturels et politiques, des tensions entre conservation et modernisation, patrimoine matériel et immatériel, mémoire dominante et mémoires marginales, patrimoine élitiste et patrimoine vernaculaire et patrimoine « figé » et patrimoine vivant.
Elle peut donc être interrogée de manière critique : quels héritages sont valorisés ? Quels récits sont invisibilisés ? Quelle mémoire pour quelle ville ?
Parler de grammaire patrimoniale, c’est souligner que le patrimoine ne se donne pas naturellement, mais qu’il est construit selon des règles, des logiques et des représentations, qui méritent d’être identifiées, analysées et, parfois, déconstruites. C’est un outil conceptuel puissant pour penser la manière dont la ville produit du patrimoine autant qu’elle en hérite.
La grammaire décoloniale d’Aimé Césaire dans la ville de Fort-de-France.
Écrire un livre sur la grammaire de la ville de Fort-de-France, à partir de la politique patrimoniale d’Aimé Césaire, permet de croiser plusieurs champs — l’histoire urbaine, les études postcoloniales, la mémoire, l’esthétique de l’espace — autour d’un fil directeur fondamental : la décolonisation de la lecture de la ville.
Il ne s’agit pas d’une histoire « descriptive » du patrimoine foyalais, mais d’une lecture critique et engagée de sa mise en forme, en lien avec un projet politique, culturel et mémoriel incarné par Césaire.
Aimé Césaire, maire-passeur d’une ville à reconfigurer
Aimé Césaire, maire de Fort-de-France de 1945 à 2001, a mené une politique urbaine qui peut être lue comme une tentative de réappropriation symbolique de l’espace colonial, par la nomination, la commande artistique, la valorisation des figures de résistance, l’intégration du peuple noir dans l’imaginaire monumental. Il s’agit donc d’une urbanisation mémorielle, qui vise à refonder l’identité urbaine en articulant espace, histoire et conscience postcoloniale.
Rendre visible et penser la grammaire de la ville comme un langage spatial et symbolique, mais aussi comme une expérience incarnée, que l’on peut parcourir m’a semblé d’une importance cruciale pour lever les malentendus et les contre sens. J’ai choisi la forme d’une balade urbaine en adoptant une structure à la fois narrative, topographique et réflexive pour inviter le lecteur à voir la ville autrement, comme un texte écrit par la pensée politique et poétique d’Aimé Césaire.
Cette publication a l’ambition d’être à la croisée de plusieurs registres : une histoire politique et urbaine de Fort-de-France, une archéologie critique du patrimoine postcolonial, une lecture poétique et conceptuelle de la ville (dans l’esprit de Césaire lui-même, dont le regard sur la ville est aussi un regard poétique, visionnaire, dialectique). Il se veut aussi un essai citoyen, inscrit dans les débats contemporains sur la mémoire, la décolonisation des espaces publics, et la fabrique identitaire des villes.
L’objectif est de procéder par une approche sensible et incarnée se dans la matière même de la ville : rues, places, monuments, bâtiments publics deviennent des signes à décrypter. Cela engage une lecture non abstraite, mais en situation, au rythme de la marche, du regard, du détail. C’est aussi une façon puissante de réconcilier l’histoire urbaine avec l’expérience vécue, et de transmettre au lecteur non seulement un savoir, mais une perception transformée de Fort-de-France.
L’idée d’une démarche pédagogique et politique me paraît également judicieuse car elle permet de s’approprier la ville à travers la lecture et la volonté d’Aimé Césaire. La forme de la balade guide le lecteur dans un itinéraire construit, à la fois géographique et intellectuel. Elle donne à voir comment le politique façonne l’espace, comment les choix patrimoniaux sont des gestes d’écriture de la ville. Elle inviter à relire l’héritage césairien à travers les lieux qu’il a transformés, renommés, investis, ou même refusés. Enfin, cela permet également de restituer la cohérence de son projet, non pas comme une succession d’initiatives isolées, mais comme une vision de la ville décolonisée.
La ville comme grammaire, le patrimoine comme poétique politique
Césaire affirmait : « Je ne suis d’aucune nation, je suis de toutes. » Ce livre lui répond, en montrant comment il a fait de Fort-de-France une ville qui parle toutes les langues de l’humanité : la langue des esclaves marrons, des révolutionnaires oubliés, des anonymes, des poètes, et des peuples en lutte.
[1] Marcel Dorigny, « Les abolitions de l’esclavage de L.F. Sonthonax à V. Schoelcher 1793 1794 1848 », actes du colloque international tenu à l’Université de Paris VIII 3-5 février 1994, UNESCO – Presses Universitaires Vincennes, 1998 et Jean-Luc Bonniol, « Les usages publics de la mémoire de l’esclavage colonial », dans Matériaux pour l’Histoire de notre temps, 2007 / 1, N°85.
[2] Michel Lussault, « L’homme spatial », Seuil, 2007 et Pierre Nora (dir.), « Les lieux de mémoire », Gallimard, 1984 – 1992.
[3] Françoise Vergès, « Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée », La Fabrique éditions, 2023.
[4] Nicolas Adell, « Le patrimoine, l’éthique, l’identité », La Ricerca Folklorica, Non. 64, Beni im immatérieli La Convenzione Unesco e il folklore (ottobre 2011), p. 81 et 93 (13 pages), https://www.jstor.org /stable/23629709
Table des matières
Prologue : Lire la ville autrement. 7
Introduction : grammaire, grammaire urbaine et patrimoniale, grammaire césairienne et décoloniale. 9
La grammaire décoloniale d’Aimé Césaire dans la ville de Fort-de-France. 11
Aimé Césaire, maire-passeur d’une ville à reconfigurer. 11
La ville comme grammaire, le patrimoine comme poétique politique. 12
Chapitre 1. La statue déboulonnée : Joséphine et la Savane, entre silence et subversion. 13
Une statue pour reprendre possession : Joséphine et la restauration coloniale. 13
Césaire déplace : recentrer la mémoire, désacraliser l’icône. 14
Décapiter l’icône : le silence comme stratégie politique. 15
De la statue au jardin : déboulonner pour refleurir ? (2020) 16
Encadré : Joséphine, l’esclavage et la mémoire. 18
Chapitre 2. Rue Blénac : conserver le nom du fondateur. 19
Fort-Royal : naître dans les marécages du pouvoir. 19
Une figure ambiguë : Blénac, fondateur et législateur de l’esclavage. 19
Césaire et Blénac : une mémoire des origines, non une célébration. 20
Repère biographique : Charles de Courbon, comte de Blénac (v. 1622 – 1696) 23
Chapitre 3. Place Monseigneur Romero : verticalité sacrée et mémoire des justes. 24
Un lieu de tension entre domination religieuse et spiritualité populaire. 24
Césaire et la religion : entre rejet de l’institution et sens du sacré. 25
Une statuaire absente, mais une parole présente. 25
Repère : Óscar Arnulfo Romero (1917–1980) 26
Notice patrimoniale : La cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. 26
Chapitre 4. Place Légitime Défense et la statue de Victor Schœlcher. 27
Promenade historique sur la place Légitime Défense. 27
Césaire, Schœlcher et la relecture critique de l’abolition. 28
Chute du monument : un renversement de paradigme (2020) 30
La République dans les rues : cartographie d’un idéal 33
Figures absentes, figures déplacées : Bissette, Volny, Marajo, Véronique. 33
Le banc de Césaire : mémoire diasporique et humilité poétique. 34
Une ville écrite à hauteur d’homme. 35
Repère biographique : Cyrille Bissette (1795–1858), mémoire empêchée et rejetée. 37
Repère mémoriel : The Bench by the Road Project 37
Notice historique : Les morts de décembre 1959 : Betzy, Véronique, Marajo. 38
Le quartier des progressistes et des révolutionnaires. 39
La place Abbé Grégoire : panthéon d’un homme juste. 39
Une mémoire radicale, habitée par l’universel 41
Repère biographique : Henri Grégoire (1750–1831), prêtre, révolutionnaire et humaniste. 43
Chapitre 7. Trénelle, 22 mai 1971 : la Négresse marronne ou la liberté reconquise. 44
Une autre mémoire de l’abolition : entre Schœlcher et la Négresse. 44
Le discours de Césaire : “Il faut rétablir la vérité historique”. 45
Une grammaire visuelle de l’insoumission. 46
Une figure pour les sans-visages. 47
Repère biographique : Kho-Kho René-Corail (1936–2012), sculpteur de l’histoire populaire. 48
Chapitre 8. Le Parc culturel Aimé Césaire : une révolution culturelle en actes. 49
La culture comme levier de souveraineté symbolique. 49
Une rupture dans les représentations : la culture légitime redéfinie. 49
Le SERMAC : outil de transmission, fabrique d’identité. 50
Une esthétique de la réconciliation : la Savane, le Parc, la ville. 51
Une politique culturelle de type révolutionnaire. 51
Le mot est devenu tellement courant que les Martiniquais ne. 52
Un monument colonial porteur d’un récit d’assimilation. 53
La métamorphose : une grammaire politique césairienne. 54
Le SERMAC et la politique culturelle comme re-naissance. 54
L’intervention de Kho-Kho René-Corail : reconfigurer le regard. 55
Vers une éthique de la complexité et de la responsabilité. 55
Conclusion « An ti Ponmpom à Foyal » : la ville comme poésie politique. 57
Discours / sources d’Aimé Césaire : 62
Textes / sources d’Elisabeth Landi 62
Discours « Le combat de Schœlcher continue », prononcé le 21 juillet 1951 sur la Savane. 70
Discours du 22 mai 1971 pour l’inauguration de la place du 22 Mai à Trénelle par Aimé Césaire. 77