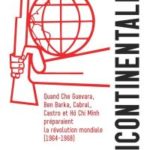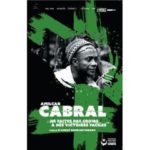« Amílcar Cabral envoûte la conférence »,
par Roger Faligot
Extrait de Tricontinentale. Quand Che Guevara, Ben Barka, Cabral, Castro et Hô Chi Minh préparaient la révolution mondiale (1964-1968) (La Découverte, 2013), pages 405 à 417.
Roger Faligot, reporter et romancier, est l’auteur d’une quarantaire d’ouvrages sur l’histoire contemporaine, dont La Résistance irlandaise (Maspero, 1977) ; La Piscine (1985), Le peuple des enfants (2004), Histoire secrète de la Ve République (avec Jean Guisnel et Rémi Kauffer, La Découverte, 2006). Les services secrets chinois (2008), La Rose et l’edelweiss (La Découverte, 2009), Paris, nid d’espions (2009), Les sept portes du monde (Plon, 2010), Histoire politique des services secrets français (avec Jean Guisnel et Rémi Kauffer, La Découverte, 2012) et Tricontinentale 1964-1968 (2013).

6 janvier 1966, salon des Ambassadeurs, hôtel Habana Libre
Amílcar Cabral ne fut pas seulement le premier à parler ce matin-là, il lui était accordé un temps aussi long qu’à ses camarades vietnamiens, parce qu’il allait parler d’un sujet qui concernait des « affaires brûlantes » et parce qu’il représentait tout un groupe de pays et de mouvements, ceux qui combattaient le colonialisme portugais. Parlant au nom de trois formations, il reçut trois fois plus de temps. Ces mouvements de libération étaient les plus avancés en Afrique. L’armée portugaise subissait d’importants revers. Édouard Bailby, qui venait de faire un reportage au Mozambique pour L’Express, racontait que l’état-major portugais était désemparé : en tête de patrouille, ses soldats se faisaient tirer dessus par le Frelimo, en queue, ils se faisaient « bouffer par les lions »…
Toutefois, il y avait eu quelques hiatus concernant la participation des mouvements à La Havane. Tandis que le MPLA combattait avec les hommes de Jorge Risquet au Cabinda, le premier de ses dirigeants, Agostinho Neto, n’avait pas souhaité faire le voyage à Cuba. Naturellement, il n’était pas le seul chef de guérilla à préférer rester sur le champ de bataille et, malgré tout, une importante délégation de son mouvement menée par Mario de Andrade et Luis de Almeida participait au conclave. Le cas du Mozambique était également ambigu, dans la mesure où, suite à la rencontre du Che et d’Eduardo Mondlane (fondateur du Frelimo), avait surgi un désaccord et la commission d’organisation n’avait finalement pas invité ce dernier.
Faisant fi de ces différends, Amílcar Cabral était bien décidé à représenter tous ces mouvements en développant son discours intitulé « L’arme de la théorie ». Il l’engagea avec un débit régulier, sûr de son fait : « Les peuples et les organisations nationalistes d’Angola, du Cap-Vert, de Guinée, du Mozambique, de São Tome et Principe ont mandaté leurs délégations à cette conférence pour deux raisons principales. Premièrement : nous voulons être présents et prendre activement part à cet événement transcendant de l’histoire de l’humanité. Deuxièmement : il était de notre devoir politique et moral d’apporter au peuple cubain, en ce moment doublement historique du septième anniversaire de la révolution et de la première conférence tricontinentale, une preuve concrète de notre solidarité fraternelle et combative. »
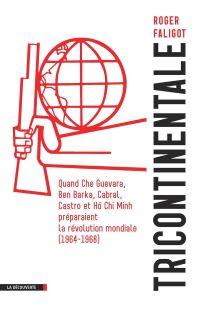
Dans les minutes qui suivirent, sous les applaudissements, Cabral rendit un hommage appuyé à Cuba et sa révolution, à Fidel – avec qui il avait longuement parlé la veille au soir – et à ses camarades : « De ce que nous avons déjà vu et sommes en train d’apprendre à Cuba, nous voulons rapporter une leçon singulière dans laquelle se trouve, à notre avis, un des secrets, pour ne pas dire le véritable secret, de ce que beaucoup n’hésiteraient pas à appeler le “miracle cubain” : la communion, l’identification, la synchronisation, la confiance mutuelle et la fidélité entre les masses et leurs dirigeants. »
C’était naturellement flatteur pour Fidel Castro, mais aussi rusé de la part d’Amílcar Cabral car, l’instant d’après, il évoqua un sujet généralement tabou, celui des opposants à la révolution : « D’aucuns ne manqueront pas de noter que, bien que constituant une minorité insignifiante, certains Cubains n’ont pas partagé les joies et les espoirs des fêtes du septième anniversaire, parce qu’ils sont contre la révolution. Il est possible que d’autres encore ne soient pas présents à la célébration du prochain anniversaire. Mais nous voulons affirmer que nous considérons la politique de la “porte ouverte pour la sortie des ennemis de la révolution” comme une leçon de courage, de détermination, d’humanisme et de confiance envers le peuple, comme une victoire de plus, politique et morale, sur l’ennemi. Et nous garantissons à ceux qui, d’un point de vue amical, s’inquiètent des dangers que cette sortie peut présenter, que nous, les peuples des pays africains, encore partiellement ou totalement dominés par le colonialisme portugais, sommes prêts à envoyer à Cuba autant d’hommes et de femmes qu’il serait nécessaire pour compenser la sortie de ceux qui, pour des raisons de classe ou d’inadaptation, ont des intérêts et des attitudes incompatibles avec les intérêts du peuple cubain. En reprenant le chemin, autrefois douloureux et tragique, de nos ancêtres (notamment de Guinée et d’Angola), qui ont été transplantés à Cuba comme esclaves, nous viendrions aujourd’hui en hommes libres, en travailleurs conscients et en patriotes cubains, pour exercer une activité productive dans cette société nouvelle, juste et multiraciale, pour aider et défendre avec notre sang les conquêtes du peuple de Cuba. »
Pour en terminer avec cet aspect, devant un parterre intrigué mais passionné de voir l’un de ses leaders abandonner toute langue de bois, Cabral insista sur ce projet utopique d’envoyer des Africains renforcer la citadelle assiégée par les Américains. Autrement dit, le symétrique de ce qu’avait fait le Che quelques mois plus tôt : « Mais nous viendrions renforcer également, tant sont forts les liens historiques, de sang et de culture qui unissent nos peuples au peuple cubain, cette décontraction magique, cette joie profonde et ce rythme contagieux, qui font de la construction du socialisme à Cuba un phénomène nouveau à la face du monde, un événement unique et, pour beaucoup, insolite. »
Insolite, le mot était faible. Tout comme était insolite la proposition suivante du chef du PAIGC de ne pas utiliser la tribune d’où il s’exprimait pour « nous en prendre à l’impérialisme ». Objectif ? Sortir des chemins convenus souvent empruntés par les autres délégués. L’explication commençait par un proverbe : « Un dicton africain très répandu dans nos pays, où le feu est encore un instrument important et un ami perfide – ce qui prouve l’état de sous-développement que nous lègue le colonialisme –, avertit : “Quand ta case brûle, rien ne sert de battre le tam-tam.” Sur le plan tricontinental, cela veut dire que ce n’est pas en criant ni en proférant des injures contre l’impérialisme que nous allons parvenir à sa liquidation. Pour nous, la façon la plus efficace de critiquer l’impérialisme, quelle que soit sa forme, c’est de prendre les armes et de combattre. C’est ce que nous sommes en train de faire, et c’est ce que nous ferons jusqu’à la liquidation totale de la domination étrangère sur nos patries africaines. »
Puis le chef du PAIGC précisa qu’il était venu pour informer la conférence sur le déroulement des luttes contre le Portugal colonial. Pas seulement par son discours, mais aussi, comme il l’avait appris aux côtés de ses amis Mario Marret ou Gérard Chaliand, « au moyen de documents, de films, de photographies », ou de contacts bilatéraux avec d’autres délégations. Et d’insister : « En vérité, nous sommes venus à cette conférence convaincus que c’est là une occasion unique pour un plus ample échange d’expériences entre les combattants d’une même cause, pour l’étude et la solution des problèmes vitaux de notre lutte commune, tendant non seulement au renforcement de notre unité et de notre solidarité, mais aussi au perfectionnement de la pensée et de l’action de chacun et de tous dans la pratique quotidienne de la lutte. »
Le deuxième critère que Cabral voulait développer, tranchant par rapport au discours convenu de nombreux autres dirigeants de forces de guérilla, équivalait à une autocritique. Ce qui pouvait se dire en interne, à l’intérieur des organisations, mais rarement en public : « Nous observons, cependant, qu’un type de lutte fondamental à nos yeux n’est pas mentionné d’une façon expresse dans ce programme de travail [de la conférence], bien que nous soyons certains qu’il est présent à l’esprit de ceux qui l’ont élaboré. Nous nous référons ici à la lutte contre nos propres faiblesses… » De nombreux délégués crurent sans doute que les interprètes avaient des soucis de traduction. Mais Cabral revint à la charge, les yeux emplis de malice derrière les verres fumés de ses lunettes : « D’autres cas diffèrent des nôtres ; toutefois, notre expérience nous enseigne que, dans le cadre général de la lutte quotidienne, quelles que soient les difficultés créées par l’ennemi, cette lutte contre nous-mêmes est la plus difficile, aussi bien au moment présent que dans l’avenir de nos peuples. Cette lutte est l’expression des contradictions internes de la réalité économique, sociale et culturelle (et donc historique) de chacun de nos pays. Nous sommes convaincus que toute révolution nationale ou sociale qui ne possède pas comme base fondamentale la connaissance de cette réalité risque fort d’être condamnée à l’insuccès, sinon à l’échec. »

Amílcar Cabral n’était par un dirigeant ordinaire, comme beaucoup d’idéologues passés à la lutte armée à défaut d’autres options politiques, ou emportés par le tumulte des événements. Le Guinéen était avant tout un homme de terrain, un agronome qui avait commencé par étudier le substrat économique, culturel, social et tribal de son pays avant de définir les moyens à utiliser pour encourager toute une population à résister. Ce 6 janvier 1966, un an jour pour jour après sa rencontre avec Che Guevara à Conakry, il lui semblait opportun de souligner comment s’élaborait une stratégie sur le continent africain : « Il est bon de se rappeler, dans cette ambiance tricontinentale où les expériences et les exemples abondent, que, si grandes soient la similitude des cas en présence et l’identité de nos ennemis, la libération nationale et la révolution sociale ne sont pas des marchandises d’exportation ; elles sont – et chaque jour davantage – le produit d’une élaboration locale, nationale, plus ou moins influencée par des facteurs extérieurs (favorables et défavorables), mais essentiellement déterminée et conditionnée par la réalité historique de chaque peuple, et consolidée par la victoire ou la solution correcte des contradictions internes entre les diverses catégories qui caractérisent cette réalité. […]
« Nous devons reconnaître, toutefois, que nous-mêmes et les autres mouvements de libération en général (nous nous référons surtout à l’expérience africaine) n’avons pas su apporter toute l’attention nécessaire à ce problème important de notre lutte commune. Le défaut idéologique, pour ne pas dire le manque total d’idéologie, au sein des mouvements de libération nationale – ce qui se justifie à la base par l’ignorance de la réalité historique que ces mouvements prétendent transformer – constitue une des plus grandes, sinon la plus grande faiblesse de notre lutte contre l’impérialisme. »
Mais ce n’était pas tout. Celui que Ben Barka avait baptisé le « Lénine africain » allait faire sursauter les « léninistes » en leur suggérant de revoir leurs classiques : « Ceux qui affirment – et, à notre point de vue, avec raison – que la force motrice de l’Histoire est la lutte de classes seraient certainement d’accord pour réviser cette assertion, afin de la préciser et de lui donner un champ d’application encore plus vaste, s’ils connaissaient plus profondément les caractéristiques essentielles de certains peuples colonisés, c’est-à-dire dominés par l’impérialisme. En effet, dans l’évolution générale de l’humanité et de chacun des peuples qui la composent, les classes n’apparaissent ni comme phénomène généralisé et simultané dans la totalité de ces groupes ni comme un tout achevé, parfait, uniforme et spontané. »
Charaf Rachidov, qui devait prendre la parole dans l’après-midi, et ses nombreux camarades se demandèrent s’ils allaient devoir « manger leur chapeau ». Tout ça pour ça ? La veille, ils s’étaient fait étriller par les Chinois. Et aujourd’hui un petit militant barbu était en train de leur expliquer que la « lutte des classes » n’était peut-être pas un concept opérationnel pour analyser la situation africaine… Après avoir développé ce concept, qui semblait au contraire ravir de nombreux « tricontinentaux » plus pragmatiques qu’idéologues, Amílcar interrogea l’assemblée qui ne s’attendait pas, après deux jours d’interventions souvent pontifiantes, à un tel sursaut oscillant entre sociologie militante et philosophie politique. Le tout très pédagogique et fort simple à comprendre : « Ce qui vient d’être dit permet de poser la question suivante : est-ce que l’Histoire commence seulement à partir du moment où se développe le phénomène “classe” et par conséquent la lutte de classes ? Répondre affirmativement reviendrait à situer hors de l’Histoire toute la période de vie des groupes humains qui va de la découverte de la chasse et, postérieurement, de l’agriculture nomade et sédentaire à la création des troupeaux et à l’appropriation privée de la terre.
« Ce serait aussi alors – et nous nous refusons à l’accepter – considérer que plusieurs groupes humains d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine vivaient sans histoire, ou en dehors de l’Histoire, au moment où ils furent soumis au joug de l’impérialisme. Ce serait considérer que des populations de nos pays, telles que les Balantes de Guinée, les Kouaniama d’Angola et les Maconde du Mozambique, vivent encore aujourd’hui – si nous faisons abstraction des légères influences du colonialisme auxquelles elles furent soumises – en dehors de l’Histoire, ou n’ont pas d’histoire. […] Parce que si, d’un côté, nous constatons que l’existence de l’Histoire avant la lutte des classes est garantie, et évitons par là à quelques groupements humains de nos pays – et peut-être de notre continent – la triste condition de peuples sans histoire, nous dégageons, d’un autre côté, la continuité de l’Histoire, même après la disparition de la lutte de classes ou des classes elles-mêmes. »
En passant à l’actualité plus chaude, l’homem grande rappela que « la libération nationale d’un peuple est la reconquête de la personnalité historique de ce peuple, elle est son retour à l’Histoire au moyen de la destruction de la domination impérialiste à laquelle il était soumis ». Son diagnostic de la situation internationale prenait aussi les délégués de la Tricontinentale à rebrousse-poil : « Nous n’allons pas répéter ici que ces conditions sont franchement favorables au stade actuel de l’histoire de l’humanité ; il suffit de rappeler qu’il existe aussi des facteurs défavorables, aussi bien sur le plan international que sur le plan intérieur de chaque nation, dans sa lutte pour la libération.
La politique dite « aide aux pays sous-développés »
« Sur le plan international, il nous paraît que les facteurs suivants sont pour le moins défavorables aux mouvements de libération nationale : la situation néocoloniale d’un grand nombre d’États ayant accédé à l’indépendance politique, s’ajoutant à d’autres ayant déjà accédé à cette situation ; les progrès réalisés par le néocapitalisme, en particulier en Europe, où l’impérialisme a recours à des investissements préférentiels, encourageant le développement d’un prolétariat privilégié avec, comme conséquence, la diminution du niveau révolutionnaire des classes laborieuses ; la situation néocoloniale ouverte ou déguisée de quelques États européens qui, comme le Portugal, possèdent encore des colonies ; la politique dite “aide aux pays sous-développés” pratiquée par l’impérialisme dans le but de créer ou de renforcer les pseudo-bourgeoisies autochtones, nécessairement inféodées à la bourgeoisie internationale, et de barrer ainsi la route à la révolution ; la claustrophobie et la timidité révolutionnaire, qui amènent quelques États nouvellement indépendants et disposant de conditions économiques et politiques intérieures favorables à la révolution à accepter des compromis avec l’ennemi ou avec ses agents ; les contradictions croissantes entre États anti-impérialistes. Et, finalement, les menaces, du côté de l’impérialisme, contre la paix mondiale dans la perspective d’une guerre atomique. Ces facteurs contribuent à renforcer l’action de l’impérialisme contre le mouvement de libération nationale. »
Ainsi tout le monde en prenait pour son grade. Cependant, fort de son expérience de la guérilla en Afrique, Amílcar Cabral pouvait définir des principes de la « violence révolutionnaire » applicables aux autres continents : « Il n’y a pas de peuple sur terre qui, ayant été soumis au joug impérialiste (colonialiste ou néocolonialiste), ait conquis son indépendance (nominale ou effective) sans victimes. Ce qui importe, c’est de déterminer quelles sont les formes de violence qui doivent être utilisées par les forces de libération nationale, pour répondre non seulement à la violence de l’impérialisme, mais aussi pour garantir par la lutte la victoire finale de sa cause : la véritable indépendance nationale.
« Les expériences du passé et du présent vécues par certains peuples, la situation actuelle de la lutte de libération nationale dans le monde (spécialement au Viêt-Nam, au Congo et au Zimbabwé), ainsi que la situation de violence permanente, ou tout au moins de contradictions et de sursauts, dans laquelle se trouvent certains pays ayant conquis leur indépendance par la voie dite pacifique, nous démontrent que non seulement les compromis avec l’impérialisme sont inopérants, mais aussi que la voie normale de libération nationale, imposée aux peuples par la répression impérialiste, est la lutte armée. Nous ne croyons pas scandaliser cette assemblée en affirmant que la voie unique et efficace pour la réalisation définitive des aspirations des peuples, c’est-à-dire pour l’obtention de la libération nationale, est la lutte armée. »
Sur ce point, à l’exception des délégations résolument non violentes comme celle de l’Inde, la plupart des représentations des trois continents pouvaient tomber d’accord. Mieux, les Chinois – chez qui le PAIGC avait envoyé des hommes en formation au début de la décennie – approuvaient cette optique très radicale. Paradoxalement, elle arrangeait aussi Charaf Rachidov qui, à la surprise des précédents, allait justifier l’emploi de la lutte armée dans son oraison de l’après-midi. Si jamais il faisait l’objet de critiques dans son propre camp, à Moscou, il aurait beau jeu d’expliquer comment il y avait été poussé du fait des arguments développés par des mouvements que l’URSS espérait mettre sous tutelle : les mouvements de libération des colonies portugaises.
Le rôle de la petite bourgeoisie
Mais le dirigeant ouzbek allait déchanter lorsque Amílcar reprécisa un aspect très personnel de sa conception de la lutte des classes : le rôle de la petite bourgeoisie, dont il était au fond issu. Une petite bourgeoisie qui jouait un rôle révolutionnaire, mais qui devait ensuite disparaître pour se fondre dans le peuple libérateur : « Pour ne pas trahir ces objectifs, la petite bourgeoisie n’a qu’un seul chemin : renforcer sa conscience révolutionnaire, répudier les tentatives d’embourgeoisement et les sollicitations naturelles de sa mentalité de classe, s’identifier aux classes laborieuses, ne pas s’opposer au développement normal du processus de la révolution. Cela signifie que, pour remplir parfaitement le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, la petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe, pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire, entièrement identifiée avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle appartient. Cette alternative – trahir la révolution ou se suicider comme classe – constitue le choix de la petite bourgeoisie dans le cadre général de la lutte de libération nationale. »
Au terme de son discours décoiffant, déjà plusieurs fois interrompu par les applaudissements, il s’apprêta à conclure, livrant même une information que les Cubains auraient préféré voir restée secrète quelque temps encore : en supplément des opérations continentales, le PAIGC se préparait à lancer des opérations dans l’archipel du Cap-Vert, territoire cher à son cœur puisqu’il était celui de sa mère ! Pour preuve : « Pour cela, nous luttons déjà les armes à la main contre les forces colonialistes portugaises en Angola, en Guinée et au Mozambique, et nous nous préparons à faire de même au Cap-Vert, à São Tome et à Principe. Voilà pourquoi nous consacrons la plus grande attention au travail politique au sein de nos peuples, améliorant et renforçant chaque jour nos organisations nationales, à la direction desquelles sont représentés tous les secteurs de notre société. […]
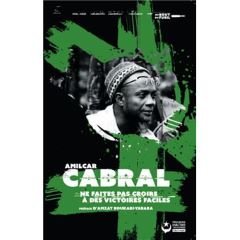
« C’est pour cela que nous sommes à Cuba, et que nous assistons à cette conférence. Nous ne lancerons pas de vivats, ni ne proclamerons ici notre solidarité avec tel ou tel peuple en lutte. Notre présence est un cri de condamnation de l’impérialisme et une preuve de solidarité avec tous les peuples qui veulent bannir de leur patrie le joug impérialiste, en particulier avec l’héroïque peuple du Viêt-Nam. Mais nous croyons fermement que la meilleure preuve que nous puissions donner de notre position anti-impérialiste et de notre active solidarité avec nos camarades dans cette lutte commune consiste à retourner dans nos pays, à développer encore davantage la lutte et à demeurer fidèles aux principes et aux objectifs de libération nationale. Nous souhaitons que chaque mouvement de libération nationale ici présent puisse, les armes à la main, répéter dans son pays, en union avec son peuple, le cri déjà légendaire de Cuba : “! Patria o muerte, venceremos !” Mort aux forces impérialistes ! Patrie libre, prospère et heureuse pour chacun de nos peuples ! Nous vaincrons ! ».
Sous les longs applaudissements de la salle debout, Amílcar Cabral était devenu la star du Habana Libre et de la conférence. Pedro Pires et ses camarades n’étaient pas les derniers à le penser. Wu Xueqian et Charaf Rachidov, aux applaudissements plus mous, le pensaient aussi. Et c’était leur problème. Le discours allait faire le tour du monde et devenir un texte sacré du tiers monde militant comme un an plus tôt le discours du Che à Alger ou celui que ce dernier comptait envoyer à la Tricontinentale, depuis son réduit africain.
Se rendant compte de l’aura dont bénéficiait Amílcar, démultipliée par le discours du 6 janvier 1966, l’état-major portugais décida d’intensifier ses opérations de ratissage. La police secrète PIDE tira de nouveaux plans sur la comète, à savoir assassiner l’homem grande. Et en attendant, en ce mois de janvier, le gouvernement portugais annonça qu’il venait de réaliser l’arrestation d’un grand nombre de partisans du PAIGC à Farim et dans toute cette région de Guinée-Bissau.
Un peu plus tard dans la journée, Osmany Cienfuegos fit à son tour une déclaration au nom de la délégation cubaine, insistant sur la nécessité de bâtir sur l’expérience des « peuples vainqueurs » et de construire une organisation tricontinentale permanente. Ce fut l’occasion de rappeler l’extraordinaire contribution de Mehdi Ben Barka à la mise en place de cette organisation et de vouer aux gémonies les services impérialistes qui l’avaient enlevé et « très certainement assassiné ». Amílcar Cabral ne pouvait qu’approuver cet hommage, tout comme il approuva peu après celui réservé à Che Guevara dans le discours de Turcios Lima expliquant, au nom des FAR guatémaltèques, la situation dans son pays et le soutien appuyé, ce qui était plus qu’un rituel chez lui, aux Vietnamiens.
S’il avait fallu classer les interventions en fonction de l’intensité et de la durée des applaudissements, celle de Turcios Lima n’était dépassée que par celle d’Amílcar Cabral. Aux yeux des militants, les deux guérilleros étaient des géants de ce monde en marche. Précisément, pendant un « entracte », Amílcar approcha Turcios Lima. Avec son habituelle franchise, il fixa le Guatémaltèque : « Une question me taraude, camarade : pourquoi n’y a-t-il pas d’Indiens dans ton armée ? Comme d’ailleurs dans presque aucune armée de libération latino ?
– Je les garde en réserve ! » répondit l’autre, impassible, sans qu’on sache s’il s’agissait ou non d’une boutade.
Les hommes qui les entouraient sourirent, Pedro Pires le premier. Mais la réplique n’était pas à la hauteur des enjeux. Les deux hommes pouvaient-ils deviner qu’il faudrait attendre encore quatre décennies avant que les descendants d’Incas et d’Aztèques fassent vraiment irruption dans la politique ? Comme les Africains s’éloignaient, Cabral confia à ses adjoints, Pires et Pedro Silva : « C’est leur faiblesse : voici cinq siècles que les Indiens sont colonisés, et ils le restent même une fois les Espagnols partis… » Cabral pensait naturellement à toutes les ethnies qu’il avait réunies en Guinée-Bissau, musulmanes ou animistes, dans le combat commun contre les Portugais. C’était sa force, d’autant plus remarquable que dans l’archipel du Cap-Vert, dont étaient originaires la plupart de ses délégués – et lui à moitié –, ce problème n’existait pas.
Tandis que les chefs, Amílcar et Turcios, s’étaient livrés à cette petite joute oratoire, deux membres de leur délégation respective s’étaient retrouvés pour la première fois depuis qu’ils s’étaient quittés à Paris. Un homme et une femme. Tous deux devaient subir un entraînement militaire en dehors de la Tricontinentale : Joaquim Pedro Silva, le Cap-Verdien du PAIGC, et Michèle Firk la Française, qui avait été recrutée pour combattre avec les FAR du Guatémala. Ils se firent face en silence un bon moment avant de se parler…