Dans « Ambatomanga », Michèle Rakotoson
raconte l’aberration de la guerre coloniale à Madagascar
par Kidi Bebey, publié par Le Monde, le 28 mai 2022.
Source
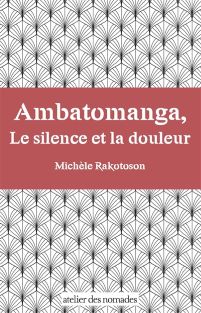
Ambatomanga, le Silence et la Douleur, de Michèle Rakotoson, éd. Atelier des nomades, 272 pages, 18 euros.
Tel un orage qui gronde, la guerre menace Madagascar. Nous sommes en octobre 1894. Dans sa logique de conquête coloniale, la France s’apprête à envahir la Grande Ile au nom de la mission qu’elle se donne « d’aider les pays arriérés à sortir de l’état sauvage dans lequel ils baignent tous et d’apporter la civilisation dans les terres lointaines », écrit la romancière Michèle Rakotoson.

L’angoisse monte du côté malgache. Les populations s’accrochent à l’autorité de leur reine, Razafindrahety, tout autant qu’elles veulent croire en la miséricorde de Dieu. C’est qu’un premier affrontement, en 1885, a marqué les esprits et battu en brèche la souveraineté nationale, laissant place à un protectorat de fait. La perspective d’un conflit encore plus définitif alimente tous les fantasmes : « Le Blanc, ses armes, sa puissance, son argent faisaient peur. Très peur. La terreur gagnait tout le monde. »
Dans la petite bourgade d’Ambatomanga, au centre du pays, une famille de notables retient son souffle. Le fils aîné va-t-il devoir partir au front ? Sa mobilisation entraînerait le départ comme aide de camp de Tavao, le domestique-esclave de la famille. Le premier devrait interrompre ses études de médecine pourtant brillamment entamées ; le second serait obligé d’abandonner son épouse sur le point d’accoucher.
Une vaste fresque
A Ambatomanga comme dans le reste du pays, personne ne veut imaginer le pire, mais les troupes malgaches sont si peu nombreuses, si mal équipées et entraînées que la perspective d’un retour des soldats sains et saufs est peu probable. De leur côté, les Français comptent bien imposer leur toute-puissance militaire.
Néanmoins, dans le secret de son cœur, le jeune officier Félicien Le Guen se laisse gagner par l’incertitude. Fort d’une expérience de six ans en Algérie, il pressent le risque d’enlisement sur ce nouveau théâtre d’opérations qu’il connaît mal. Mais en militaire de carrière, il tait ses doutes et exécute les ordres de sa hiérarchie, sans toutefois se faire d’illusion sur les pertes à venir. « Il sentit quelque chose se fermer, se blinder en lui, les émotions, les peurs, les terreurs qui se refoulaient au fond de lui, très loin. Il n’avait droit à rien de cela, il devait être aussi dur qu’une pierre. »
Pour narrer cet épisode tragique de l’histoire de son île natale, l’écrivaine et journaliste Michèle Rakotoson a mis en place une vaste fresque dans laquelle elle s’intéresse moins à la guerre qu’aux bouleversements sociaux, économiques et psychologiques qu’elle suscite. L’intrigue se déploie ainsi en lenteur et en longueur, avant l’éclatement final.
Le titre du livre, Ambatomanga, le Silence et la Douleur, l’annonce d’ailleurs clairement. Il ne s’agira pas de raconter l’événement « vu de haut », du côté par exemple de la capitale, Antananarivo, mais depuis le coin perdu d’Ambatomanga, à quelques encablures de là, et à partir du regard du plus insignifiant des protagonistes : Tavao, un esclave.
« Une invasion ne commençait-elle pas par la mort de soi en soi ? […] Les pensées allaient et venaient en lui, sans plus aucune logique, sans notion de temps. Tavao avait peur de les exprimer, se disait qu’il devenait fou. La machine de guerre était en marche, il fallait y faire face, ne pas céder à la panique. »
La peur et la peine
De même, on plonge avec la romancière au fond de la psyché de Félicien Le Guen, tout d’abord convaincu de la grandeur de sa mission, puis peu à peu conscient de l’erreur commise par sa lointaine hiérarchie parisienne : l’aberration de la guerre coloniale. « Les Malgaches n’avaient donc pas leur mot à dire. C’était la mainmise sur le pays. Comment supporter l’arrogance de ces conditions qui étaient autant d’ordres de soumission ? »
Durant neuf mois, dans un camp comme dans l’autre, les soldats se retrouvent confrontés tour à tour aux fortes chaleurs tropicales, aux déplacements laborieux dans des zones marécageuses infestées de moustiques. Ils subissent la famine, meurent de maladie avant même l’entrechoc des armes, et surtout se révèlent les otages d’une situation profondément absurde – qui n’est pas sans rappeler certains conflits actuels.
Roman de la peur et de la peine, écrit dans un style ample, précis et sensible, Ambatomanga est aussi un magnifique hommage de la grande dame des lettres malgaches à un peuple dont le reste du monde connaît trop mal l’histoire. Une parole donnée aux petits et aux vaincus, même si, on le comprend avec son livre, le bilan d’une guerre ne se compose que de perdants.
Entretien avec Michèle Rakotoson
« La colonisation, c’est voir l’autre comme
un outil de production à bas prix »
par Mabrouck Rachedi, publié par Jeune Afrique, le 10 juillet 2022.
Source
Dans Ambatomanga, Le silence et la douleur, l’écrivaine malgache raconte l’invasion de la Grande Île par l’armée de l’empire français. Un récit sans concession sur le système colonial.

Jeune Afrique : Vous écrivez : « Il y eut des centaines de morts. Dont on ne parla jamais. Tout le monde se tut. » Votre roman roman vise-t-il à réparer un trou dans la mémoire française ?
Michèle Rakotoson : Cette guerre coloniale n’est pas seulement un trou, elle est un véritable déni. L’histoire a été réécrite. C’est un long processus qui découle du système de traite des esclaves, désormais non rentable, et qui aboutit au système colonial, d’une complexité très fine. Historiquement, avant 1850, les colonies existent déjà : les « îles à sucre » pour les Français et les Anglais, le Canada, les Indes, etc. Puis il y eut les implantations coloniales : Algérie (1830), Afrique de l’Ouest (Sénégal, 1854), Cochinchine (1862), etc. Ensuite, les empires coloniaux (1880-1914) se construisent parallèlement au développement de la société industrielle occidentale qui se dit « moderne » et surtout universelle donc, légitime dans son désir de conquête et d’accaparement du monde. La « chasse aux colonies » s’accélère entre Français et Britanniques surtout, la conférence de Berlin détermine les zones d’influence en Afrique noire (1885). Cela ne s’est pas fait facilement, il fallait des justificatifs : idéologie du « sauvage », du « demi-sauvage », développement des sociétés, etc. À cela s’ajoutent le colorisme, des arguments pseudo-scientifiques, les systèmes d’exclusion, un racisme systémique, une « anthropologie » à la limite de l’exotisme et faisant fi des systèmes économiques mis en place, les cultes de l’authenticité, j’en passe et des meilleures… C’est dans ce contexte que se situe l’expédition coloniale à Madagascar en 1895.
Vous décrivez la longue attente de la guerre, que l’on perçoit à travers l’omniprésente rumeur. Pourquoi ce choix de ne pas montrer les choses frontalement ?
Si l’on ne voit que les batailles, on ne voit que par le petit bout de la lorgnette. Or, c’est un processus rodé de réduction de l’autre à n’être plus qu’un outil de production à bas prix. Aussi, au-delà de la polémique, ce qui est important, c’est de comprendre le mécanisme et de le démasquer. C’est dans cette problématique que j’ai construit le récit et mes personnages. C’est un phénomène d’invasion qui existe et est encore utilisé aujourd’hui.
Pourquoi avoir fait de Tavao, l’esclave, l’un des personnages principaux ?
Madagascar fut une plaque tournante de la traite vers l’océan Indien. Des Makoa et des Mozambiques ont été déportés des côtes est de l’Afrique vers les Mascareignes, des razzias ont eu lieu, phénomène qui a duré longtemps et qu’il ne faut pas confondre avec l’engagisme… Tavao fait partie de ces damnés de la terre. Et il faut une force extraordinaire pour s’en sortir. Je suis partie du modèle des noirs américains. Tavao est un beau personnage, résilient, qui revient de loin. Pour moi, c’est un symbole de ce que l’on devrait tous être pour nous en sortir : courageux et tenace, loin de tout « bling, bling ». J’en ai connu beaucoup, des sages comme lui, souvent des paysans très pauvres, qui avaient une force incroyable. Sans les Tavao, Madagascar n’aurait jamais eu ses rizières et il y a longtemps que nous aurions sombré dans la guerre civile, à cause d’une misère encore plus crasse.

Qui a raison : celui qui se bat ou celui qui s’éloigne du front ?
Il ne faut pas avoir une vision binaire de l’histoire… Tous sont pris dans les mailles d’une tragédie sur laquelle ils n’ont aucun pouvoir. Le XIXe siècle malgache est d’une pauvreté absolue : crise économique, dette de guerre, insécurité, guerre de territoire, impôts, obligation de construire des églises, la malaria qui fait des ravages… La population est écrasée. Que voulez-vous qu’elle fasse ? Aller se battre ? Avec quoi ? Le pays est en faillite, les armes et les munitions sont insuffisantes, il y a peu de nourriture. Du côté français, ce n’est pas mieux. Vous savez où avaient été stockés les médicaments ? Au fond des malles et il y avait des murs de malles. Pour toute nourriture, des conserves pourries… Mais je me demande si toutes les guerres ne sont pas ainsi. On chante des hymnes guerriers pour cacher l’horreur, pour envoyer les fils des autres se faire tuer. Ce sont souvent les plus pauvres qui servent de chair à canon.
On parle parfois de l’engagement des troupes coloniales lors des deux guerres mondiales mais peu dans les conflits coloniaux.
À ma connaissance, il y avait quelques soldats de métier, mais beaucoup étaient conscrits, avec un grand pourcentage de Somalis, de Tchadiens, de Zanzibarites. Mais si j’en crois des documents que j’ai pu lire, peu de Sénégalais, contrairement à ce que disent les légendes. En tout cas, ces jeunes soldats ont payé le prix fort, en termes de maladie et de fatigue.
À travers le regard du lieutenant français Félicien Le Guen, vous soulignez combien cette conquête est différente de celle de l’Algérie. Le bilan des morts au combat est très faible en comparaison du nombre de tués par les maladies. Le complexe de supériorité de la France a-t-il joué contre elle ?
Je parlerais plutôt du désir de revanche de certains officiers français car, auparavant, ils avaient pris une branlée, et pas seulement à Madagascar. En Algérie, il y a eu la résistance d’Abdelkader, entre autres. Si l’on en revient à cette expédition, il y a eu peu de morts du côté français, mais de très nombreux malades. Du côté malgache, le décompte n’est pas fait, mais il y en a eu sûrement plus : des femmes et des enfants esclaves qui suivaient les troupes pour l’entretien des effectifs, des morts dans les batailles. Et on est bien discret sur le fait que le jour de la reddition d’Antananarivo, des obus à la mélinite furent envoyés sur la foule qui s’était tassée à la porte du Palais de la Reine, comme sur des cités telle Maevatana, à l’entrée des Hauts Plateaux. Les civils ne furent pas comptés.
Vous parlez de l’utilisation d’obus à la mélinite. Y a-t-il une réparation possible contre ces crimes de guerre ?
Je ne sais pas, il faudrait y arriver. La mélinite a été utilisée à Madagascar, au Tonkin, autre autres, alors qu’elle est interdite en 1914-1918 sur les champs de bataille européens. Il faudrait monter le dossier, retrouver toutes les archives, trouver de bons juristes.
Vous rappelez le discours de Jules Ferry devant le Parlement, sur lequel s’est adossée la conquête de Madagascar. Que pensez-vous du débat sur le déboulonnage des statues qui rendent hommage à des personnages historiques liés à la colonisation ?

Il faut déboulonner les statues et changer les noms des rues. Cela a été fait à Madagascar, sauf pour quelques stèles. Mais il faut aller plus loin : revoir les termes de l’histoire, la rétablir.
Dans le prologue, vous invoquez une grande compassion. Pour tous. La compassion entraîne-t-elle le pardon ?
Pour moi, le terme compassion couvre les soldats entraînés dans une guerre qu’ils ne comprennent pas. Pas les donneurs d’ordres. De la compassion pour les victimes donc, une connaissance des faits, oui, une compréhension sûrement, tandis que les criminels doivent être châtiés, sans haine, sans règlements de comptes, mais châtiés.
Lire également sur histoirecoloniale.net :
Gallieni et la colonisation de Madagascar.
1895, Madagascar
L’hécatombe des petits soldats de France
par Alain Ruscio
Extrait de Alain Ruscio, Histoires ordinaires et extraordinaires du temps des colonies, Paris, Éditions Manifeste !, 2021
L’expédition de Madagascar, en 1895 – en réalité la seconde, car une première avait eu lieu en 1885 – a laissé dans l’histoire une trace particulière : elle fut pour les militaires qui y participèrent une épouvantable catastrophe, due à l’impréparation sanitaire des autorités.
Pour des organismes qui n’étaient absolument pas préparés au climat malgache, insuffisamment approvisionnés en quinine, le choc fut terrible. Une expression, devenue proverbiale, existait sur la Grande Île : nos meilleurs généraux contre les étrangers sont Hazo (la forêt) et Tazo (la fièvre)1. Le lobby favorable à la conquête, animé en particulier par les colons de La Réunion, aurait dû le savoir. Mais il vivait avec des idées définitives sur la question. Quarante ans plus tôt, dans un ouvrage appelant (déjà) à la colonisation immédiate de Madagascar, un auteur avait écarté d’un revers de la main l’argument du climat malsain : « Quoiqu’elles existent encore, le caractère des fièvres a beaucoup perdu de sa nocivité (…). Nous avons connu personnellement des gens qui séjournaient plusieurs mois de l’année sur les points les moins sains du littoral et qui n’ont jamais eu le moindre mal… » (Comte de Gaalon de Barzay, 1856)2 .
L’expédition commença dans l’enthousiasme, en cette période où le Parti colonial avait conquis la quasi totalité des esprits : « Il est temps que la France intervienne énergiquement ; 7.000 hommes de troupes, 50 à 60 millions de francs suffiront pour mettre les Hovas à la raison, II n’est pas probable que les Français rencontrent une résistance sérieuse. Madagascar supportera les frais de la campagne, même si l’expédition dépassait les prévisions. La France ferait une magnifique affaire, car Madagascar est le trésor et la perle de l’océan Indien »3.
Cette perle coûta fort cher en vies humaines françaises (nul alors ne comptait réellement les morts parmi les Malgaches). Certes, le pays sortait alors à peine d’une autre expédition, au Tonkin, où les fièvres avaient décimé les rangs. Décimé au sens propre : au pire moment, une épidémie de choléra faucha 96 p. 1.000 des soldats4.
Ce niveau de pertes, déjà exorbitant, fut plus que doublé lors de l’expédition de Madagascar : selon les chiffres officiels, sur un effectif de départ de 15.500 hommes, 5.756 perdirent la vie, soit près du tiers, dont seulement quelques dizaines tués au combat5. Il faudrait y ajouter les hommes décédés durant la traversée du retour, puis dans les hôpitaux de France. Et les milliers de porteurs et muletiers kabyles et d’Afrique de l’est, pour lesquels nulle comptabilité sérieuse ne fut menée. Il n’y avait pas assez de quinine pour la troupe. Alors, les indigènes… Il n’exista jamais, dans toute l’histoire coloniale française, de telle hécatombe.
- Dr Marius Cazeneuve, À la Cour de Madagascar. Magie et diplomatie, Paris, Libr. Charles Delagrave, 1896 (Gallica).
- La question de Madagascar après la question d’Orient, Paris, Amyot, Ed., Librairie historique, diplomatique et politique (Gallica
- Le Matin, 14 septembre 1894 (rapportant fièrement les propos d’un explorateur allemand).
- Dr Gustave Lagneau, « Mortalité des militaires français dans les colonies », Bull. de la Soc. d’Anthropologie de Paris, Vol. XII, n° 12, 1889 (Gallica)
- Léon Silbermann, Souvenirs de campagne, Paris, Plon, 1910. Ordre d’idées moins élevé (22 %) in Jacques Frémeaux, De quoi fut fait l’Empire. Les guerres coloniales au XIX è siècle, Paris, Ed. du CNRS, 2010.







