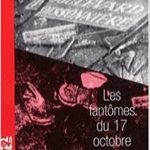Entretien avec Linda Amiri
par Jean-Lucien Sanchez, publié 28 avril 2020 Source
Criminocorpus, le Carnet de l’histoire de la justice, des crimes et des peines, développe sur son site une rubrique intitulée « Portrait du jour – Criminocorpus ». Elle a publié le 28 avril 2020 celui de Linda Amiri, historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Guyane et directrice de l’unité de recherche Migration Interculturalité et Éducation en Amazonie (MINEA, EA 7485). Philippe Poisson a demandé à Jean-Lucien Sanchez, chargé d’études en histoire Laboratoire de recherche et d’innovation – ministère de la Justice – Direction de l’administration pénitentiaire, de procéder à son interview. Jean-Lucien Sanchez est l’auteur de À perpétuité. Relégués au bagne de Guyane, éditions Vendémiaire, 2013.
Jean-Lucien Sanchez : Bonjour Linda, je te souhaite la bienvenue dans la rubrique « Portrait du jour » animée par Philippe Poisson dans le Carnet de recherche de Criminocorpus. Tu es historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Guyane et directrice de l’unité de recherche Migration Interculturalité et Éducation en Amazonie (MINEA, EA 7485). Tu as soutenu en 2013 une thèse de doctorat sous la direction de Serge Berstein et de Benjamin Stora à l’Institut d’études politiques de Paris intitulée La Fédération de France du Front de Libération Nationale (FLN), des origines à l’indépendance (1926-1962). Et tu es également l’auteure, entre autres, d’un ouvrage publié aux éditions Robert Laffont en 2004 intitulé La Bataille de France. La guerre d’Algérie en métropole, préfacé par Benjamin Stora. Pourrais-tu nous indiquer comment tu as procédé à la réalisation de ce travail ? Quels fonds d’archives as-tu consulté et quels témoins as-tu rencontré ? Et, plus particulièrement, pourquoi t’es-tu intéressée à cette thématique du FLN algérien ?
Linda Amiri : Ma famille est originaire de Bordj Bou Arreridj, une petite commune algérienne des Hauts Plateaux, bastion de la révolte d’El Mokrani en 1871. De la conquête à l’indépendance de l’Algérie, l’itinéraire de ma famille est intimement lié à celui de la paysannerie pauvre algérienne : propriétaires terriens, ils ont connu le choc de la colonisation et avec elle celui de la dépossession des terres et du déclassement social. En 1945, ma famille est composée de journaliers. Mon père a brièvement connu l’école indigène avant de travailler, à l’âge de 8 ans, pour une famille d’Européens dans une ferme de Ras el Oued, près de Sétif. Il fut berger, puis journalier, avant de prendre le chemin de l’exil en 1956. Il s’installe à Saint-Ouen où vivent déjà son oncle et quelques cousins, et travaille comme ouvrier dans le bâtiment… Il a ainsi participé à des chantiers rue Saint-Guillaume. Quelques décennies plus tard, j’ai fréquenté le même quartier, mais en tant qu’étudiante à Sciences Po Paris, l’émotion fut pour moi grande quand j’ai été admise dans cet établissement.
Je me suis intéressée à la guerre d’indépendance algérienne en 1997, lors du procès de Maurice Papon. Je commençais alors mes études d’histoire à Strasbourg. Je me souviens d’avoir pris une belle claque lorsque j’ai suivi ce procès car pour la première fois j’entendais parler du 17 octobre 1961, et pour la première fois je faisais le lien entre cette manifestation et les premières années d’exil de mon père (il a participé à cette manifestation).
(de g. à dr., Linda Amiri, Emmanuel Blanchard, Jean-Pierre Farkas et Gilles Manceron)
Deux ans plus tard, je suis partie faire ma licence à l’université du Québec à Montréal, où le politologue Sami Aoun m’a conseillé de prendre contact avec Benjamin Stora, pour mon projet de maîtrise1. Le 17 octobre 1961 a été la porte d’entrée par laquelle j’ai découvert véritablement l’histoire de la Fédération de France du Front de Libération nationale (FLN). Après ma maîtrise, j’ai donc voulu poursuivre mes recherches en intégrant le DEA Histoire du XXe siècle de Sciences Po Paris. Lors du grand oral, j’étais face à Serge Berstein, Marc Lazar et Jean-François Sirinelli, je dois dire que j’étais assez impressionnée d’être évaluée par ces historiens. Mon DEA a été encadré par Serge Berstein et Benjamin Stora, il portait sur la Préfecture de police de Paris et les Algériens de 1958 à 19622.
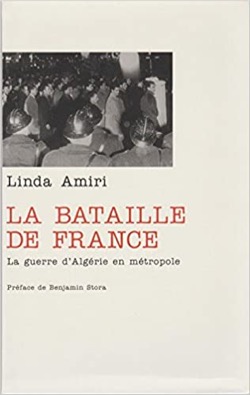 Ce fut pour moi la rencontre la plus importante de ma carrière, car sans le soutien de ces deux grands historiens, jamais je n’aurais pensé que moi, fille d’ouvrier algérien, je pouvais envisager une carrière universitaire. Ma maîtrise d’histoire, puis mon DEA ont effectivement été publiés, la thèse devrait suivre bientôt…
Ce fut pour moi la rencontre la plus importante de ma carrière, car sans le soutien de ces deux grands historiens, jamais je n’aurais pensé que moi, fille d’ouvrier algérien, je pouvais envisager une carrière universitaire. Ma maîtrise d’histoire, puis mon DEA ont effectivement été publiés, la thèse devrait suivre bientôt…
Pour cette dernière j’ai travaillé d’abord sur une multitude de fonds d’archives publiques et privées français et belges, puis je suis partie sept mois en Algérie. Je souhaitais compléter ce premier travail par une analyse des archives du FLN et du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). J’ai complété ces recherche par une enquête orale auprès des anciens cadres du FLN. Il était important pour moi de croiser mes sources, car on ne peut pas travailler sur une organisation clandestine indépendantiste exclusivement à partir des papiers de l’État colonial.
Pour financer cette thèse, j’ai bénéficié de l’aide de la Fondation des Treilles (Prix jeune chercheur 2007), puis j’ai exercé plusieurs métiers dans l’Éducation nationale, la recherche (INED), le monde associatif (Génériques, Institute for field education (IFE), Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale (FNARS).)
Sur la fin de ma thèse, j’ai été recrutée comme ATER à l’université de Strasbourg, ce qui m’a permis de mettre un pied à l’étrier. Si je devais conclure sur mon parcours de doctorante, je dirais que faire une thèse en Histoire est, pour paraphraser Bourdieu, un sport de combat, surtout lorsque l’on ne bénéficie pas de contrat doctoral. L’essentiel est d’avoir un sujet inédit et passionnant, c’est ce qui permet de rester motivé malgré les aléas.
J.-L. S. : Fait assez rare, tu as publié ton mémoire de maîtrise que tu as soutenu en 2001 à l’Université Paris VIII Saint-Denis sous le titre Les fantômes du 17 octobre 1961 (Éditions Mémoire-Génériques, 2003).  La répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961 demeure un évènement qui a longtemps été occulté dans la mémoire collective jusqu’à ce que le travail de l’historien Jean-Luc Einaudi la remette crument en lumière en 1991. Alors qu’elle s’est déroulée durant plusieurs jours, en plein cœur de Paris et qu’elle fut d’une violence extrême. Comment expliques-tu cette difficulté pour parvenir à accéder à cette histoire ? Est-elle le simple fait d’un oubli mémoriel ou bien ce déni traduit-il, plus largement, la difficulté que la France rencontre face au passé de la guerre d’Algérie et aux profonds traumas dont elle a frappé la société ?
La répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961 demeure un évènement qui a longtemps été occulté dans la mémoire collective jusqu’à ce que le travail de l’historien Jean-Luc Einaudi la remette crument en lumière en 1991. Alors qu’elle s’est déroulée durant plusieurs jours, en plein cœur de Paris et qu’elle fut d’une violence extrême. Comment expliques-tu cette difficulté pour parvenir à accéder à cette histoire ? Est-elle le simple fait d’un oubli mémoriel ou bien ce déni traduit-il, plus largement, la difficulté que la France rencontre face au passé de la guerre d’Algérie et aux profonds traumas dont elle a frappé la société ?
J’ai même eu les honneurs du journal Le Monde pour cette première publication ! La recherche de qualité nécessite du temps, du calme et de l’audace. Je n’aime pas m’engager sur une thématique de recherche sur laquelle des générations d’historiens ont déjà travaillé. J’ai bénéficié cependant pour ce sujet du courage d’un très grand monsieur, Jean-Luc Einaudi. Si à ses côtés, j’ai fait partie des premiers historiens à consulter les fonds de la Préfecture de police de Paris pour la période 1954-1962, c’est parce qu’il avait gagné son procès contre Maurice Papon et qu’il a milité, aux côtés d’autres personnes, pour l’ouverture des archives de la guerre d’Algérie.
Dès cette période, je ne voulais pas me contenter de travailler sur des archives policières, je voulais pouvoir croiser mes sources. J’ai donc contacté La CIMADE, c’est une organisation que je connaissais un peu : quand j’ai créé avec un ami l’ONG AMSED à Strasbourg, la CIMADE avait été la première association à nous soutenir, depuis je suis un peu une compagne de route de cette association. Au siège de la CIMADE à Paris, j’ai rencontré plusieurs anciens équipiers qui étaient en Algérie pendant la guerre d’indépendance, dont le regretté Jean Carbonare. Le fonds consulté était encore modeste, mais il permettait de saisir l’impact de la répression sur les Parisiens d’une part, d’autre part de mieux comprendre le rôle de la CIMADE dans la dénonciation de ce massacre colonial.
Parallèlement, sur les conseils de Benjamin Stora, j’avais écrit à Ali Haroun, l’un des anciens responsables de la Fédération de France du FLN. Un jour, lors de son passage à Paris, il m’a contacté en me disant qu’il avait quelques cartons à me confier. Aidée d’Adolfo Kaminsky3, j’ai pu consulter ce fonds d’archives exceptionnel. Il portait sur l’organisation de la manifestation du 17 octobre 1961 et sa violente répression, et ce du point de vue des militants et militantes de la Fédération de France du FLN.
Pour moi, il n’a donc pas été difficile d’accéder aux sources, bien sûr cela a nécessité du temps, du travail, de l’audace aussi… la période était favorable : non seulement les archives s’ouvraient, mais les témoins acceptaient enfin de parler. Il y a eu depuis d’importants travaux sur la question, et en particulier les travaux d’Emmanuel Blanchard, de Jim House et Neil Macmaster. Sans oublier le très beau documentaire de Yasmina Adi, Ici on noie les Algériens, et le web documentaire du collectif Raspouteam.
 Si la guerre d’indépendance algérienne est effectivement un « passé qui ne passe pas », les travaux des historiens français et étrangers n’ont jamais cessé. En 2012, j’étais commissaire de l’exposition, avec Benjamin Stora, Algériens en France 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie4. Cette exposition au musée national de l’histoire de l’immigration a rencontré un succès populaire indéniable, preuve s’il en faut encore, que la société française est prête à regarder en face la guerre qui fut menée en son nom en Algérie. Encore faut-il lui en donner les moyens, et cesser la désinformation menée par certains chroniqueurs de télé. L’histoire est une chose trop sérieuse pour la laisser aux idéologues.
Si la guerre d’indépendance algérienne est effectivement un « passé qui ne passe pas », les travaux des historiens français et étrangers n’ont jamais cessé. En 2012, j’étais commissaire de l’exposition, avec Benjamin Stora, Algériens en France 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie4. Cette exposition au musée national de l’histoire de l’immigration a rencontré un succès populaire indéniable, preuve s’il en faut encore, que la société française est prête à regarder en face la guerre qui fut menée en son nom en Algérie. Encore faut-il lui en donner les moyens, et cesser la désinformation menée par certains chroniqueurs de télé. L’histoire est une chose trop sérieuse pour la laisser aux idéologues.
Aujourd’hui, on ne peut pas dire que le 17 octobre 1961 fasse l’objet d’un « oubli mémoriel ». En revanche, la société dans laquelle nous vivons semble avoir une capacité terrible à ne pas retenir les leçons du passé. La semaine dernière à l’Île–Saint-Denis, des faits très graves se sont produits. La vidéo, relayée par le journaliste Taha Bouhafs, est particulièrement glaçante. Après que des policiers ont repêché et interpellé un homme qui s’était jeté dans la Seine “pour leur fuir”, on a assisté à une scène d’un racisme et d’une violence inouïs qui rappellent les violences policières qui ont eu lieu le 17 octobre 1961… L’IGPN a été saisie, il faut espérer que des sanctions exemplaires soient prises. Si la police française oublie ses valeurs, c’est la démocratie et l’idéal républicain qui vacillent.
J.-L. S. : Tu travailles désormais sur la thématique des forçats algériens incarcérés au bagne de Guyane et tu viens d’ailleurs de rédiger un article sur ce sujet publié dans le très intéressant volume « L’inévitable Prison » de la Revue du Maghreb, sous la direction de Marc André et de Susan Slyomovics. Dans cet article, tu mets bien en perspective le paradoxe qui anime la politique de colonisation pénitentiaire conduite par le ministère de la Marine et des Colonies à l’endroit des Algériens : celle de favoriser la colonisation de la Guyane par l’attribution de concessions agricoles à des Algériens qui se sont vus, pour beaucoup, dépossédés de leur propre terre sur leur territoire. 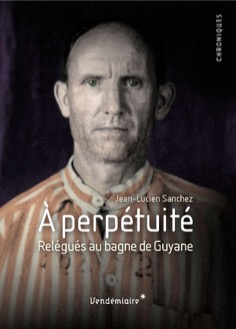 Comment expliques-tu cette situation ? Au regard de ton expérience sur le temps long de l’histoire algérienne, est-ce qu’il existe d’après toi une certaine continuité dans le traitement infligé aux transportés algériens à la fin du XIXe siècle avec celui infligé aux militants nationalistes algériens au XXe siècle ? Et, au-delà, que révèlent ces différents traitements sur la politique de contrôle colonial menée par la France à différentes époques de sa présence en Algérie ?
Comment expliques-tu cette situation ? Au regard de ton expérience sur le temps long de l’histoire algérienne, est-ce qu’il existe d’après toi une certaine continuité dans le traitement infligé aux transportés algériens à la fin du XIXe siècle avec celui infligé aux militants nationalistes algériens au XXe siècle ? Et, au-delà, que révèlent ces différents traitements sur la politique de contrôle colonial menée par la France à différentes époques de sa présence en Algérie ?
Je n’en suis qu’au début de mes recherches, il m’est donc très difficile de te répondre. Je ne peux qu’esquisser quelques pistes de réflexion, celles-là même que j’évoque dans cet article. Travailler sur ce que j’ai appelé la « période algérienne » des bagnes de Guyane (1867-1887) est intéressant à plus d’un titre. D’abord parce que cela permet d’éclairer d’un regard neuf à la fois l’histoire de l’archipel carcéral guyanais et celle de l’Algérie coloniale. Ensuite, parce que cela permet de replacer la Guyane dans l’échiquier de la politique coloniale de la France sous le Second Empire et la IIIe République.
Ce sujet offre la possibilité d’un renouvellement historiographique certain, à condition d’inclure la période 1830-1866 – et donc les bagnes portuaires et corses-, ainsi que les forçats de confession juive (le décret Crémieux n’a été pris qu’en 1870).
Enfin, pour comprendre s’il y a continuité ou rupture avec le traitement des indépendantistes de la seconde moitié du XXe siècle, il va me falloir consulter les dossiers judiciaires des transportés, retracer les réseaux des avocats qui ont défendu ces forçats, étudier le droit colonial et éplucher la presse de l’époque…
J.-L. S. : Quels sont tes futurs projets de recherche ?
D’abord, aller au bout de cette recherche ! Je vais poursuivre ce travail dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches (HDR). Parallèlement, je travaille sur la publication de ma thèse qui est attendue depuis trop longtemps, ainsi que sur un programme de recherche qui porte sur les impacts environnementaux du bagne. Nous aurons l’occasion d’en reparler très bientôt.
Accréditée en janvier 2017, l’unité de recherche 7485 MINEA décline ses travaux dans le cadre des thématiques prioritaires de l’Université de Guyane, telles qu’elles ont été formulées par l’École Doctorale (ED 587).
J.-L. S. : Enfin, ton arrivée en Guyane j’imagine confrontée à un climat, une histoire et une société que tu as plus ou moins dû découvrir. Pourrais-tu donc nous dire quelques mots sur ton expérience de ce territoire et sur le regard que tu portes à son histoire ?
Effectivement, mon arrivée en Guyane a marqué une certaine rupture dans mon travail et dans ma vie personnelle, mais une rupture positive. Je suis arrivée en Guyane pleine d’enthousiasme, je venais de décrocher le Graal : un poste de Maître de conférences ! Même si ma fiche de poste mentionnait que le « MCF recruté sera la cheville ouvrière de la licence d’histoire », je m’attendais quand même à travailler avec une équipe d’historiens, à pouvoir disposer de mon planning de cours dès mon arrivée… Bref à avoir un minimum de cadre pour cette mission… Il n’en fut rien, ce n’est pas la cheville ouvrière que je devais être, mais le chef de chantier ! Pendant trois ans, j’ai donc patiemment posé les jalons d’une filière très importante pour la jeunesse guyanaise. Nous avons la chance ici de travailler dans un cadre exceptionnel, avec des étudiant.e.s motivés et soucieux de réussir. Depuis décembre 2018, je dirige le laboratoire MINEA qui est un laboratoire pluridisciplinaire rassemblant le plus gros effectif de chercheurs en Guyane. Comme tu le vois, je n’ai pas chômé ces quatre dernières années, mais cela s’est fait au détriment de ma propre recherche. Maintenant que le job est fait, et bien fait, je peux enfin retourner à la recherche, et j’en suis très heureuse.
Quant à l’histoire de la Guyane, très sincèrement je ne cesse d’apprendre sur ce territoire.
La Guyane m’a offert la chance de vivre de ma passion, je ne peux que lui en être reconnaissante. Mais on l’oublie trop souvent, s’installer en Guyane c’est faire l’expérience de l’émigration, tant ce territoire est différent de la métropole et des Antilles. Il y a ici une richesse culturelle incroyable et une faune et une flore exceptionnelles. Au départ, le climat a été une épreuve : je n’aime ni la chaleur, ni l’humidité, un comble quand on vit en Guyane ! J’ai donc eu un peu de mal à m’acclimater et je sursaute encore lorsque je vois une bébête non identifiée, ce qui fait toujours rire mes amis. Ici, je réinvente mon métier d’historienne, dans le sens où mon éloignement géographique me permet de décentrer mon objet de recherche. J’écris d’ailleurs différemment sur l’Algérie depuis que je suis en Guyane, avec plus de maturité scientifique peut-être aussi.
- Publiée sous le titre, Les fantômes du 17 octobre 1961, préface de Benjamin Stora, Éditions Mémoire-Génériques, 2003.
- Publié sous le titre La Bataille de France, la guerre d’Algérie en métropole, préface de Benjamin Stora, Robert Laffont, 2004.
- Voir sur ce site
- Voir le catalogue dirigé par Benjamin Stora et Linda Amiri, Algériens en France 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie, Autrement-CNHI, 2012