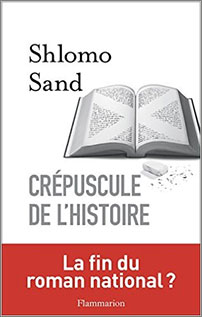
Professeur honoraire d’histoire contemporaine à l’université de Tel-Aviv, Shlomo Sand ne cesse d’interroger l’Histoire. C’est la fonction même de cette discipline, qu’il dénonce. Pour lui, l’Histoire a servi à la création d’un récit national, utile aux élites. Un mythe chaud qui n’aurait plus lieu d’être et qui empêche toute avancée ; comme en Israël où il fait croire que Hébron ou Jérusalem sont la patrie des juifs.
Shlomo Sand : « Quand je lis Finkielkraut ou Zemmour, leur lecture de l’Histoire, je suis effrayé »
- Votre dernier ouvrage s’intitule Crépuscule de l’Histoire [1]. Un titre qui fait peur. Il s’apparente à la fin de l’Histoire ?
Shlomo Sand : Je parle du métier. Il y a quelque chose, concernant le métier d’historien, qui est en train de changer. La discipline est en train de changer. Pendant des siècles, dans toutes les civilisations, l’Histoire avait pour tâche de fournir des modèles pour les élites politiques. L’Histoire était toujours écrite à côté de la force. Parce que ce ne sont pas les masses qui ont pu lire l’Histoire à travers les siècles. C’était une sorte de genre littéraire qui a fourni une certaine vision du monde pour les élites. Avec la naissance des États-nations au XIXe siècle, ce métier devient principal dans la pédagogie de l’État. Des écoles à l’université, on commence à apprendre l’Histoire. D’Augustin Thierry à travers Michelet jusqu’aux historiens du XXe siècle, Ernest Lavisse en tête, on a formé l’Histoire comme métier principal parallèlement aux métiers scientifiques. Ma question de départ est : pourquoi apprendre l’Histoire ? Pourquoi pense-t-on que c’est naturel ? J’ai donc analysé les développements de ce métier. L’ossature, les vibrations les plus importantes dans le métier étaient l’histoire nationale. C’est pour cela qu’elle est devenue non seulement une discipline universitaire comme la sociologie mais aussi un métier principal dans l’éducation. L’État-nation a construit des nations. Pour construire des nations, il faut plusieurs paramètres : une langue commune, un ennemi commun, mais aussi il faut une mémoire collective. C’est-à-dire ne pas penser que nous sommes un collectif seulement aujourd’hui, mais que cela a toujours existé. Pour le prouver, l’Histoire a été mise à contribution. On savait que le principe de base de ce métier était de former des nations. Il faut cela pour un passé commun, pour partir en guerre ensemble. Donner l’impression qu’on a toujours eu cette identité collective.
- Cela diffère-t-il selon les nations ?
Le mythe national, tel qu’il existe en France avec par exemple « nos ancêtres les Gaulois », n’est pas un mythe chaud. Il s’est refroidi. S’il ne faut pas tant étudier l’histoire nationale, qu’est-ce qu’il reste ? Faut-il étudier le colonialisme, le siècle des Lumières ? Enseigner plutôt l’histoire culturelle que politique ? Personne n’a la réponse. Le métier d’historien recule. Même Régis Debray a récemment écrit un livre de deuil en ce sens. Moi, je ne suis pas en deuil. Je ne suis pas contre l’Histoire. Je crois que l’Histoire peut jouer un rôle important dans la formation de l’esprit, mais peut-être une autre Histoire. Faut-il continuer à enseigner l’Histoire au lycée ? Oui, mais pas comme aujourd’hui. Il faut armer les élèves avec des métiers qui ne sont pas moins importants que la fonction de l’Histoire dans leur imaginaire et dans leur éducation. Par exemple, est-ce qu’apprendre la communication pour s’armer contre les médias dominants ce n’est pas une tâche principale de l’école et du lycée ? Est-ce qu’apprendre l’économie politique pour créer des salariés qui ont conscience de leurs intérêts n’est pas important ? On apprend le droit seulement à l’université, pourquoi pas à l’école et devenir un citoyen d’un autre type qui sait lutter pour les droits civiques ? Pourquoi l’Histoire est-elle obligatoire et pas l’économie politique ou la communication ? En France, on apprend un peu la philosophie. Mais c’est rare dans le monde. En Israël, par exemple, elle ne fait pas partie d’un corpus d’éducation des élèves. Mais si la philosophie apprend aux gens comment penser, l’Histoire leur enseigne quoi penser. Il faut donc commencer par « comment penser » dans toutes les écoles du monde. Mais je n’ai pas d’illusions. L’école moderne ne peut pas être son propre fossoyeur ! L’Histoire ne doit pas être plus importante. C’était un métier majeur pour la création des nations. Ce n’est plus le cas. Malheureusement la plupart des historiens ne sont pas de mon avis. Il faut enseigner l’Histoire avec le même état d’esprit que le tableau de Magritte où était inscrit « Ceci n’est pas une pipe ». On n’admet pas que la plupart des histoires de l’Histoire sont des mythes. Et pourtant… Ça va continuer. Il y a des mythes nouveaux sur le capitalisme. Quand je lis Finkielkraut ou Zemmour, leur lecture de l’Histoire, je suis effrayé. Avec l’Histoire on peut faire n’importe quoi. Or l’Histoire n’est pas la vérité. Ce ne sera jamais une pipe mais toujours le dessin d’une pipe. Et l’Histoire devrait être enseignée comme ça, de façon critique, en dévoilant le bagage idéologique que chacun possède. Moi, je ne l’ai jamais caché. C’est une partie de mon livre.
- Dans vos travaux, vous vous êtes attaqué à la théologie, puis au mythe chaud sioniste. Et cette fois ?
Je commence à décomposer le mythe d’une Europe qui commencerait avec Athènes et se termine avec Nadine Morano. Je ne rigole pas. Cette vision est fausse. J’ai une méthode qui s’apparente au matérialisme historique. Je montre que les bases du travail en Méditerranée étaient complètement différentes de celles de l’Europe. Le bagage scientifique gréco-romain, par exemple, est passé par les Arabes. Il y a mille ans d’écart entre la fin de la gloire gréco-romaine au Ve siècle et la naissance au XVe siècle de ce qu’on appelle la Renaissance ! Ce n’est qu’avec la conquête de Tolède et de Cordoue qu’on commence à injecter une partie de cette culture gréco-romaine en Europe. Donc il n’y a pas de continuité. Dans le deuxième chapitre, pour la première fois, je développe une critique très sévère en face de mes maîtres de l’École des Annales, qui m’ont permis d’avoir un autre rapport avec l’idéologie, la culture… Avec ce livre, je fais une sorte de bilan, plutôt négatif. Parce que je suis arrivé à la conclusion qu’une partie de la découverte de cette histoire culturelle était basée sur une fuite de la politique. Si presque toute l’Histoire, jusqu’à Voltaire, était histoire politique, de même qu’au XIXe siècle ce n’était pas le cas de l’École des Annales, née dans les années 1920 pour ne pas se confronter à l’histoire politique qui devenait une histoire de masse. Ce périodique qui s’appelait Annales, base de toutes les études historiographies dans les années 1950, 1960, 1970, ne proposait pas une page sur la Première Guerre mondiale. Vous imaginez un tel périodique qui ne se confronte pas avec la Grande Guerre, ni avec le taylorisme, ni avec les grèves de 1936, ni avec la guerre d’Espagne, ni avec l’antisémitisme, ni avec les massacres staliniens ? Je suis arrivé à Paris en 1975, comme étudiant. Quelques mois auparavant étaient publiés les trois grands livres de Jacques Le Goff et Pierre Nora, Faire de l’histoire. C’était le sommet de l’historiographie française. Aucun article sur Vichy, aucun article sur la guerre d’Algérie. Pourtant, pratiquement la même année, Joseph Losey réalise Monsieur Klein, sur la rafle du Vél’d’Hiv. Mais les historiens, eux, ne touchent pas à ça !
- Est-ce que cette problématique que vous soulevez touche les milieux des historiens partout dans le monde ? Est-ce qu’un débat existe auquel vous participez avec ce livre ou, au contraire, lancez-vous un débat ?
Je dis dans mon livre que je suis privilégié. Comme j’ai grandi ici, en Israël, où le mythe est chaud, j’ai eu l’avantage de pouvoir regarder de l’extérieur le mythe qui s’est refroidi en France. Les mythes nationaux ne se sont pas refroidis seulement en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Il y avait un groupe à la Sorbonne après 1945, composé de personnalités comme Albert Soboul, Georges Lefebvre, occupant une place hégémonique et proche des marxistes, qui se cristallise à cause des conditions de la Libération. À ce moment-là, Lucien Febvre, de l’École des Annales et fondateur de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), a reçu une forte somme de la Fondation Rockefeller. Dans le cadre de la guerre froide, il fallait arrêter le marxisme en Europe. Si les marxistes ou les ex-marxistes en Grande-Bretagne gardent une hégémonie dans l’Histoire, en France, Soboul et ses amis reculent devant la puissance de l’EHESS. Le phénomène des Annales, qui réunit beaucoup de gens intelligents comme Furet, Le Goff… fait l’histoire moins conflictuelle même si très matérialiste. Il y aura ainsi beaucoup de thèses sur la vie des paysans d’autrefois, beaucoup moins sur les luttes sociales. Si les historiens britanniques, à la même époque, publient de plus en plus de livres sur l’apparition de la classe ouvrière au XIXe siècle, il n’y a pas d’équivalent en France de cet élan d’analyses socio-économiques de formation des luttes sociales. Les historiens des Annales, qui deviennent hégémoniques, préfèrent le Moyen Âge et les luttes sociales deviennent mineures. Il n’y a pas non plus, en France, de livre comme celui de Howard Zinn aux États-Unis.
- L’Histoire s’écrit en permanence au Proche-Orient peut-être plus qu’ailleurs ? Comment les peuples écrivent cette histoire ici où se trouvent des Israéliens et des Palestiniens ?
Celui qui a traduit le livre Une histoire populaire américaine, de Howard Zinn, en hébreu l’a fait en prison parce qu’il avait refusé de partir à l’armée. Il a rencontré Zinn et lui a demandé s’il pensait qu’un tel livre pourrait être écrit en Israël. Zinn, juif américain, a répondu qu’il ne le pensait pas, parce qu’il n’y a pas de tradition universaliste en Israël. En France cela existe, c’est pour cela que je n’ai pas perdu espoir. L’affrontement entre de Gaulle le conservateur et Sartre l’universaliste a, par exemple, créé une possibilité de se détacher de cette guerre atroce en Algérie. Ici, il n’y a presque pas de tradition universaliste. Ceux qui s’en réclamaient sont partis. Il faut analyser la situation actuelle à partir de la colonisation sioniste qui a commencé au XIXe siècle. La colonisation ne s’est jamais arrêtée. Même entre 1949 et 1967. C’était une colonisation interne. Droite et gauche, sauf les communistes, ont accepté le slogan « Judaïser la Galilée ». C’est pour cela qu’aucun homme politique israélien ne fait une démarche sérieuse pour un compromis avec les Palestiniens. Je ne juge pas chaque phase de la colonisation moralement et politiquement au même niveau. Je reconnais les acquis du sionisme avec la création de l’État d’Israël (et non pas d’un État juif). Mais je reconnais les frontières de 1967. D’un côté il y a cette continuité, de l’autre, il y a mon jugement politique différent. Parce que je suis politiquement modéré. J’ai fait une erreur en soutenant les accords d’Oslo, pensant que c’était une ouverture. Tous mes amis gauchistes m’ont dit que c’était encore un leurre. Je me suis trompé. Parce qu’Oslo n’a pas amené la gauche à décoloniser. Parce que le mythe chaud en Israël fait croire que Hébron, Jérusalem, Jéricho sont la vraie patrie des juifs. Chaque élève en Israël, à partir de 7 ans jusqu’à 18 ans (il y a une matière au bac), apprend la Bible comme on apprend un livre d’Histoire. Pour créer un attachement à la terre mythique d’autrefois. Personne ne peut s’en libérer. Heureusement que j’ai été viré de l’école lorsque j’avais 16 ans. Peut-être que cela a contribué au fait que je puisse penser, parler. Et aussi parce que j’avais un père communiste. Mais aucun facteur n’est, en soi, suffisant. Pendant des années j’ai refusé la campagne Boycott-désinvestissement-sanctions (BDS). Mais aujourd’hui je pense qu’il n’y a aucune force politique capable de changer le cap, de changer cette radicalisation droitière et pseudo-religieuse de la société. J’accepte maintenant chaque pression sur l’État d’Israël, qu’elle soit diplomatique, politique, économique. Sauf la terreur. Si quelqu’un ne soutient pas le BDS aujourd’hui, il doit savoir qu’il aide à la continuation de ce désespoir tragique des Palestiniens qui, sans arme, résistent à ce statu quo.

