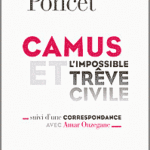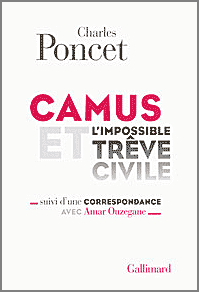
Charles Poncet, Camus et l’impossible trêve civile, suivi d’une correspondance avec Amar Ouzegane. Textes établis, annotés et commentés par Yvette Langrand, Christian Phéline et Agnès Spiquel-Courdille. Paris, Gallimard, 2015, 330 p.
Entamé au lendemain de la mort du Nobel, repris à la fin des années 1970, partiellement reproduit dans un magazine en 1990, ce témoignage suit de quelque 60 ans les événements auxquels il se rapporte. Jusque là réservé à une élite d’initiés, il profite de l’intérêt croissant du public pour une approche renouvelée de l’histoire de l’Algérie coloniale. Captivé par les feux de la guerre, l’horreur ou l’héroïsme qui les nourrissent, on ne voyait pas la minorité qui osa se placer entre ces deux feux, si ce n’est pour convenir de l’irréalisme et de la vanité de son action. Dans une pratique politisée de l’histoire, cette action a surtout le tort d’échapper aux dichotomies classiques entre gauche et droite. Or le propre de la question coloniale telle qu’elle se pose avec la prise d’Alger, est justement d’enjamber cette classification.
Ce n’est pas en effet en homme de gauche que Charles Poncet se positionne quand il décide d’aider son ami Camus à obtenir une « trêve civile » dans l’Algérie déchirée, mais en homme de bonne volonté. Et ce n’est pas à cause des réactions de haine des ultras ou des prétendues manipulations du FLN qu’avec ses camarades, l’écrivain algérois renonce à ce projet comme c’est souvent dit, mais à cause de la « trahison » de Guy Mollet et de son acolyte, Robert Lacoste, hommes de gauche.
La qualité supérieure de ce Camus méticuleusement éclairé et complété, est donc, au-delà de la politique, de faire parler par la plume de Poncet non pas un militant mais une conscience placée dans une situation charnière, et de nous aider à nous représenter – ce qui arrive rarement – un Camus non plus conscience comme nous en avons l’habitude, mais lancé dans l’action, c’est-à-dire dans le doute, la déception, la peur, l’audace, la décision… Il le fait avec délicatesse, mesure, distance et à travers ce témoignage dénué d’exaltation et d’aigreurs, c’est un Camus jamais aussi humain et réel qui transparaît.
Toutefois il manque de quoi donner chair à celui qui écrit. Ma critique est là : j’aurais aimé savoir en préalable qui parle et ce n’est qu’en recourant au Net que j’ai satisfait ma curiosité. Poncet, ai-je appris, de 4 ans l’aîné de son célère ami, n’appartient pas à une lignée pied-noire et n’est pas un intellectuel. Il est un employé cultivé, familier de la librairie Les Vraies richesses, établi en Algérie de 1920 à 1968, que Camus, de plus en plus éloigné de son pays natal, choisit pour être son informateur – ce qui suppose que les deux hommes se soient reconnu de fortes affinités. De même, ce qui m’a fait défaut en amorce du livre, c’est un condensé de l’appel qui en est au centre. Il n’est reproduit que loin, en annexe, là où sont confinées des contributions dont le caractère scientifique jure avec ce qui les précède. Ces annexes renseignent le débat mais ne l’élèvent pas.
Or ce débat, il faut le mener. Nous sommes bien d’accord : on ne peut pas refaire l’histoire, on peut seulement chercher à l’établir et à la comprendre. L’Algérie, en l’occurrence, s’est faite autrement que l’avaient désiré et prévu ses inventeurs puis ses exploiteurs. N’en déplaise aux fous qui n’ont d’autre mérite à faire valoir que d’avoir jeté l’huile sur le feu et auxquels d’autres fous veulent maintenant élever des monuments, l’Algérie ne sera plus jamais française. C’est plutôt vers toujours plus d’indépendance que ce pays, qui paradoxalement, a gardé le nom donné par le colonisateur, évoluera.
Ce débat porte justement sur les moyens de cette indépendance. Camus refusait qu’elle fût entière et prônait, illustration de la « 3e voie », une solution fédéraliste. Au lieu de la guerre totale qu’il redoutait, il en appelait à des négociations en faveur de cette solution et fondait ses espoirs en 1955 sur l’intervention déterminante de Pierre Mendès France. Son but était que, dans tous les cas de figure, le maintien de ses « nôtres » en Algérie fût garanti. Il ne cessait de penser à sa mère, et à Lucien, ce frère, dans sa littérature aussi fantomatique que « l’Arabe ». Mais comment dénommer mère, frère, et compatriotes et de quelle patrie ? Comment appeler les autres de cette majorité minoritaire, immense majorité scandaleusement minoritaire ? Camus s’engouffrant à nouveau dans « la forme la plus agréable de l’engagement » que représentait à ses yeux le journalisme, tente à l’Express de promouvoir sa solution. Il a pris langue à Alger avec ses homologues « libéraux » dans cette perspective. Son but avoué est de mener un « travail de désintoxication » des esprits et de désarmement du « nihilisme ». Dans ce travail, le choix des mots est crucial. Pour peser sur la situation, ils doivent être soigneusement pesés. L’écrivain en prend argument pour refuser d’improviser lors de la réunion publique du 22 janvier 1956 à Alger. Les mots de son Appel et de ses articles dans le quotidien mendèsiste qu’il va réunir 2 ans plus tard dans Actuelles III, sont donc mûrement choisis. Or jugeons de leur embarras. Pour qualifier les uns et les autres, l’auteur utilise indifféremment, « peuples », « peuplements », « populations », « communautés » ; pour les uns : « Français », « Européens » ; pour les autres : « Arabes », « musulmans ». Que « le peuple français et le peuple arabe unissent leurs différences » exhorte-t-il dans l’avant-propos de ses Chroniques algériennes. Tant d’approximation signale un « malaise » qui n’est pas seulement affectif et personnel comme l’écrivain l’avoue à son ami Poncet.
Le nombre et l’ancienneté d’implantation suffisent-il à constituer un « peuple » comme, parlant des « Français d’Algérie », il l’affirme le 17 janvier 1956 ? Croit-il sincèrement que jamais pays puisse naître du mariage d’une nation et d’une religion comme son Algérie « franco-musulmane » y invite ? Prenons au mot l’Appel lui-même qui, au nom de l’amour pour « une terre commune » et d’un « devoir d’humanité », ne retient que la notion de « civils innocents ». Dans une guerre civile, les belligérants sont des civils en armes. Quand les camps se sont formés, même inactif par choix ou par incapacité, quiconque se trouve assimilé à un camp et porte la responsabilité collective de ses actes – une « solidarité » que Camus a longuement analysée. Il n’y a pas de civils ni d’innocents qui tiennent dans le champ de la terreur, ni de droit humanitaire, l’Appel le reconnaît in fine : il n’y a que la conception de ce qu’est et doit faire un « homme libre ». L’auteur le déclare dans une dernière phrase, la liberté exclut toute forme de terrorisme. Elle exclut également, je l’ajoute, toute forme d’« enracinement ». Terrorisme, « aveugle » ou d’Etat… et enracinement, dans une terre, un culte… sont encore au cœur de l’actualité la plus douloureuse.
Si nous éprouvons tant de difficulté à l’interpréter, c’est peut-être que nous sommes passés à côté de l’histoire réelle de ce proche passé ? Camus, peu avant de décider le silence en désespoir de cause, écœuré par les palinodies et l’hypocrisie de Mollet, humilié de sa propre impuissance, constatait que la crise algérienne obligeait sa génération « à mesurer la décadence des formules politiques » sur laquelle elle vivait. Il prévenait qu’en cas d’échec d’une 3e voie : « il nous faudrait alors, devant le constat de notre impuissance, procéder à une révision totale de nos engagements et de nos doctrines dans une histoire qui pour nous aurait changé de sens ». (Le Parti de la trêve dans l’Express du 17 janvier 1956). Les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher n’en témoignent-ils pas ?
L’auteur de la précédente notice vous invite à participer à la première édition de FAITES DE LA PHILO dans la vallée du Toulourenc, consacrée à Camus. Cette manifestation aura lieu le dimanche 5 juillet 2015, de 16h à minuit et plus, dans le lieu exceptionnel de la Ferme St Agricol à 84390 Savoillans.
« Nous posant avec Camus la question du sens de l’existence humaine, nous avons voulu engager la réflexion aussi simplement, aussi naturellement que Camus l’eût souhaité, non pas à travers l’étude de ses textes proprement philosophiques mais à partir du vécu que l’écrivain nous livre dans son récit posthume Le premier homme qui sera au cœur de l’évocation.»
Pour tout renseignement :">