Monique Chemillier-Gendreau est professeur émérite à l’Université Paris-Cité, spécialiste du droit international et de la théorie de l’Etat et conseillère devant les juridictions internationales. Elle nous fournit ici une précieuse synthèse sur la question palestinienne dans le droit international. Constatant « l’ineffectivité » manifeste depuis des décennies de ce dernier lorsqu’il s’agit de la Palestine, elle en analyse les causes et se demande « si l’on peut encore aujourd’hui espérer quelque chose du droit international sur ce dossier. »
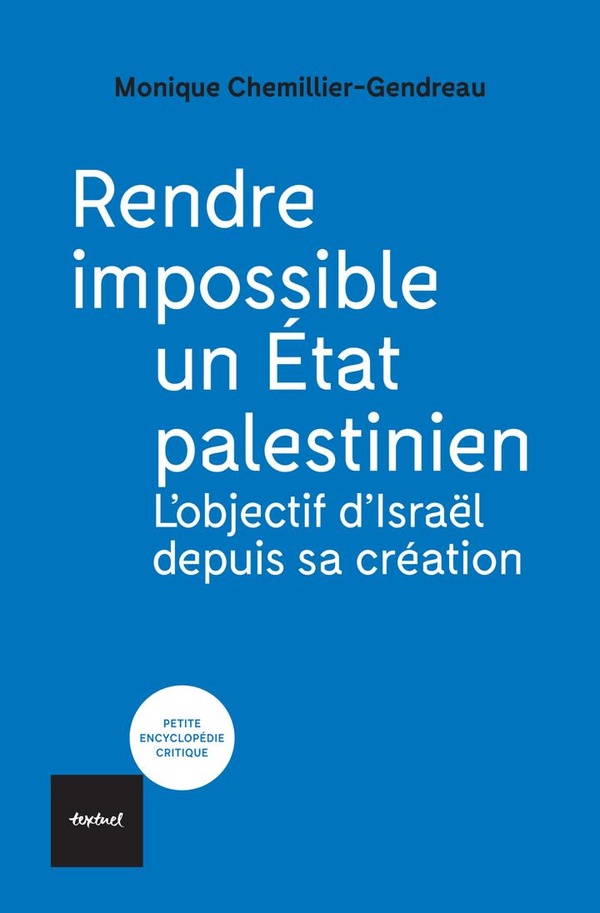
Livre publié en mai 2025
L’effectivité du droit international et la question de Palestine
La permanence de la question palestinienne sur l’échiquier international témoigne depuis des années de l’échec du droit international. La guerre ouverte à Gaza par Israël en réponse aux attentats criminels menés par le Hamas le 7 octobre 2023 transforme cet échec en tragédie. Cette tragédie se poursuit depuis plus de deux ans. Les violences s’accroissent contre la population gazaouie. L’actuel Premier ministre israélien et ses ministres extrémistes intensifient cette guerre jusqu’à la destruction totale et le nettoyage ethnique de la Bande de Gaza. Ils accélèrent parallèlement la colonisation en Cisjordanie.
Enfin les organisations internationales ou régionales, ainsi que les États, ne prennent aucune mesure de nature à mettre un terme à cette tragédie et à rétablir les droits des Palestiniens. Ce tableau confirme l’effondrement du droit international et le moment crépusculaire dans lequel sont entrées les organisations internationales créées pour garantir l’application de ce droit.
Pour tenter d’analyser cette situation, je vais recenser le corpus du droit international relatif à ce conflit. Je mettrai en lumière les ambivalences dont ce droit a souvent été assorti, ce qui a permis qu’il soit dévoyé ou manipulé lorsqu’il n’était pas tout simplement violé. Enfin, je me demanderai si l’on peut encore aujourd’hui espérer quelque chose du droit international sur ce dossier.
I – L’ineffectivité du droit international dans le conflit israélo-palestinien.
Cette ineffectivité doit être analysée en remontant à la source de ce conflit.
A – Le Pacte de la SDN et le Mandat britannique sur la Palestine.
On ne peut pas comprendre le conflit israélo-palestinien actuel si on ne le situe pas sur le temps long en remontant à l’instauration du Mandat britannique sur la Palestine. Jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale, la Palestine se trouvait sous domination ottomane. Les États alors vaincus, notamment l’Allemagne et l’Empire Ottoman se sont vus dépouillés de leurs colonies au profit des vainqueurs. Sous l’influence du Président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson et du principe alors naissant du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on instaure une nouvelle administration des territoires confisqués à l’Empire Ottoman, ces mandats attribués à des États vainqueurs. Mais on affirme alors qu’à terme ces territoires seront reconnus comme « nations indépendantes »[1]. Et les autres mandats du même type que celui sur la Palestine, ceux sur la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l’Irak, donneront naissance dès la fin de la Seconde guerre mondiale à des États souverains.
La Palestine n’a pas bénéficié de cette promesse car le Gouvernement britannique a obtenu que soit introduite dans le Mandat la Déclaration Balfour de 1917 par laquelle il s’engageait à reconnaître et favoriser en Palestine l’établissement d’un foyer national juif. Cette expression qui n’a aucune portée juridique, a été interprétée par le mouvement sioniste (et avec la complicité de fait des Britanniques) comme la promesse d’un État juif en Palestine.
Parallèlement, les droits nationaux des Arabes de Palestine pourtant reconnus à l’article 22, par. 4 du Pacte de la SDN, n’étaient plus mentionnés dans la Déclaration. Elle disait seulement : « …. rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des communautés non juives existant en Palestine ». Le peuple palestinien, présent sur cette terre depuis des siècles, était désigné comme : « communautés non juives ». Et il n’est question que de leurs droits civils et religieux, sans mention de leurs droits politiques pourtant affirmés dans le Pacte.
Là est la naissance du conflit. Les Britanniques, avec l’aval de la Société des Nations, promettaient la même terre à deux peuples.
B – Le droit des Nations Unies contenu dans la Charte elle-même et dans les résolutions de ses organes.
En 1947, la Grande Bretagne incapable de maîtriser la situation en Palestine met fin à son Mandat et transfert le dossier aux Nations Unies.
1) La création des deux États.
La Charte ne consacre pas le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle le mentionne dans les buts des Nations Unies (article 1, par. 2), mais il n’y a pas de mise en œuvre pour tous les territoires colonisés. Il n’y a qu’un chapitre (XI) intitulé : « Déclaration relative aux Territoires non-autonomes » dans lequel il est seulement dit que ces territoires sont « administrés dans l’intérêt des populations ».
Lorsque les Britanniques remettent leur mandat aux Nations Unies, l’implantation d’une importante population juive en Palestine est alors un fait accompli. Elle est fortement organisée et considérablement armée. La promesse du Pacte de la SDN à l’égard du peuple arabe de Palestine est oubliée ou plutôt amputée. La prise en compte de la réalité sur le terrain l’emporte à une courte majorité à partir du plan de partage recommandé par l’Assemblée générale. Ce partage était concrétisé par une frontière attribuant à Israël 14.100 Km2 du territoire mandataire et à l’État arabe 11.500 km2 du même territoire. Jérusalem était exclu de ce partage et soumise à un statut spécial permettant la protection et la liberté d’accès aux Lieux saints.
L’Assemblée générale ne disposait pas du pouvoir de créer deux États. Aussi se contente-t-elle de proposer sous la forme d’une recommandation, c’est-à-dire d’un texte non contraignant, le plan de partage en recommandant : « Que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ». Mais le Conseil de sécurité ne prit aucune résolution donnant force obligatoire à ce partage.
Il résulte de cet état de fait que juridiquement, la recommandation de l’Assemblée générale ne pouvait donner naissance à une obligation de la respecter de la part des deux peuples concernés que si l’un et l’autre, acceptaient ce partage. Ce ne fut pas le cas. Les Juifs l’acceptèrent tout d’abord car cela validait le passage de cet objet indéterminé qu’était le Foyer national juif, à un État au sens juridique du terme. Mais la suite des évènements montra leur volonté de ne pas s’en tenir au territoire que leur allouait cette résolution. Les Palestiniens le rejetèrent avec l’appui des États arabes déjà membres des Nations Unies. Et par un paradoxe comme l’histoire en présente parfois, ce sont les Palestiniens qui en 1988, ont invoqué la résolution 181 dans leur Déclaration d’indépendance où l’on peut lire que :
« c’est cette résolution qui assure, aujourd’hui encore, les conditions de légitimité internationale qui garantissent également le droit du peuple arabe palestinien à la souveraineté et à l’indépendance ».
On ne peut pas dire pour autant que la résolution 181 soit la base juridique de la création des deux États. Car il faut comprendre que le droit international n’est pas un droit centralisé. Il est à géométrie variable selon les engagements des différents États. Cela a pour conséquence qu’un État n’a d’existence que pour ceux parmi les autres États qui l’ont reconnu. Tout État souhaite donc être reconnu par le plus grand nombre des autres États. Cela explique l’importance aux yeux d’Israël de ce que l’on a nommé les Accords d’Abraham. Ces accords déjà conclus par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan mettent fin à l’engagement pris par les États arabes lors de la création d’Israël à ne pas reconnaître cet État tant que la paix ne serait pas effective avec la Palestine. Le génocide en cours à Gaza a stoppé ce mouvement. Quant à la Palestine, ses représentants se sont proclamés État en 1988 et depuis le mouvement de reconnaissances a conduit aux dernières décisions d’États occidentaux qui n’avaient pas encore franchi le pas et on en est aujourd’hui à 158 sur 193.
2) L’interdiction du recours à la force.
Mais la Charte des Nations unies, à défaut d’être claire sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’était dès l’origine sur l’interdiction de recourir à la force contenue dans l’article 2, para. 4. avec une seule exception, le droit de légitime défense tel que défini à l’article 51. Et cette interdiction était assortie d’une compétence spéciale accordée au Conseil de sécurité pour la faire respecter. Celui-ci a le monopole de la décision en matière de sanctions, notamment militaires, mais toute décision de cet organe est conditionnée à l’accord des 5 membres permanents. Israël a violé de multiples fois l’interdiction de recourir à la force, mais n’a jamais été sanctionné grâce au veto de son allié américain. Et Israël a toujours systématiquement invoqué le droit de légitime défense.
Dès 1948, les forces militaires sionistes multiplient les attaques et contrôlent alors non seulement la partie de la Palestine allouée par la résolution 181 à l’État juif, mais une partie du territoire attribué à un État arabe. Le Conseil de sécurité demande simplement à être tenu informé[2].
En avril 1948, Israël développe le plan Daleth à l’aide d’une milice israélienne, la Haganah, forte de 35 000 hommes pour conquérir la partie palestinienne du territoire et expulser le maximum de Palestiniens aussi bien des zones attribuées à Israël que de celles réservées à un État arabe. Commencent alors les massacres et expulsions que les Palestiniens appellent la Nakba. Et le lendemain de la Déclaration d’indépendance d’Israël, les armées de six États arabes interviennent en Palestine où les combats feront rage pendant plusieurs semaines, laissant finalement l’avantage militaire à Israël.
Le Conseil de sécurité se contente d’appels à la trêve, puis en appelle à un armistice. Mais ces résolutions n’ont pas d’effet jusqu’en novembre 1948, où intervient le cessez-le-feu avec la Transjordanie en même temps que le partage de Jérusalem dont la partie Ouest tombe sous le contrôle d’Israël. Des conventions d’armistice interviendront entre Israël et les différents États arabes en 1949. Bien que réservant pour plus tard le règlement territorial du conflit, elles entérinent de fait les conquêtes d’Israël (1/3 du territoire attribué par la résolution 181 à la Palestine).
Ces conquêtes, à l’évidence illégales entraîneront des actions armées de petits groupes de Palestiniens, puis la décision du Fatah créé en 1959 d’entrer dans la lutte armée. Cette première guerre avait eu pour conséquence une expulsion massive des Palestiniens (800 000 à 900 000 selon l’UNWRA) après des massacres voulus comme exemplaires et des confiscations de terres palestiniennes à une grande échelle. Mais rien de tout cela n’a fait l’objet de condamnation ni de sanction d’Israël de la part du Conseil de sécurité. Israël est même admis aux Nations Unies par la résolution 69 du Conseil de sécurité en date du 4 mars 1949. De son côté, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte le 11 décembre 1948 la résolution 194 par laquelle elle consacre le droit au retour au profit des Palestiniens exilés[3]. Les États arabes ont exigé alors d’Israël son retrait à l’intérieur des limites fixées par la résolution 181, mais le Conseil de sécurité n’a pas exercé sa fonction de gardien de la paix malgré les violations massives de la Charte commises par Israël. C’est le début de la longue histoire d’incohérences des Nations Unies sur ce dossier.
Israël se livre à une nouvelle violation de l’interdiction de recourir à la force en 1967. En réponse à l’annonce par Nasser qu’il pourrait fermer le détroit de Tiran, Israël déclenche le 5 juin 1967 la Guerre dite des Six Jours. La Bande de Gaza et la péninsule du Sinaï sont prises à l’Égypte, le plateau du Golan à la Syrie, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie. Le Conseil de sécurité demande d’abord un cessez-le-feu, puis vote la résolution 242 du 22 novembre 1967. Par là il condamne l’acquisition de territoires par la guerre et demande le retrait par Israël des territoires alors occupés. Israël n’en n’a cure. Mais la résolution n’était pas fondée sur le chapitre VII de la Charte et la menace contre la paix n’était pas constatée et le Conseil ne prit aucune sanction. Lorsque l’Égypte et la Syrie déclenchent en 1973, la Guerre du Kippour, le Conseil se contente de demander un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté et de créer une Force d’urgence.
Par la suite, le Conseil condamne les provocations d’Israël ou les massacres comme celui d’Hébron en 1994[4]. Il condamne aussi la colonisation de la Palestine dans laquelle Israël s’est engagé, ainsi que la politique d’Israël à Jérusalem, notamment dans la résolution 2334 de 2016[5]. Mais Israël ignore ces condamnations sans que le Conseil ne décide de sanctions. Il faut noter que lorsque des résolutions sont adoptées, c’est parce que les États-Unis, membre permanent doté du droit de veto choisissent l’abstention. Bien d’autres projets de résolutions furent entravés par l’exercice du veto américain.
Le Conseil de sécurité n’intervient pas davantage en ce qui concerne Gaza. La guerre totale ouverte par les attentats du Hamas du 7 octobre 2023 n’a pas été la première. L’ont précédé l’opération Plomb durci de décembre 2008 à janvier 2009, puis celle Pilier de la défense en 2012. Deux ans plus tard l’opération Bordure protectrice de juillet à août 2014 est la plus meurtrière avec 1500 morts civils et 12 000 blessés palestiniens[6]. Et depuis octobre 2023, la guerre dénommée « déluge d’Al Aqsa » se donne pour objectif la destruction totale de ce territoire et l’expulsion de tous ses habitants. Le Conseil de sécurité a parfois, lorsque les États -Unis se sont abstenus, appelé à un cessez-le-feu mais sans conséquence quant à son non-respect[7].
L’argument de la légitime défense et de la sécurité d’Israël est continuellement avancé pour justifier l’emploi de la force contre les Palestiniens. Pourtant la sécurité des Palestiniens est infiniment plus menacée que celle des Israéliens. Ils sont en situation d’insécurité maximale, pas seulement à Gaza où ils meurent sous les bombes ou par famine organisée, mais aussi en Cisjordanie où les attaques des colons, protégés par l’armée israélienne, se multiplient.
Cet argument de la légitime défense mérite d’être clarifié. Il est constamment invoqué par Israël et souvent sous la forme de la légitime défense préventive. Mais selon le droit international, la légitime défense ne peut jamais être préventive car elle doit pour être « légitime », répondre à une attaque armée effective et non pas supposée. Et elle ne peut être que de courte durée car le Conseil de sécurité doit être immédiatement saisi pour décider des suites à donner à la situation. Et en tous les cas, elle doit être proportionnée. Manquant à toutes ces conditions, la légitime défense invoquée par Israël n’a jamais eu de fondement légal.
Le seul cas qui mérite d’être examiné de plus près est celui des attentats du 7 octobre car la sécurité des Israéliens a été gravement atteinte ce jour-là. Mais il faut pour évaluer la réponse israélienne, s’interroger sur la qualification juridique de ces attaques et ensuite sur la légalité de la réponse apportée par Israël. Les attentats du 7 octobre pouvaient-ils être considérés comme l’exercice par le peuple palestinien de son droit à lutter par tous les moyens contre la domination coloniale ? Nous savons que l’Assemblée générale des Nations unies a admis que la lutte des peuples colonisés puisse être exercée par « tous les moyens nécessaires » (résolution de l’AGNU 2621 de 1970), ce qui inclut la lutte armée. Toutefois cette lutte reste encadrée par le droit humanitaire, ce qui interdit l’attaque de civils. Si le Hamas n’avait attaqué que des postes militaires et n’avait fait prisonniers que les militaires, l’argument aurait été valable. Mais cela n’a pas été le cas. Le grand nombre de civils tués et les prises d’otages de civils détenus depuis deux ans, font de ces attaques une série de crimes internationaux qui devront être jugés un jour et sanctionnés. Ainsi le veut le principe d’objectivité du droit car à ne pas l’observer il est déconsidéré.
Il en résulte que l’argument de la légitime défense peut ici être invoqué, contrairement à bien d’autres situations où il a été mis en avant par Israël sans fondement. Toutefois, cette invocation se heurte à deux arguments : Israël a ouvert une guerre génocidaire qui dure depuis deux ans et qui est totalement contraire au principe de la proportionnalité qui commande la légitime défense. Et elle n’a pas saisi dans les heures ou les jours qui ont suivi le Conseil de sécurité comme l’exige le droit de la légitime défense.
Israël ne s’est jamais plié à l’exigence d’objectivité du droit international. Celui-ci, comme tous les droits, se donne pour but de mettre en place des procédures qui permettront de ne pas laisser les points de vue subjectifs des protagonistes d’un conflit se laisser libre cours. Par un recours à des tiers qui sont supposés impartiaux, un espace d’objectivité est créé qui permet une solution du conflit rendue publique et motivée par ses auteurs. Israël s’est toujours considéré comme au-dessus du droit commun puisqu’il fonde ses droits sur des textes religieux. Et le Conseil de sécurité qui détient le rôle d’arbitre, c’est-à-dire de faiseur d’objectivité, est disqualifié par sa partialité.
3) L’émergence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le droit des Nations Unies.
Je rappelle que c’est l’action de certains peuples colonisés dont plusieurs s’étaient engagés dans la lutte armée (peuple vietnamien, algérien, peuples des colonies portugaises) qui a conduit les Nations Unies, non pas à travers le Conseil de sécurité dominé par les puissances coloniales, mais par l’action de de l’Assemblée générale, à construire dans les années 60 et 70, un véritable droit de la décolonisation. Les résolutions les plus importantes étant la 1514 de 1960 et la 2625 de 1970. Alors est consacré le droit pour un peuple soumis à une domination coloniale de recouvrer son indépendance. Il peut le faire par tous les moyens nécessaires. Le peuple concerné doit accéder à l’indépendance dans l’intégrité de son territoire et avec le plein accès à toutes ses ressources naturelles.
C’est l’application de ces principes au peuple palestinien qui a été rappelée précisément par la Cour internationale de justice dans son avis du 19 juillet 2024 avec l’indication de nombreuses mesures s’imposant tant à Israël qu’aux autres États et à l’Organisation des Nations Unies. Rien de cela n’a été appliqué. Pourtant l’Assemblée générale dans sa résolution du 18 septembre 2024, adoptée en application de l’avis rendu par la Cour, deux mois plus tôt, a exigé d’Israël de ne pas entraver « …. l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé. ». On sait ce qu’il en est de la réponse d’Israël.
C – Le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire en cas de conflit armé
Le comportement d’Israël dans les territoires occupés depuis 1967 est l’histoire d’une longue et intense violation des droits de l’homme des Palestiniens. Israël pratique à leur égard une discrimination systémique qui a fait l’objet de résolutions du Conseil des droits de l’homme. Mais celles-ci n’étant pas contraignantes, elles n’ont eu aucun effet.
La CIJ dans son avis de 2024 examine successivement la question des permis de résidence, les restrictions à la liberté de circulation, la démolition des biens. Et elle en conclut à une situation d’apartheid. Mais pas plus que les autres dispositions de cet avis ou que les conclusions qu’en a tirées l’Assemblée générale, cette affirmation n’a été suivie de sanctions.
Il y a, et nous devons nous en féliciter de nombreuses procédures nationales menées par des associations (entre autres : JURDI[8] : recours en carence contre l’Union Européenne devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, recours contre la France, et recours de l’AFPS[9], devant les juridictions françaises contre des personnes physiques ou morales binationales pour des crimes liés à la colonisation en Palestine). Mais aucune procédure internationale n’a été engagée contre Israël à ce propos.
Nous retrouvons la même impunité d’Israël à propos du droit humanitaire en cas de conflit armé. Ce corpus très complet est dominé par les Conventions de La Haye de 1907 et les Conventions de Genève de 1949. Israël n’en n’a jamais respecté aucune disposition.
L’interdiction de la colonisation dont j’ai déjà parlé est au centre de ce dispositif (article 49). Mais il interdit aussi les atteintes à la dignité des personnes (article 3), notamment par des traitements humiliants et dégradants, ce dont Israël se rend coupable chaque jour contre les Palestiniens. Ce droit exige que soient protégés en toutes circonstances, les personnes âgées, les blessés, les malades, les enfants, les femmes enceintes (article 14), mais cette protection ne fonctionne pas pour les Palestiniens. Les hôpitaux civils devront toujours être protégés (article 18), le libre passage est toujours assuré pour les médicaments et les vivres nécessaires (article 23), les personnes protégées ont le droit de quitter le territoire sous protection si elles le désirent (article 35), la Puissance occupante ne peut détruire les biens des personnes protégées (article 53), les services médicaux au bénéfice des personnes protégées doivent être maintenus (article 56). Tous ces textes sont lettre morte pour la Palestine.
Nous voyons par-là les carences de la société internationale. Les Conventions de Genève sont assorties d’obligations qui incombent à tous les États qui se sont engagés à « protéger » les populations civiles en cas de guerre. Or les autres signataires sont d’une passivité qui en fait des complices. Il est prévu dans les Protocoles additionnels des Conventions de Genève adoptés en 1977, qu’une Commission d’établissement des faits soit chargée de documenter les violations du droit commises par l’occupant. Les « puissances protectrices » ne l’ont pas établie, mais l’ONU l’a fait avec la Commission d’enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé, dont les rapports font autorité. Ils ne sont malheureusement suivis d’aucune mesure concrète de nature à faire cesser les violations massives du droit pourtant constatées. Il est vrai que des mesures individuelles de sanctions ont été prises par différents États contre des colons, ce qui est un début d’action contre la politique illégale d’Israël. Mais ces mesures sont dérisoires.
La Croix Rouge, qui a joué un rôle moteur dans l’adoption des Conventions et leur application, a été dans les premières années du conflit, très engagée sur place. On doit au représentant du Comité international de la Croix Rouge un livre glaçant sur le massacre de Deir Yassine en 1948[10]. Cette organisation reste présente mais elle a peu de poids pour s’opposer aux violations massives des Conventions de Genève. Quant à l’UNWRA créée dès 1949, cette Agence des Nations Unies a pour but d’assurer à la population des territoires occupés par Israël toutes les fonctions vitales : santé, éducation, etc. Elle a aussi un rôle crucial dans le recensement des Palestiniens réfugiés et le relevé des biens qui leur ont été confisqués par Israël. Mais au mépris du droit des Nations unies et à ses obligations comme membre, Israël a décidé l’an dernier de fermer les bureaux de cette Agence à Jérusalem. Cela a fait l’objet d’une demande d’avis consultatif à la Cour internationale de justice. Cet avis n’a pas encore été rendu. Il devrait l’être incessamment. Mais il y a fort à parier qu’il subira le même sort que celui des autres avis de la Cour.
D – Les avis et ordonnances de la CIJ.
La Cour a déjà rendu deux avis consultatifs relatifs à la situation en Palestine. L’un en 2004 pour dire que le mur construit par Israël en territoire palestinien occupé était illégal, qu’Israël devait le détruire et indemniser tous ceux qui avaient subi des dommages du fait de cette construction. L’autre il y a quelques mois, le 19 juillet 2024 pour dire que la présence d’Israël dans le territoire palestinien est illicite, qu’il doit y être mis fin dans les plus brefs délais, que les colons doivent être évacués de ce territoire, qu’Israël doit réparer tous les préjudices causés par sa présence illicite, que tous les États et l’ONU doivent ne pas reconnaître la situation comme licite, ni y prêter aide ou assistance. Et l’Assemblée générale par sa résolution du 18 septembre 2024 a repris ces conclusions et les a détaillées plus précisément.
Que s’est-il passé depuis ces avis et cette résolution ? Rien. Ou peut-être, si on veut y voir un lien, la décision de reconnaissance de la Palestine par certains États occidentaux…. Et pour ce qui est du plan de paix initié par le Président américain qui a abouti à la trêve en cours, il ne doit rien à la volonté d’appliquer le droit international.
Mais il y a aussi et je terminerai par là ce bilan du droit applicable mais non appliqué en Palestine, les ordonnances de la Cour dans l’affaire, non plus consultative, mais contentieuse, portée devant elle par l’Afrique du Sud contre Israël sur la base de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Dans ses 3 ordonnances du 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024, la Cour dit qu’Israël doit prendre toute mesure pour prévenir et empêcher les actes constitutifs de génocide, doit fournir l’aide humanitaire dont la population de Gaza a besoin, elle détaille les mesures comprises par cette aide qui incombent à Israël, elle demande l’arrêt de l’offensive militaire, l’ouverture de points de passage et l’accès sans entrave de toute commission d’enquête ou d’établissement des faits.
Aucune de ces mesures n’a été respectée par Israël. Qu’est-il possible de faire lorsqu’un État ne respecte pas une décision de la Cour ? Il est prévu que l’affaire peut alors être portée devant le Conseil de sécurité qui prend les mesures qui s’imposent. On en revient alors au blocage du Conseil de sécurité par l’un ou l’autre des membres permanents. Cela m’amène à ma partie conclusive : comment en est-on arrivé à un tel degré d’ineffectivité du droit international ?
II – Les raisons de l’ineffectivité du droit international dans le conflit israélo-palestinien.
J’esquisserai une réponse en deux points : d’une part, le droit international est ambigu et il recèle des ambivalences qui permettent son inexécution. Mais d’autre part, il y a l’absence criante de volonté politique des autres États, qu’il s’agisse des États occidentaux ou des États du monde arabe.
A – Les ambivalences du droit international ont conduit à son ineffectivité.
La présentation classique du droit international a, depuis la création des Nations Unies, laissé croire à un saut qualitatif de ce droit par rapport à la situation antérieure où le rapport de forces dominait. Cela est vrai en partie et il ne faut pas que le pessimisme conduise au nihilisme. Mais c’est seulement une petite partie du chemin permettant de doter l’humanité d’un droit se substituant à la violence qui a été franchie. Des institutions ont été créées pour cela, mais elles n’ont pas reçu les pouvoirs qui auraient permis leur efficacité. Ces pouvoirs sont restés entre les mains des États. En effet les progrès potentiels ont été accompagnés de replis régressifs dont on voit les effets délétères aujourd’hui. Je soulignerai ici deux éléments d’explication.
• Contradiction entre souveraineté et droit international.
Le premier tient à la contradiction entre le droit international et la souveraineté des États. Celle-ci joue un rôle central dans l’ineffectivité de ce droit. En effet, la période antérieure aux Nations Unies était dominée par la doctrine de la souveraineté, qualité réservée à ces communautés politiques nommées États. La souveraineté est l’équivalent de l’imperium de la période romaine, pouvoir qui se définissait comme originaire, c’est-à-dire qu’il a sa source en lui-même, qu’il est un pouvoir au-dessus duquel il n’y a rien. Et ce pouvoir détient le monopole des fonctions régaliennes, parmi lesquelles il y avait celui de disposer d’une armée, de faire la guerre, y compris la guerre de conquête que rien n’interdisait. Aussi, sous le règne des souverainetés, la société internationale était-elle, depuis des siècles un champ de batailles. L’ambivalence de la Charte est d’avoir maintenu cette conception de la souveraineté en dépit d’avoir voulu l’entamer.
En effet, en adhérant à la Charte, chaque État accepte une perte de souveraineté puis qu’il renonce à la principale des fonctions régaliennes, le droit de faire la guerre. Cependant la même Charte des Nations Unies reconnaît le principe de souveraineté des États. Et cette souveraineté a permis aux États depuis le début des Nations Unies d’enfreindre de différentes manières l’interdiction du recours à la force.
De surcroît, en adhérant à la Charte, chaque État s’engage à respecter le droit international que les Nations Unies ont considérablement développé au moins dans ses formulations. Mais la même souveraineté fait obstacle à l’exécution des normes en sorte que ce droit international est un droit relatif et faible.
Il est relatif, car il se développe principalement par traités. Or, les traités sont de la nature des contrats. Un contrat est un engagement qui ne concerne que ceux qui l’ont signé. En droit interne, les contrats existent aussi, mais il y a un autre échelon du droit, celui de la loi et c’est la loi qui a valeur universelle et s’applique à tous et les contrats ne peuvent pas déroger à la loi. Et c’est par la loi que la société trouve sa cohérence et son unité. L’équivalent législatif dans la société internationale est très faible, c’est ce qu’on appelle le droit impératif général, mais il n’est pas accepté par tous. Et n’est donc pas réellement un équivalent législatif. Le caractère contractuel du droit international a une conséquence très grave d’abord sur l’universalité des normes qui n’est donc pas accomplie en droit international. Mais aussi sur l’universalité des sujets de droit car nous avons vu que l’on ne peut pas dire qu’un État existe en soi. Chaque État n’existe que pour ceux qui l’ont reconnu.
Mais la souveraineté a aussi des conséquences sur la justice internationale et le droit international est faible faute de procédures d’exécution efficaces. La justice internationale est facultative et non obligatoire puisque les États, dans leur souveraineté peuvent accepter ou refuser la compétence des juridictions internationales. Un État ne peut en traduire un autre devant la Cour internationale de justice que si ce dernier a accepté la compétence de la Cour. Des auteurs de crimes internationaux peuvent ne pas être poursuivis devant la Cour pénale internationale parce que l’État auquel ils appartiennent n’est pas partie au Statut de la Cour
L’affaire de Palestine est exemplaire des carences engendrées par cette situation. Sur les politiques générales d’Israël, il n’a pas été possible d’ouvrir des procédures contentieuses. D’où le recours à des avis consultatifs qui, par définition, n’ont pas de force obligatoire. Et si, exceptionnellement, l’Afrique du Sud a pu ouvrir un contentieux contre Israël à propos du génocide, c’est parce qu’il y avait une clause spéciale dans la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Par cette clause, les États signataires de la Convention s’engageaient à accepter la compétence de la Cour pour tout différend portant sur cette convention. Israël étant partie à cette convention, la procédure a été rendue possible.
Mais le poids des souverainetés s’exerce encore lorsqu’un État adhère à une convention, par la possibilité qui lui est ouverte, d’assortir son engagement de certaines réserves. C’est ainsi que les États-Unis (et d’autres États qui sont dans le même cas) ne peuvent pas être traduits devant la Cour pour complicité de génocide car ils ont adhéré à la Convention en précisant qu’ils refusaient l’article 9 qui donne compétence à la Cour.
Ainsi, si nous voulons que le droit international devienne effectif, il faut en passer par un réel renoncement à la souveraineté. Peu de peuples comprennent qu’ils y ont intérêt car la légende persiste, selon laquelle la souveraineté serait au bénéfice du peuple, comme garantie de sa liberté. Cela est faux. C’est le droit qui est au bénéfice du peuple permettant de sanctionner les dirigeants qui confisquent toujours la souveraineté à leur profit.
Je mentionne ce point rapidement car il est beaucoup mieux connu du grand public. Il s’agit de l’aberration que constitue la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité qui ne sont jamais soumis à réélection et disposent du droit de veto. C’est là un pur principe de domination qui fait des Nations Unies une organisation anti-démocratique. Cette situation est aujourd’hui très critiquée. Malheureusement on ne parle pas d’abolir cette catégorie, mais seulement de l’élargir à quelques bénéficiaires de plus. Autrement dit, on ne veut pas supprimer le principe de domination qui a été établi au profit de 5 États, on veut simplement élargir le clan des dominateurs. Cela veut dire que la pensée démocratique n’a pas encore irriguée l’opinion publique mondiale. Ceci m’amène à la seconde raison de l’ineffectivité du droit international.
B – L’absence de volonté politique de la part des États Tiers.
La tendance à accepter l’impunité d’Israël est profondément ancrée dans les classes dirigeantes de la plupart des pays du monde. Il y a à cela plusieurs raisons politiques.
Il y a à n’en pas douter pour ce qui est de l’Europe, la persistance d’un sentiment de culpabilité à l’égard des Juifs. Ce sentiment est dominant en Allemagne où Angela Merkel l’avait exprimé en disant que pour son pays le soutien à Israël faisait partie de la raison d’État. Mais il est présent aussi dans les autres pays d’Europe qui ont joué un jeu très trouble pendant la Seconde guerre mondiale, notamment la France qui a collaboré ouvertement au crime de génocide contre les Juifs. Ce sentiment annihile la pensée critique à l’égard du gouvernement israélien. On le voit avec la fable d’un Israël, régime démocratique. J’ai rappelé plus haut comment la Cour internationale avait conclu aux pratiques d’apartheid d‘Israël. Et la loi israélienne de 2018 affirmant qu’Israël était l’État des Juifs, confirme que cet État n’est en rien une démocratie. Mais les alliés d’Israël répètent à l’envi qu’il s’agit de la seule démocratie de la région, ce qui leur permet de maintenir leur soutien aveugle à Israël. Le constat qu’Israël commet à son tour un génocide n’a pas encore dessillé les yeux de ces soutiens.
Une autre explication à l’impunité d’Israël tiendrait à une complicité feutrée d’États qui ont un lourd passé colonialiste, comme la France ou la Grande Bretagne, avec la politique coloniale d’Israël. Mais on doit manier cette explication avec des réserves. Car la politique d’Israël n’est pas comparable à celles menées par ses alliés européens comme puissances colonisatrices. Leurs politiques étaient très différentes car le colonisateur n’avait pas pour objectif d’évacuer ou d’exterminer la population colonisée pour s’installer sur les terres ainsi conquises. Le projet était celui d’une exploitation économique. Il y a donc un certain contre-sens à identifier la politique d’Israël aux politiques coloniales des Européens. Mais ce qui semble vrai, c’est une persistance de la part de ces pays d’Europe, d’une indifférence, pour ne pas dire d’un mépris du sort d’un peuple arabe. Cela peut sans doute être analysé comme un relent non éradiqué de la mentalité coloniale.
Il y a aussi, et c’est particulièrement vrai pour les pays anglo-saxons, un soutien à la politique d’expulsion des Palestiniens par Israël de la part de courants évangélistes très développés aux États-Unis et dans d’autres pays. Ce soutien est lié à la prophétie biblique selon laquelle le retour du Christ aurait lieu lorsque tous les Juifs seraient regroupés en Israël.
Enfin, nous constatons l’inertie de la plupart des gouvernements dits du Sud global, y compris ceux des pays arabes. Les peuples des pays arabes sont sensibles au martyr des Palestiniens. Mais leurs gouvernements ont perdu la solidarité qui s’était manifestée dans les premières années de ce conflit. La tentation d’entrer en relations économiques avec Israël l’emporte. Les autres pays se considèrent comme très éloignés de ce conflit. La solidarité, que l’on disait « révolutionnaire » dans les années Soixante entre les peuples décolonisés et ceux qui ne l’étaient pas encore s’est terriblement émoussée.
Ces différents facteurs conjugués aux faiblesses du droit international que j’ai développées ici, expliquent la situation dramatique faite aux Palestiniens, sans qu’ils reçoivent le secours politique dont ils auraient cruellement besoin.
Cette relative indifférence a pour résultat que l’Assemblée générale des Nations Unies, bien que relativement mobilisée sur ce problème, comme l’a prouvé la résolution adoptée en septembre 2024, ne va pas au bout des possibilités qu’elle détient. Elle peut se réunir en assemblée extraordinaire sur la base de la résolution 377 qui, en 1950, avait confirmé que l’Assemblée partage avec le Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix. Elle l’a fait à différentes reprises. Mais elle pourrait, comme l’y autorise cette résolution, décider de l’envoi d’une force d’interposition pour protéger les Palestiniens. Il y a d’ailleurs des appels dans ce sens. Mais pour l’instant, cela n’est pas à l’agenda immédiat.
Je conclurai d’un mot, en disant que ceux qui n’acceptent pas de laisser la tragédie palestinienne se poursuivre doivent être conscients du fait qu’un combat efficace doit se mener à deux niveaux différents : il faut exiger au profit de la Palestine l’application des règles qui ont été formulées et qui restent inappliquées. Mais il faut aussi se situer à un autre niveau d’action, celui de la critique des ambigüités du droit international. Mais cela ne peut pas passer par une réforme des Nations Unies car la Charte n’autorise de réforme qu’approuvée par les 5 membres permanents. Il faut donc travailler à l’échelle mondiale avec les forces démocratiques de tous les continents, à un nouveau système international, débarrassé des ambivalences que j’ai soulignées.
[1] Article 22, par. 4 du Pacte de la Société des Nations : « Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire ». (Souligné par nous).
[2] Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 42 (1948) du 5 mars 1948.
[3] Assemblée générale des Nations unies, résolution 194 (III) du 11 décembre 1948.
[4] Résolution 904 du 18 mars 1994.
[5] Conseil de sécurité, résolutions 271 du 15 septembre 1969, 298 du 25 septembre 1071, 446 de 1979, 452, 465, 476, 478, 592 du 8 décembre 1986, 605, 607, 608, 636, 641, 2334 du 23 décembre 2016.
[6] Chiffres du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés. Voir Laurent Trigeaud, « L’opération Bordure protectrice menée par Israêl dans la Bande de Gaza (8 juillet-26 août 2014) », Annuaire français de droit international, 2014, pp. 171-194.
[7] Résolution 1860 du 8 janvier 2009 et 2728 du 25 mars 2024.
[8] JURDI, Juristes pour le Respect du Droit International.
[9] Association France Palestine Solidarité.
[10] Jacques de Reynier, « A Jérusalem un drapeau flottait sur la ligne de feu », Préface de Paul Ruegger, président du Comité international de la Croix-Rouge. (Editions de la Baconniere.) Neuchatel, 1950.

