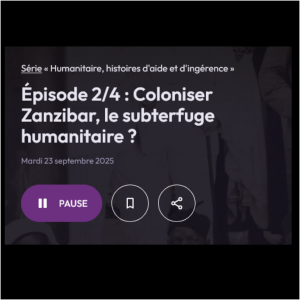L’émission le Cours de l’histoire, de Xavier Mauduit, sur France Culture évoque, dans une série sur l’histoire de l’humanitaire, celle de la colonisation de Zanzibar.

L’explorateur gallois Henry Morton Stanley (1841-1904) à Zanzibar. ©Getty – Hulton Archive/Getty Images
Au 19ᵉ siècle, l’abolition de la traite et de l’esclavage est présentée comme une « intervention d’humanité » par l’Empire britannique. À Zanzibar, à l’est du continent africain, la cause des sociétés abolitionnistes se heurte aux intérêts impérialistes. Avec Raphaël Cheriau, historien.
Ecouter l’émission sur France Culture
Savez-vous jouer au Zanzibar ? En Europe, il s’agit d’un jeu qui se pratique avec trois dés, que l’on peut comparer au 421. Le gagnant est celui qui réalise le plus grand score avec les trois dés affichant des valeurs identiques, des zanzibars. Pourtant, à l’autre bout du monde, ce qui se joue à Zanzibar n’a rien d’un jeu.
L’abolition de la traite et de l’esclavage dans l’Empire britannique
En 1807 et en 1833, la traite puis l’esclavage sont abolis dans l’Empire britannique. « Les abolitionnistes s’attaquent d’abord à la traite parce qu’ils sont convaincus que si on arrête d’acheminer des hommes, des femmes et des enfants pour être réduits en esclavage, vu la nature inhumaine de ce système, [il] mourra de lui-même, puisque les taux de mortalité sur les plantations, que ce soit dans l’Atlantique ou ailleurs, sont tels que sans la traite, l’esclavage devrait s’éteindre », explique l’historien Raphaël Cheriau, auteur d’Intervention d’humanité. La répression de la traite des esclaves à Zanzibar (CNRS Éditions, 2023). Les sociétés abolitionnistes, comme la British Foreign Antislavery Association, ont en effet joué un rôle décisif avec la tenue de meetings, la signature de pétitions et l’organisation de boycotts de produits issus des colonies.
Pour l’opinion publique, la lutte contre la traite est avant tout une question morale et la Grande-Bretagne, en tant que première grande puissance coloniale, aurait la responsabilité d’empêcher la traite.
« Dr. Livingstone, I presume ? »
Le mouvement abolitionniste connaît un second souffle avec la figure de l’explorateur David Livingstone et la publication de sa correspondance, où il parle des ravages de l’esclavage. À sa mort en 1873, les abolitionnistes s’emparent du symbole qu’il incarne pour faire pression sur les autorités coloniales et mettre davantage de moyens dans la lutte contre la traite dans l’océan Indien. Paradoxalement, les dirigeants politiques saisissent la cause abolitionniste pour justifier l’expansion coloniale vers Zanzibar, sultanat à l’est du continent africain. « À partir de la conférence de Berlin [en 1885, où les puissances coloniales européennes se réunissent pour se partager l’Afrique, ndlr.], les impérialistes au pouvoir, comme Salisbury [en Grande-Bretagne], Léopold II [en Belgique], ou Jules Ferry en France, ont bien compris la puissance du courant abolitionniste et humanitaire dans les opinions publiques et, également, l’intérêt du droit international pour justifier légalement leur expansion brutale, leur domination et l’exploitation des peuples et des territoires », souligne Raphaël Cheriau.
Le sultan de Zanzibar se retrouve pris en étau entre les intérêts de ses élites propriétaires terriennes, esclavagistes, et la pression de l’Empire britannique qui souhaite conclure des traités contre la traite dans le cadre de la mission Bartle Frere (1873).
Interventions d’humanité et droit pour l’ingérence humanitaire
En 1890, l’instauration d’un protectorat britannique contraint le sultan de Zanzibar à abolir l’esclavage. Cependant, les mers échappent aux moyens mis en œuvre contre la traite et les abolitionnistes dénoncent une instrumentalisation politique de la lutte abolitionniste. L’Empire britannique tente d’imposer un droit de visite sur les navires. Dix-sept puissances signent un accord en ce sens lors de la convention de Bruxelles de 1890. Ce sont les débuts de la construction d’un droit pour l’ingérence humanitaire.
Pour en savoir plus
Raphaël Cheriau est historien, chercheur associé au Mesopolhis (CNRS, Aix Marseille Université, IEP d’Aix), au Centre Roland Mousnier et au University College Dublin Centre for War Studies.
Il est l’auteur d’Intervention d’humanité. La répression de la traite des esclaves à Zanzibar (CNRS Éditions, 2023).
Références sonores de l’émission :
- Présentation de l’archipel de Zanzibar, surnommé « Île de la Girofle », Actualités françaises, 25 février 1969.
- Le capitaine Sullivan du navire Daphne à Zanzibar, Ocora, 15 septembre 1970.
- Les boutres de Monbasa, RFI, 8 novembre 2022.
- Lecture par Raphaël Laloum d’un extrait de La théorie de l’intervention d’humanité d’Antoine Rougier, 1910.
- Fiction radiophonique sur la rencontre entre Stanley et Livingstone, France Inter, septembre 2019.
- Lecture par Thomas Beau d’une lettre de Charles H. Allen au Marquis de Salisbury, 10 août 1888.
- La victoire de Franco en Espagne, RTF, 8 mars 1939.
Musique : « Mapenzi Matamu » interprété par Nihifadi Abdala.
Générique : « Gendèr » par Makoto San, 2020