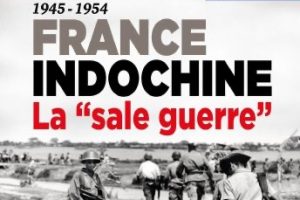La récente publication sur notre site d’un article totalement novateur, signé Olivier Favier, « Des légionnaires italiens dans la “sale guerre“ d’Indochine », nous amène à faire une précision sur les origines de cette expression aujourd’hui très souvent employée, notamment pour qualifier les guerres coloniales.
Dans l’histoire de l’humanité, il n’y eut certes jamais de guerre propre. Pourtant, l’appellation « sale guerre » reste liée, pour beaucoup, à la guerre française – dite aussi première guerre – d’Indochine. Pour beaucoup, cette expression est liée à l’usage intensif qu’en firent les communistes au cours de leur lutte contre ce conflit. Ce n’est pourtant qu’une partie de la vérité : le cadre chronologique est vrai, mais l’expression n’est nullement de paternité communiste.
Par la suite, il y eut bien d’autres utilisations : « La “sale guerre“ a-t-on dit du conflit d’Indochine, mais toutes les guerres coloniales sont de “sales guerres“ » (Aimé Césaire ).
Genèse
En 1947, après une année de guerre entre un Viet Minh retranché dans les montagnes du Viet Bac (Tonkin) et un Corps expéditionnaire encore à l’offensive, l’administration américaine envoie en mission d’information en Indochine le diplomate de renom William C. Bullitt. Au terme de cette mission, le magazine Life publie un entretien qu’il intitule « The Saddest War » , savant dosage de critique feutrée à la politique française dans la région et d’affirmation de la nécessité de la préserver du communisme. Comment Sad (Triste) devint-il Sale ? Toujours est-il que le grand journaliste Hubert Beuve-Méry, qui signait alors Sirius, citant Bullitt, intitule un article d’Une semaine dans le Monde, supplément dominical, « Une guerre sale » : « Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il n’est pas sûr que cette guerre, qui nous a déjà coûté 8.000 hommes et plus de 100 milliards, ait été vraiment inévitable. Il est certain en revanche que les considérations rigides de prestige et de souveraineté ont joué un rôle excessif, que les rivalités de clans et de personnes ont rendu longtemps impossible une politique coordonnée, enfin que la prolongation de la lutte entraîne peu à peu la destruction de ce que nous prétendons sauver… » (17 janvier 1948).
Reprise par la propagande communiste
Ce n’est que quatre jours plus tard que l’expression, retournée (de « guerre sale » à « sale guerre », ce qui n’est pas dénué de signification), apparaît dans la presse communiste. Le prestigieux et vieillissant directeur de L’Humanité, Marcel Cachin, intitula ainsi un éditorial, le 21 janvier, précisant d’ailleurs qu’il reprenait la formule « à un hebdomadaire ».
Dès lors, les communistes vont accaparer cette formule, jusqu’à laisser penser – et sans doute penser eux-mêmes – qu’ils en étaient les inventeurs.
Et le fait est qu’ils l’utilisèrent en permanence, tout au long du conflit, Cachin le premier : « La sale guerre doit prendre fin » (L’Humanité, 28 décembre 1948)… « On s’organise contre la sale guerre » (L’Humanité, 15 décembre 1949). Ou d’autres leaders : « À bas la sale guerre ! » (André Stil, L’Humanité, 11 octobre 1950)… « De la sale guerre à la guerre totale ? » (Pierre Courtade, L’Humanité, 25 janvier 1952).
À de rares occasions, les opposants non communistes au conflit reprirent la formule : « La sale guerre à l’ONU ? » (Jean Rous, Franc-Tireur, 18 juillet 1949)… « La sale guerre à la petite semaine » (Robert Stephens, L’Observateur, 11 mai 1950).
Les adversaires des communistes reprirent la formule, persuadés eux aussi qu’elle était de paternité communiste, pour la retourner contre les combattants Viet Minh et, au delà, contre le PCF : « La grande victime de la sale guerre, c’est le paysan vietnamien » (Léon Boutbien , Franc-Tireur, 4 octobre 1950). Dans une polémique vive avec Claude Bourdet, François Mauriac lança : « N’espérez pas que je m’abaisse jamais jusqu’à emprunter aux hommes de Moscou le slogan de le “sale guerre“ » (Le Figaro, 23 janvier 1950).
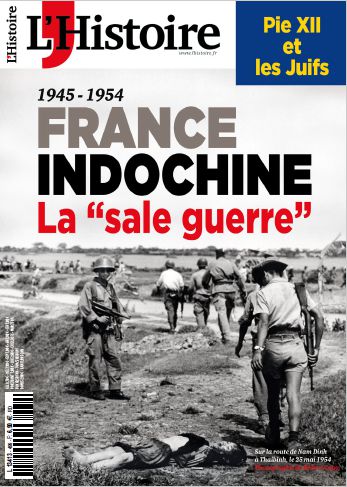
Destin d’une formule
Avec les années, le souvenir de la guerre française d’Indochine s’est estompé. Mais la formule a gardé sa puissance, appliquée à la phase américaine du même conflit. Quelques jours avant la chute de Saigon en 1975, France-Soir fit sa Une avec une photo pleine page, devenue célèbre, d’un homme en pleurs, tirant un sac plastique : « La sale guerre. Ce Vietnamien porte dans un sac le cadavre de son enfant » (5 avril 1975). Ce fut également le titre d’une série télévisée allemande sur les deux phases du conflit du Viêt Nam, diffusée en France par la chaîne Arte, du 4 avril au 2 août 2015.
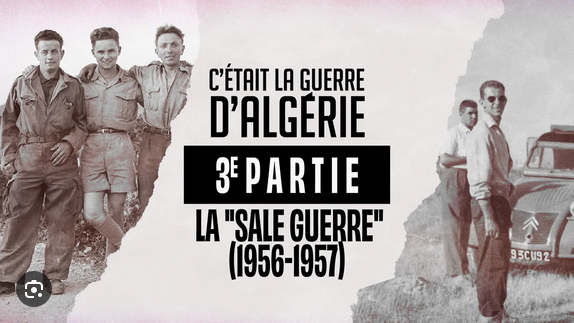
Puis l’expression dépassa largement les frontières de la péninsule indochinoise. Elle fut souvent appliquée à la guerre d’Algérie , puis au Nicaragua (« La France attise le feu dans cette sale guerre », Le Figaro, 6 février 1982 : dénonciation de la livraison d’armes au Nicaragua sandiniste de la part du gouvernement français), au conflit israélo-palestinien (« Des soldats israéliens dénoncent la “sale guerre“ », L’Humanité, 30 juin 1982), au Liban (« La sale guerre syrienne embrase un quartier de Tripoli » (Le Figaro, 24 août 2012), à la répression d’État couvrant les escadrons de la mort en Amérique latine (« guerra sucia »), à la lutte sans merci qui, en Algérie, opposa les terroristes islamistes à l’armée et aux forces de l’ordre dans la décennie 1990 (Habib Soauïdia, La sale guerre ), à la dure répression contres les Tamouls au Sri Lanka , à l’utilisation de drones par l’administration américaine dans sa lutte contre ses ennemis de par le monde (La sale guerre d’Obama ), etc.
[1] Dans l’hebdomadaire de la CGT, alors très proche du PCF, La Vie Ouvrière, un journaliste ira même jusqu’à prétendre que ce fut Maurice Thorez qui inventa la formule (Pierre Delmotte, 26 janvier 1950).
[1] Député socialiste, devenu un des porte-parole de son aile droite.
[1] Mauriac soutint longtemps la politique française en Indochine (en fait, jusque début 1954), alors même qu’il s’engageait avec courage et lucidité pour dénoncer les manœuvres et crimes colonialistes au Maroc.
[1] Gérard Dhotel, Algérie, 1954-1962. La sale guerre, Paris, Actes-Sud, 2014.
[1] Paris, Éd. La Découverte, 2001.
[1] « Sale guerre », Éditorial, Le Monde, 2 mai 2009.
[1] Télévision française, Canal +, Émission Spécial Investigation, 28 octobre 2013.