Pour histoirecoloniale.net, Alain Ruscio et Cheikh Sakho se sont entretenus le 18 avril 2025 avec la journaliste Linh-Lan Dao, autrice de Vous, les Asiates. Enquête sur le racisme anti-asiatique en France, Denoël, 2025.
Entretien avec Linh-Lan Dao
HCO : En épigraphe de votre ouvrage Vous, les Asiates enquête sur le racisme anti-asiatique en France, vous citez deux personnages dont la vie fut marquée par un fort engagement. Le pasteur protestant allemand Martin Niemöller, et Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, militant du FLN en Algérie et penseur du colonialisme, pourquoi ?
Linh-Lan Dao : Alors pour deux raisons différentes. Frantz Fanon, j’avais lu Peau noire, masques blancs. Il se trouve aussi quej’ai vécu à la Martinique pendant un an. Fanon, quand je l’ai lu, j’ai eu une comme une sorte d’épiphanie. Parce que tout ce qu’il disait, même s’il parlait de ce que cela faisait d’être un homme noir, je pouvais m’y identifier. Et je crois que c’est à ce moment-là que je me suis un petit peu située comme sujet colonial à savoir : je me suis dit, s’il vit cela et que moi aussi, c’est que nous avons des destinées communes.
Cela fait plusieurs années que je l’ai lu mais je me souviens du mépris dont il faisait l’objet quand il était en métropole, le fait qu’il n’était pas vu du tout comme un sujet français c’est ce qui m’a aussi marquée. J’ai été marquée par le témoignage d’une femme blanche qui avait un désir voire une obsession de la femme blanche pour l’homme noir à cause d’une virilité fantasmée et je me suis dit c’est fou en fait, que le racisme puisse prendre cette forme-là, aussi bien sous forme d’hostilité, que de fascination, d’exotisation. Et c’est ça qui m’a finalement permis de comprendre un petit peu mieux la particularité du racisme anti-asiatique en France. A part pendant le Covid je trouve qu’il ne prend pas forcément la forme d’une hostilité ouverte, comme cela peut être le cas pour les personnes perçues comme noires ou maghrébines. Par contre, dans tout ce qui est dans l’exotisme, je m’y retrouve. Et pour Martin Niemöller1, son poème m’a marquée parce que je fais des parallèles avec la particularité d’être asiatique. Les Asiatiques en France (Asie de l’est et du sud-est) sont proches de la blanchité dans la hiérarchie raciale française, donc ils peuvent très bien regarder les autres minorités être discriminés sans se sentir concernés. Je pense finalement avoir été dans cette posture-là du fait de mon statut de quelqu’un de privilégié.
Et ce poème me rappelle que la solidarité est nécessaire avec les autres, parce que dans un système qui est raciste, « l’Asiatique » a beau être proche de la blanchité, il n’en reste pas moins un sujet discriminé.
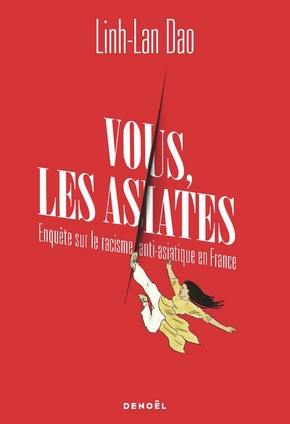
Votre livre est un véritable plaidoyer pour le fait qu’il y a un racisme anti-jaune. Tous les militants et tous les scientifiques récusent ce terme « jaune », mais enfin c’est le mot, utilisé. Comment définiriez-vous le racisme anti-asiatique ?
En effet, le terme « jaune », à l’image du « n* word » est à bannir puisqu’il s’agit d’un terme raciste utilisé par les Occidentaux pour éloigner les populations asiatiques de la blanchité dès le XVIIe siècle. Aujourd’hui le racisme anti-asiatique se manifeste de plein de manières différentes et l’invisibilisation, elle nous vient de la part de la société, mais aussi des Asiatiques eux-mêmes, c’est-à-dire qu’un bon nombre d’Asiatiques vont intérioriser ce mythe de la minorité modèle qui pour moi fait partie de ce racisme. Se dire par exemple : « c’est vrai qu’on est discrets et qu’on en fait pas de vagues ! » C’est aussi croire que le racisme ne nous concerne pas. Le chemin est encore long avant de le reconnaître. J’avoue que c’est quelque chose que j’ai sous-estimé quand Chaolin Zhang, un couturier d’Aubervilliers, a été tué par un jeune qui s’en prenait spécifiquement aux Asiatiques en pensant qu’ils avaient du cash sur eux. Pour moi ce n’était qu’un fait divers, et ce n’est qu’après quelque temps que j’ai compris en me renseignant un peu plus, qu’il y avait eu du ciblage ethnique en plus du motif crapuleux, le meurtrier l’a avoué.
Quant à l’humour raciste, c’est quelque chose que je ne prenais pas non plus au sérieux, alors il a fallu que je discute avec des spécialistes pour légitimer mon indignation. Ils m’ont fait savoir que non, non, il existe bien ce qu’on appelle le « racisme récréatif ». Ce concept a été théorisé par Adilson Moreira, un juriste brésilien. Et c’est super intéressant parce qu’il explique en quoi l’humour raciste n’est pas anodin et qu’il est là pour rappeler la place de l’autre dans la hiérarchie raciale, pour asseoir sa suprématie blanche. C’est un racisme qui va beaucoup se manifester pour la plupart des personnes asiatiques que j’ai interrogées et je pense qu’ils vous diront, en résumé, « je pense que je vis moins de racisme que des personnes noires ou arabes, mais par contre, on se moque beaucoup de moi ». Ensuite, dans mon livre, je démontre qu’il y a quand même du racisme systémique. J’ai des témoignages de violences policières, même si ces violences ciblent avant tout les jeunes hommes noirs et maghrébins, plus que les Asiatiques.
Je montre aussi qu’il y a de la discrimination à l’emploi, au moment de l’embauche, et de la discrimination au logement, chiffres à l’appui. Donc, je dirais que le racisme anti asiatique est protéiforme et qu’il va se manifester de façon encore plus violente si l’on est précaire. Ainsi à Vitry-sur-Seine, des femmes étaient agressées à la sortie du bus par des bandes de jeunes qui les ciblaient parce qu’elles étaient asiatiques. Ce sont souvent des personnes de la classe moyenne (c’est ce que m’ont expliqué des sociologues) qui ont assez d’argent pour acheter, devenir propriétaires et choisissent de s’installer dans des banlieues un peu sensibles . Elles deviennent visibles en peu de temps dans ces banlieues, et de ce fait des cibles faciles. Tandis que pour des personnes comme moi, plus privilégiées, cela permet de lisser un petit peu plus les expériences de racisme, sans les faire disparaître tout à fait. Moi, je n’ai jamais été agressée physiquement du fait de que j’étais asiatique. Par contre, j’ai eu des expériences de ce harcèlement raciste de rue : les fameux nihao, tching tchong, konichiwa, etc. Ça c’est quand même assez dur. J’ai eu de la fétichisation raciale et j’ai eu pas mal de mépris de la part de mes pairs et de déni de francité à l’École de journalisme et dans le milieu du journalisme. Parce que cela reste un milieu très blanc et assez bourgeois. C’est une façon de nous faire sentir qu’on n’est pas à notre place.

Parmi les déclencheurs de votre engagement, un sketch que vous avez vu en 2016, Les Chinois de Kev Adams et Gad Elmaleh. Trouve-t-on encore ce genre de représentations dans la France de 2025 ?
Affirmatif ! Malheureusement, hélas oui ! J’étais déjà choquée de voir ce sketch en 2017, je me suis dit : « Mince alors ! à la cour de récréation, j’entendais les mêmes trucs et là ils les ressortent ». Et ils les ressortent tels quels, Michel Leeb dans les années 80, Gad Elmaleh dans les années 2010. Et là l’accent prétendument chinois, enfin le fameux « accent asiatique », je le retrouve beaucoup sur des vidéos humoristiques sur Instagram. Je sais qu’il y a un influenceur qui s’appelle Inox Tag qui est un peu connu maintenant depuis qu’il a gravi l’Everest. Je me souviens, il tombe sur un petit jeune Asiatique et commence à prendre cet accent… Et le jeune homme lui fait remarquer que c’est raciste. Toujours au niveau de de l’humour et des sketchs, il y a Aymeric Lompret qui a fait un sketch sur les accents de façon générale et il voulait imiter un Chinois qui avait un accent marseillais mais c’était très malaisant et il a fini par faire le fameux accent asiatique qui n’existe pas. Ça c’était sur Radio Nova et c’est dans une émission sur une radio de gauche. Mais il y a plein de gens qui m’ont dit : « Non mais, de toute façon ils sont de gauche »… Là j’avais envie de dire oui, on peut être de gauche, moi je suis de gauche, mais ça n’empêche pas de faire des dérapages racistes, bien au contraire. C’est-à-dire qu’il y a vraiment des milieux qui se pensent progressistes et qui ont encore du chemin à faire. C’est-à-dire qu’on peut être très progressiste sur le plan social et encore véhiculer de la suprématie blanche, ce n’est pas incompatible.
Ce soi-disant humour est quand même très dévastateur. On pense à l’abominable film de Jean Yanne, Les Chinois à Paris, un des grands succès des années 70.
Cet « accent » est encore présent dansdes sketchs. Et puis il y a souvent des extraits de films cultes qui ressortent, comme celui de la Tour Montparnasse infernale, où Éric Judor capitalise sur le faux accent asiatique. Ce racisme interpersonnel venant de la part de personnes racisées, et cela n’encourage pas à la solidarité. Parce que, moi je me rends compte que lorsque j’ai été ciblée par du harcèlement sexiste et raciste dans la rue, c’était presque toujours par des hommes racisés par des hommes dans la rue, c’était souvent des personnes racisées. Un argument de l’extrême droite revient souvent : « Il n’y a que les Noirs et les Arabes qui attaquent (les Asiatiques), il ne faut pas que ce soit tabou ! ». C’est évidemment faux : les personnes blanches sont aussi auteures de réflexions à caractère racistes ! Ce livre est là aussi pour démonter cet argumentaire, et pour montrer que sans déconstruction, pas d’antiracisme possible.
Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, quels sont les autres canaux du militantisme ou de la vulgarisation dans vos travaux ?
Déjà, le livre, je pense, est un bon outil. Les livres sont en général lus par des seniors (plus de 65 ans), suivi des jeunes de 15 à 24 ans. Les cadres et les professions intermédiaires sont bien représentées parmi les lecteurs. Si ça ne tenait qu’à moi je distribuerais mon livre gratuitement à tout le monde, tout ce qui relève de l’antiracisme devrait tomber dans le domaine public. À terme, j’aimerais faire une adaptation de mon ouvrage sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou peut-être YouTube, en petites bandes dessinées ou publications pour que ce soit « consommable » rapidement et accessible au grand nombre. Car je pense que les personnes qui seront sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément celles qui vont prendre le temps de lire un bouquin.
Quels sont les autres vecteurs de militantisme pour la diaspora asiatiques à l’heure actuelle ? Je pense à Koï, le magazine sur les cultures et communautés asiatiques… ?
J’en parle dans mon livre, il y a pléthore d’associations fondées par des asiodescendantes qui ont émergé et c’est cool, il y en a vraiment pour tous les goûts. Koï, ce n’est pas un média militant, mais ça permet de connaître un petit peu les autres cultures asiatiques par exemple. Moi, je n’y connaissais rien aux domestiques filipinas qui étaient maltraitées, ou sur le Nouvel an lunaire, maintenant j’en ai appris plus. Mais il y a aussi Slash Asian qui est un média asioféministe qui avait organisé à l’époque des shootings photos et un festival, je pense que c’est un peu en sommeil. Parmi les associations qui sont vraiment actives aujourd’hui on a Banh Mi Media et Asiattitudes
Banh Mi Media a été fondé par LindaNguon et organise plein d’événements où des jeunes Asiatiques peuvent se rassembler autour de tables rondes, acheter des œuvres artistiques, etc. Et ça c’est cool parce que ce sont vraiment des lieux de rencontre de créatifs qui vont faire émerger des projets ensemble. Elles ne vont pas forcément militer, mais on sent quand on discute avec les gens qu’ils et elles sont plutôt engagé.es. Je sais que Asiattitudes a reçu des subventions de la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) pour avoir des projets avec un premier projet qui s’appelle « Memorasie », je pense, qui consiste à recueillir la mémoire des aînés pour la transmettre. La transmission historique c’est hyper important parce que nos parents ne nous parlent pas forcément des traumatismes causés par la guerre et l’exil. Il y a également une deuxième plateforme qui doit prodiguer des conseils juridiques en cas de racisme anti-asiatique, qui recueille aussi des témoignages. Et la dernière initiative que je trouve très intéressante, c’est Génération Panasiatique, une association de jeunes d’origine sud et sud-est-asiatique qui, elle, n’existe pas depuis longtemps et cherche encore son identité.
Eux, ils ont vraiment un côté politisation très fort. Aux dernières élections législatives, ils ont organisé des tractages – c’est courageux de faire ça -, ils ont traduit des tracts dans sept langues différentes pour aller toucher plusieurs populations asiatiques. Parce qu’ils savent que parfois les premières générations, elles, ne s’intéressent pas trop à la politique, elles ne s’engagent pas « parce qu’elles n’ont pas que ça à faire ». Donc, il y a une politisation qui est en cours et, bien sûr, ils ont en vue 2027, ils se disent « on n’a pas envie que l’extrême droite passe, donc qu’est-ce qu’on fait ? ».
Un des chapitres de votre ouvrage s’intitule « Colonisation, décolonisation et formation des stéréotypes ». À votre avis, où en est la société française sur ces questions à l’heure actuelle ?
Je pense que la société française gagnerait à vous lire plus, vous qui connaissez très bien l’histoire coloniale. Je pense qu’il y a un déni actif de cet héritage commun, « un passé qui ne passe pas ». Rien qu’avec la polémique impliquant le journaliste Jean-Michel Apathie, qui a comparé les massacres commis pendant la guerre d’Algérie à celui d’Oradour-sur-Glane commis par les Nazis ! Ce comparatif a provoqué une tempête médiatique, surtout à l’extrême-droite, ainsi que le scepticisme de certain de mes collègues. En réalité, c’est notre boulot de journaliste d’étudier la guerre coloniale et d’en mesurer les effets sur la société française d’aujourd’hui. Ce que me disait la chercheuse Mame Fatou Niang2 et que je trouve très juste, c’est qu’il y a une sorte de trait d’union qui est rompu entre notre histoire et la société actuelle. Et il ne tient qu’à nous, deuxième génération, de retracer cette ligne, entre ce qui est arrivé à nos anciennes générations et nous. Il y a eu des représentations stéréotypiques et moi j’appelle ça un peu du « lavage de cerveau » qui a perduré pendant, allez, 50 ans, un siècle… Aujourd’hui, il y a des hommes obsédés par les femmes asiatiques, c’est pas venu de nulle part. Cela remonte à l’Indochine, avec les histoires de congaï3 Moi, j’ai été très, très énervée quand j’ai découvert le lien entre cette fétichisation raciale et notre histoire coloniale, la façon dont les femmes indochinoises étaient sexualisées. Elles n’étaient d’ailleurs pas les seules à passer pour des êtres exotiques… En relisant les textes de Pierre Loti, il m’est venu une image de serial killer. Il avait la femme japonaise en ligne de mire qu’il traitait vraiment comme une chose, comme une petite poupée dont il se souciait peu. Il a écrit sur la femme maghrébine, sur la femme qui habite dans son harem, qui est mystérieuse.
Et la femme sénégalaise4 aussi… Voir Le Roman d’un spahi.
Voilà, il est très complet, franchement… C’est une personne très cohérente… Et ces représentations persistent. J’ai plein de gens en commentaire de mes vidéos qui me disent : « Mais l’histoire coloniale, elle est terminée, passez à autre chose ! ». Ah ben oui, elle est terminée. Mais ses effets ne sont pas terminés, ils persistent toujours. Donc femmes fétichisées, « péril jaune »… Là, j’en reviens encore à mes camarades journalistes, le péril jaune, c’est devenu le péril économique chinois. À mon époque, on n’étudiait au lycée que la décolonisation… mais on n’a pas trop étudié la colonisation. C’est bien dommage parce que je me serais énervée beaucoup plus tôt et donc je pense que toute personne, toute la société française devrait être au courant des horreurs de l’histoire coloniale. Parce que déjà ça leur éviterait les dénis de francité, de se demander : « Tiens pourquoi il y a des personnes qui sont non blanches et qui habitent ici sur le sol français ? ». Et puis, deuxièmement, ça leur permettrait peut-être de comprendre un petit peu mieux les discriminations qui touchent toutes les personnes non-blanches aujourd’hui.
Peut-être une dernière question : quel lien entre la rigueur que vous observez dans votre travail et votre position personnelle en tant que militante de votre association, l’AJAR (Association des Journalistes Anti-Racistes et Racisé.e.s) ?
Le but de l’association, c’est de lutter contre le racisme dans les rédactions, les écoles de journalisme et dans le traitement médiatique. Et c’est d’améliorer la représentation, c’est-à-dire, plus de personnes racisées dans ces rédactions. En fait, on aimerait bien que le journalisme soit à l’image de la société française, donc un petit peu plus varié, que les récits ne soient pas trop déconnectés de la réalité de la société. Parce qu’on sait que le journalisme est loin d’être neutre, le journalisme relaye quand même la position dominante, mais c’est une domination qui s’ignore. Moi, je suis une journaliste plutôt aisée. Quel regard vais-je avoir sur les banlieues ? Je pense que je ne vais pas avoir un regard hyper éclairé sauf si je m’éduque un minimum à ce sujet. Voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait dans les banlieues. Je me suis dit : « Ah, ils sont en colère, c’est quoi leur problème ? » Alors que maintenant, quand je discute avec des personnes concernées ou quand je regarde des films comme Les Misérables de Ladj Ly ou Divine de Houda Benyamina, ça me permet de comprendre un petit peu mieux leurs problématiques, ce sentiment d’abandon par l’État… Ça me fait du bien de partager du ressenti avec des camarades, enfants d’immigrés, qui ont les mêmes problématiques : on est quand même dans des milieux bourgeois, privilégiés et assez fermés.
Les médias ce sont des espaces de pouvoir, on en s’en rend par forcément compte quand on se lance dans le métier. Les rédactions, ce sont des lieux où il y a des dynamiques de pouvoir très, très fortes. Et quand on arrive, qu’on est racisé.e et qu’on n’a pas de réseau parce que nos parents sont « juste » des enfants d’immigrés, c’est un peu la douche froide. Donc, on s’entraide. Je suis membre de cette association depuis la création en mars 2023, je fais partie des porte-parole. Mais je vais aussi m’occuper du groupe de parole, c’est-à-dire que c’est un groupe où on peut parler de de nos déboires et de se donner des conseils pour avancer. Enfin, on a besoin de ces espaces pour se confier parce que parfois c’est difficile. Je trouve qu’on pourrait m’opposer que c’est incompatible avec mon métier, du genre : « Mais pourquoi t’es militante et à la fois journaliste du service public ? Tu ne peux pas faire les deux en même temps ». En fait, oui mais je prône la rigueur journalistique dans le sens où chaque mot que je vais dire, je vais le peser, chaque chiffre que je vais donner, je vais le vérifier et le remettre dans son contexte, et je ne vais pas juste prendre ce qui m’arrange. Par exemple dans mon livre, j’admets qu’il y a bien de la réussite scolaire chez les Asiatiques, je ne suis pas dans le déni. Mais moi, ce qui va m’intéresser, c’est le décryptage, c’est expliquer de façon très honnête. Et je pense qu’on peut tout à fait être journaliste du service public et avoir des valeurs progressistes. Donc, pour moi, je remplis ma mission doublement de service public en intégrant une association qui a pour but un meilleur vivre-ensemble. On n’est pas le lobby des racisé.es qui va le prendre le pouvoir. On veut juste vivre normalement et tranquillement avec le reste de la société.
Est-ce que vous organisez des manifestations grand public avec l’AJAR ?
On a organisé des soirées festives pour nos anniversaires (1 an et 2 ans), on a organisé un festival à Marseille, on organise des tables rondes et là, par exemple, on organise un événement pour présenter un kit sur le racisme anti-asiatique dans le traitement médiatique, qui aura lieu le 31 mai. Donc on fait plein de choses.
J’avais une dernière chose à dire sur le color blindn5ess de la France, ça c’est vraiment un gros frein au progrès de l’antiracisme. Ce color blindness où on nous dit : « Ah ben, je ne vois pas les couleurs ». Voir le racisme c’est voir les couleurs, peut être que la France se dit universaliste, mais nous, on les « sent » les couleurs, c’est-à-dire qu’on ne se réveille pas tous les jours en se disant oui je suis asiatique, oui je suis arabe ou quoi que ce soit, mais la société nous le rappelle très rapidement et très régulièrement.
- « Quand les nazis sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates,
je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait
plus personne pour protester. » Niemöller, 1946. ↩︎ - https://fr.wikipedia.org › wiki › Mame-Fatou_Niang ↩︎
- https://www.cnrtl.fr/definition/congaï#:~:text=CONGAÏ%2C%20subst.-,fém.,indigène%20nous%20chassera%20du%20pays. ↩︎
- Pierre Loti, Le roman d’un spahi, 1881. ↩︎
- Une politique color-blind est une politique « aveugle » à la race au nom des principes universalistes proclamés de la République française. ↩︎

