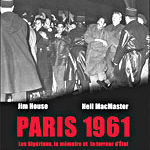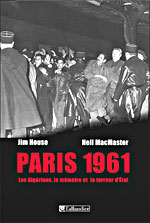
Le 17 octobre 1961 avait lieu en plein Paris une chasse aux Algériens menée par la police, faisant plusieurs dizaines de morts. L’indépendance algérienne était alors une certitude, dont le FLN (Front de libération nationale algérien) et le gouvernement français ne négociaient plus que les modalités. La police parisienne, sous les ordres du préfet Maurice Papon, massacra pourtant des Algériens manifestant pacifiquement contre les mesures discriminatoires les touchant depuis plusieurs semaines et pour l’indépendance de leur pays.
La parution en 2008 de Paris 1961, ouvrage des historiens anglais Jim House et Neil MacMaster, permet de porter un regard nouveau sur l’événement. D’une part, en l’inscrivant dans un cycle de violences policières débordant largement la seule journée du 17 octobre. D’autre part, en sondant les origines du harcèlement policier et des discriminations subis par les Algériens de Paris – il faut alors mettre l’accent sur le rôle déterminant du préfet de police Maurice Papon et de l’idéologie dont il est le zélé serviteur.
Croisant plusieurs histoires (de la colonisation, de l’immigration, de la police) que l’Etat français ne saurait regarder en face sans perdre son vernis démocratique qui continue de leurrer, l’histoire des crimes policiers d’octobre 1961 demeure fondamentale dans un pays où le racisme d’Etat est une permanence – du Commissariat aux Questions Juives au ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale.
Papon, la police et l’armée : de Vichy aux colonies (1940-1958)
Maurice Papon est le préfet de police de Paris depuis mars 1958. Rouage essentiel dans la déportation des juifs en tant que préfet de Bordeaux sous Vichy, Papon s’est toujours présenté comme un fonctionnaire zélé, obéissant simplement aux ordres de ses supérieurs. Il était en réalité un homme très marqué politiquement et idéologiquement, surenchérissant au service du racisme d’Etat.
Jim House et Neil MacMaster montrent clairement les liens entre les pratiques répressives de Vichy à l’égard des juifs et celles menées à l’égard des mouvements d’émancipation des colonisés – dans les colonies et en métropole. Souvent, les mêmes hommes ont été impliqués dans les deux types de répression de part et d’autre de la Méditerranée – des hommes de terrain mais aussi de hauts fonctionnaires : « il semble ainsi que ceux qui avaient le plus œuvré à la persécution des juifs de Bordeaux (Sabatier, Papon, Garat, Gazagne) aient été rapidement transférés en Algérie, dès 1945, par le ministère de l’Intérieur, pour être mis à l’écart des purges et des procès ».
Ainsi, Papon, colonialiste convaincu, a officié dans le Constantinois en Algérie en 1945, de 1949 à 1951, puis entre 1956 et 1958, après un passage au Maroc en 1954-1955. Les mesures répressives contre les mouvements politiques qu’il met alors en place dans les territoires de l’empire seront standardisés pendant la guerre d’Algérie : recensement et fichages, législations discriminatoires, couvre-feu, rafles, centres et camps de rétention, tortures, jugements expéditifs devant les tribunaux militaires sanctionnés par les plus lourdes peines (peine de mort, emprisonnement à perpétuité) – mais aussi assassinats à grande échelle en toute impunité.
Son expérience constantinoise dans les premières années de la guerre d’Algérie est particulièrement importante : il est alors « superpréfet » contrôlant les autorités civiles comme militaires, et s’inspire explicitement des théories des généraux français sur la « guerre révolutionnaire » pour mener à bien la « contre-insurrection » face au FLN : demandant en 1957 à « tous les civils de se conduire en soldats », il met en place une guerre aux aspects psychologiques importants, du même type que celle mise en œuvre à Alger par les troupes de Massu – quadrillage urbain, barrages, fouilles, etc., avec utilisation systématique de la torture et assassinats banalisés. Cette doctrine de la « guerre révolutionnaire », forgée pendant la guerre d’Indochine par des généraux français, décrit, dans le contexte de la guerre froide, un monde assiégé par le « communisme » (dont les mouvements anticolonialistes seraient une modalité) face auquel il faut défendre les « valeurs occidentales » par l’usage de la « contre-violence », l’abandon du droit, et la guerre psychologique (par laquelle on espère couper les mouvements nationalistes des « masses »).
Pendant toute cette période et malgré les changements politiques, Papon est recherché pour ses services et sa « connaissance » des mouvements nationalistes.
Les Algériens et le FLN à Paris (1954-1958)
Sur 350 000 Algériens résidant en France au début des années 1960, 180 000 vivent en région parisienne, y travaillent en majorité comme ouvriers manuels non qualifiés et habitent dans les bidonvilles des banlieues industrielles et dans les arrondissements pauvres de Paris. A partir de 1958, le FLN (Front de libération nationale algérien), constitué le 1er novembre 1954, contrôle d’une main de fer les immigrés algériens en métropole, auparavant majoritairement acquis à Messali Hadj (leader nationaliste algérien contre lequel lutte le FLN).
Pour le FLN, la France est en effet un espace stratégique, les travailleurs immigrés fournissant par leurs cotisations 80% du budget total du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Le FLN est organisé en une Fédération de France, dont le siège est situé à Cologne (République fédérale allemande), qui connaît des luttes de pouvoir avec des militants parisiens et avec le GPRA (situé à Tunis). En août 1958, le FLN décide d’ouvrir un « second front » en métropole : des attentats sont commis, et des policiers sont assassinés.
De Gaulle, Papon et la police parisienne : la mise en place de la terreur d’Etat (1958-1961)
Lorsqu’il devient préfet de police en mars 1958, Papon connaît déjà la préfecture de police de Paris, dont il a été le secrétaire général entre 1951 et 1954, sous les ordres du préfet Jean Baylot, colonialiste anticommuniste qui réhabilita un certain nombre de policiers collaborateurs sous Vichy. Dès avant le début de l’insurrection algérienne du 1er novembre 1954, les Algériens de Paris ont une expérience collective de la répression policière, comme lors d’un meeting de 1951 où 15 000 d’entre eux sont raflés et fichés ou lors du 14 juillet 1953 où six manifestants algériens sont tués. Une brigade spéciale, constituée de policiers français originaires d’Algérie et parlant l’arabe et le berbère, est par ailleurs constituée à cette période pour réprimer le nationalisme à Paris.
Le 13 mars 1958, une grande manifestation de la police envahit le Palais Bourbon, réclament des primes de risque face aux attentats du FLN. Face à cette crise de la police parisienne, Maurice Papon apparaît comme l’homme de la situation, et il est nommé préfet de police dans le but de briser le FLN à Paris. L’arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir en mai 1958 et la naissance de la Ve République ne remettent pas en cause la place de Papon, qui se réinvente un passé gaulliste. […]
Dès son arrivée à la préfecture de police en mars 1958, Papon enclenche un processus de militarisation de la police parisienne. Malgré quelques réticences, les méthodes militaires de la contre-insurrection sont importées dans la police, notamment par un Comité de coordination d’action psychologique et divers services proposant par exemple de l’assistance à la population algérienne pour mieux la contrôler et l’éloigner du FLN.
Papon réclame par ailleurs un système répressif discriminatoire à l’égard des Algériens de France, comparable à celui mis en place en Algérie depuis 1956 (vote des pouvoirs spéciaux, entraînant le transfert à l’armée des fonctions civiles et policières de l’Etat en Algérie) : il obtient notamment le droit de garder les Algériens en garde à vue pendant deux semaines, de les interner sans jugement mais aussi de les expulser en Algérie où ils seront remis aux mains de l’armée française ; par ailleurs, fouilles nocturnes, expulsions du domicile et enfermement dans des camps d’internement (notamment à Vincennes et dans le Larzac) sur simple décision administrative sont autorisés et réguliers. Ainsi, en 1958, plus de 120 000 contrôles de police sont effectués dans la rue à l’encontre d’Algériens, dont plus de la moitié sont envoyés au centre d’identification de Vincennes où ils sont fichés et souvent victimes de violences policières. Cela entraîne des licenciements pour manque d’assiduité ou invalidité, pesant dans les fonds du FLN.
En 1959 est créée la Force de police auxiliaire (FPA), composée de 400 Algériens harkis1 ayant souvent fait leur preuve dans la bataille d’Alger, pour infiltrer le FLN et se charger des violences les plus extrêmes – notamment des tortures, systématisées sur le sol métropolitain. Issue de l’armée, cette force de police agit hors de tout contrôle : ainsi, suite à une attaque du FLN contre la FPA du 18e arrondissement en avril 1961, plus de 150 Algériens passés à tabac sont hospitalisés en chirurgie (« ratonnade de la Goutte d’Or » des 2 et 3 avril 1961).
C’est au vu de tout ce dispositif que Jim House et Neil MacMaster parlent de terreur d’Etat : la violence n’est pas le résultat contingent d’opérations policières ou militaires, mais elle est systématisée et planifiée au plus haut niveau, s’appuyant sur la confusion entre police et armée et le refus de reconnaître le FLN comme des combattants d’une guerre – ce qui exclut ses militants des protections prévues par la convention de Genève de 1949.
La crise de la police parisienne face aux attentats du FLN et l’accroissement de la terreur (août-octobre 1961)
De juin à août 1961, la Fédération de France du FLN décide d’une trêve, cependant rompue unilatéralement le 15 août par le FLN parisien, qui assassine une dizaine de policiers en deux mois. Cette recrudescence s’explique par la volonté de riposter à la répression policière accrue – même si la répression qui s’ensuit est encore plus forte, notamment dans les treize bidonvilles de Nanterre et d’Aubervilliers où vivent 8 000 Algériens désormais soumis à des fouilles nocturnes, des destructions et un couvre-feu. Par ailleurs, pour le FLN parisien, riposter est le meilleur moyen de garder ses militants mobilisés.
Face à ces assassinats, les syndicats policiers réclament plus d’armes et de gilets pare-balles, et obtiennent satisfaction. Certains syndicalistes font part à Papon de leur crainte de voir un « débordement de la base » et notamment la constitution de commandos illégaux de policiers se faisant « justice » seuls. Mais Papon affirme qu’il couvrira ces représailles expéditives et qu’elles peuvent se dérouler dans un cadre légal. Il affirme ainsi, aux obsèques d’un policier, le 2 octobre 1961 : « pour un coup reçu, nous en porterons dix ». Ces déclarations sont interprétées sans équivoque comme des appels au meurtre.
Début octobre, le Comité interministériel décide d’un couvre-feu discriminatoire à l’encontre des Algériens de France (« Français musulmans d’Algérie »), effectif à partir du 5 octobre par cet arrêté préfectoral :
« Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d’être décidées par la préfecture de police. En vue d’en faciliter l’exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Ceux qui, par leur travail, seraient dans la nécessité de circuler pendant ces heures, pourront demander au secteur d’assistance technique de leur quartier ou de leur circonscription une attestation qui leur sera accordée après justification de leur requête. D’autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de trois ou quatre hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects aux rondes et patrouilles de police. Enfin, le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d’Algérie doivent fermer chaque jour à 19 heures ».
Les crimes policiers de septembre-octobre 1961 : cycle et auteurs
Si l’habitude a été prise de désigner les assassinats d’Algériens par la police comme « le massacre du 17 octobre 1961 », il convient en réalité de replacer cette journée dans un contexte plus large de crimes policiers. Comme l’écrivent Jim House et Neil MacMaster, le 17 octobre est le « point culminant d’un long cycle de répression coloniale » courant sur plusieurs mois, résultat de l’ « introduction, au sein même de la capitale métropolitaine, de formes de terreur d’Etat qui auraient normalement dû rester confinées au théâtre d’opération nord-africain ».
Les crimes de 1961 s’inscrivent d’une part dans une longue série d’actes de violence d’Etat contre les colonisés depuis l’après-Seconde Guerre mondiale (Algérie 1945, Madagascar 1947, guerres d’Indochine et d’Algérie…), d’autre part dans un contexte plus court de violences touchant le sol métropolitain (attentats des colonialistes de l’OAS, violences policières à l’encontre des Algériens…).
En effet, la plupart des Algériens ont été tués dans les semaines précédant le 17 octobre, surtout à partir du 1er septembre. Selon les archives judiciaires, 246 Algériens sont décédés de mort violente en 1961, dont 105 en octobre. Généralement, la préfecture présente ces assassinats comme des règlements de compte entre Algériens (l’étranglement étant alors pratiqué par des policiers pour attester cette version) ou comme le fait d’extrémistes français. Cependant, il existe 67 cas où l’implication de la police est prouvée et l’identité de la victime connue ; de nombreux témoignages attestent par ailleurs des menaces de mort quotidiennes de policiers sur des militants. Dès septembre, on entend parler de cadavres retrouvés dans la Seine, dans des canaux et rivières, ou dans des bois.
Qui sont les assassins ? L’essentiel n’est sans doute pas de déterminer des noms, mais de montrer à quel point la culture même de la violence et du racisme au sein de la police parisienne était un facteur évident du déclenchement de tels crimes. Les crimes de 1961 sont ainsi l’ « expression d’une culture raciste profondément enracinée dans la police, et non pas une anomalie » (Jim House et Neil MacMaster). Un racisme d’autant plus présent que nombre de policiers parisiens étaient des pieds-noirs ou anciennement policiers dans les colonies, proches voire membres de l’OAS, tandis que des CRS et gendarmes avaient été envoyés en formation en Algérie.
Au sein de la police parisienne, il est cependant possible d’isoler un certain nombre de composantes – jouissant d’une forme d’autonomie – ayant sans doute eu un rôle fondamental. D’une part, la Force de police auxiliaire (FPA) composée de harkis. D’autre part, les Equipes spéciales patrouillant en voiture, mi-civil mi-uniforme, arabophones et berbérophones, suffisamment différenciées de la chaîne officielle du commandement pour que le gouvernement puisse dénier toute implication. Enfin, les Compagnies d’intervention, composées de volontaires jeunes aimant le combat, parfois d’anciens parachutistes, menant des opérations de rue contre les Algériens. Ces dernières seront également les auteurs du massacre du métro Charonne, quatre mois plus tard.
Le FLN et l’organisation de la manifestation du 17 octobre 1961
Comme on l’a noté plus haut, le FLN connaît une crise à l’été 1961 : des militants parisiens outrepassent les ordres de quasi-cessez-le-feu de la Fédération de France, et les assassinats de policiers reprennent. Finalement, la Fédération de France prend le dessus, et décide depuis Cologne d’une manifestation extraordinaire le 17 octobre 1961 en plein cœur de Paris, contre l’avis de plusieurs militants parisiens qui craignent la répression policière. La Fédération prévoit également des manifestations de femmes, des manifestations en province, ainsi qu’une grève générale de 24 heures et une grève de la faim des détenus algériens dans les prisons françaises. Il s’agit toujours de réclamer l’indépendance de l’Algérie, mais aussi de s’opposer à la terreur d’Etat et notamment au couvre-feu imposé le 5 octobre, non plus par la violence clandestine mais par l’action pacifique de masse (le FLN, qui cesse le feu, espère ainsi renverser l’opinion française).
La Fédération souhaite montrer la cohésion de la population algérienne, le caractère hégémonique du FLN, mais aussi prouver au GPRA de Tunis sa force dans le cadre de la lutte pour le pouvoir qui les oppose au sein du FLN. La Fédération de France impose ainsi une discipline stricte pour la manifestation du 17 octobre : on oblige tous les Algériens à y participer, mais on interdit le port d’arme et la réponse aux violences policières (les participants sont fouillés). Les manifestants se trouveront de fait dans une situation de grande vulnérabilité.
Cependant, on ne peut affirmer que les manifestants du 17 octobre ont été les victimes passives d’ordres suicidaires du FLN : ces Algériens et Algériennes subissaient depuis plusieurs mois un contrôle policier strict, des brutalités policières régulières, et une législation discriminatoire, ce qui constituait un motif évident de révolte, qui s’exprima dans une manifestation pacifique dont tous les observateurs notèrent le caractère extrêmement digne (vêtements portés par les manifestants, slogans, etc.).
Le 17 octobre 1961, point culminant de la répression policière
Dans la nuit du 16 au 17 octobre, la préfecture de police est informée de la mobilisation clandestine et sait que la manifestation sera pacifique et rassemblera hommes, femmes et enfants. Le 17, des cars de police quadrillent la ville dans la matinée.
En fin d’après-midi, 20 000 à 30 000 Algériens convergent par petits groupes vers Paris par divers moyens de transport. Trois manifestations sont prévues, sur les Champs-Élysées, sur les boulevards Saint-Michel et Saint-Germain, et sur l’avenue de l’Opéra et la place de la République. Les différents convois sont arrêtés, notamment à la hauteur des ponts de Neuilly et Saint-Michel, où les manifestants sont tabassés et jetés dans le fleuve. Des violences ont lieu dans les couloirs souterrains des métros d’où sortent les manifestants (notamment Concorde, Madeleine, Etoile, Opéra). Les armes utilisées sont diverses : crosses d’armes, matraques, « bidules » (longues matraques de bois), mais aussi armes non-conventionnelles comme des manches de pioche et des barres de fer. Les policiers frappent au ventre et à la tête. Dans le quartier latin, de nombreuses balles sont tirées par la police.
Papon suit toutes les opérations et se rend lui-même à l’Etoile pour constater leur « bon déroulement ». Il a aussi connaissance de toutes les liaisons radio de la police, et ne dément pas les faux messages d’information qui circulent, selon lesquels des policiers auraient été tués, ce qui augmente encore plus la violence des policiers contre les manifestants.
Plus de 11 000 Algériens sont interpellés et internés pendant près de quatre jours au Palais des Sports, au Parc des Expositions, au stade de Coubertin, au Centre d’Identification de Vincennes. Dans l’enceinte des lieux d’internement, les violences systématiques continuent et des exécutions sommaires ont lieu. D’autres sont internés dans les commissariats parisiens et même, pour 1 200 d’entre eux, dans l’enceinte de la préfecture, où des policiers dénoncent à France-Observateur l’exécution de 50 Algériens ensuite jetés à la Seine. Les bus de la RATP réquisitionnés par la police pour convoyer les détenus sont rendus couverts de sang.

Les 18, 19 et 20 octobre, les actions prévues par le FLN se déroulent pourtant, et donnent également lieu à une répression policière : grève des commerces brisée par des réouvertures forcées, plus de 2 000 arrêtés lors de manifestations avortées lors desquelles d’autres assassinats sont commis, violences physiques et verbales contre la manifestation des femmes du 20 octobre réclamant l’indépendance de l’Algérie et la libération des hommes – 60% des Algériens de Paris sont alors en détention.
Le mensonge d’Etat et « la construction sociale de l’indifférence »
Plusieurs facteurs font du décompte des morts un exercice particulièrement délicat : disparité de sources souvent mensongères, maquillage des meurtres, le fait que beaucoup d’Algériens ont refusé d’aller à l’hôpital de peur de s’y faire arrêter, etc. Il est cependant incontestable que plusieurs centaines d’assassinats d’Algériens ont été commis par la police en septembre-octobre 1961.
Au lendemain de la manifestation, le bilan officiel est de deux morts algériens. La presse et la préfecture de police parlent de « tirs échangés » entre la police et les manifestants. Des demandes d’enquête sont déposées à l’Assemblée ou au Conseil municipal, mais Papon, secondé par le gouvernement français, contrecarre dès la mi-novembre toutes les demandes d’enquête sur les meurtres tandis qu’il se proclame vainqueur de la « bataille de Paris ». Les plaintes déposées, nombreuses, n’aboutissent pas, et la police saisit en novembre 1961 80 témoignages manuscrits d’Algériens victimes de la répression. L’amnistie prévue par les accords d’Evian du 22 mars 1962 empêche désormais toute plainte. Le mensonge d’Etat, co-construit par le gouvernement, la police, la justice et la presse majoritaire, l’emporte. Maurice Papon demeure préfet de police de Paris jusqu’en 1967.
Pourtant, des protestations ont immédiatement lieu, dès le 18 octobre 1961 : les photos sans appel d’Elie Kagan accompagnent des articles de presse, des médias et des individus indépendants mènent des enquêtes dans les bidonvilles où est fait état de la répression, et deux tracts écrits par des policiers (dont un par le syndicat CFTC) dénoncent la répression menée par leurs collègues sous les ordres de Papon. Mais tout cela demeure bien maigre face à la censure et au mensonge d’Etat.
Bien plus, la gauche française elle-même ne s’approprie pas l’événement, et le Parti communiste français notamment déplace la question de l’indépendance algérienne – revendiquée par tous les manifestants du 17 octobre 1961 – vers la question plus consensuelle de l’antifascisme (lutte contre l’OAS et la fascisation de l’Etat) qui trouve dans le massacre du métro Charonne un événement plus « porteur » (8 manifestants communistes et syndicalistes français anti-OAS y sont tués par la police, le 8 février 1962).
C’est ce que Jim House et Neil MacMaster nomment la « construction sociale de l’indifférence » : « les victimes de la violence d’Etat ne risquaient guère de solliciter la sympathie publique : leur classe sociale tout comme leur origine ethnique les plaçaient en effet au plus bas de l’échelle mouvante de l’outrage moral ».
Sources
Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris, Seuil, 1991
Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961, Tallandier, 2008
Charlotte Nordmann, « Ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 »
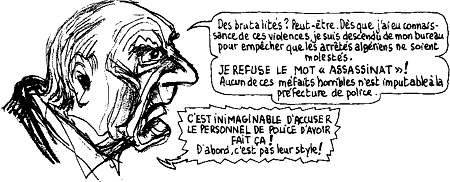
- S’ils ont été appelés couramment des “harkis”, du terme employé pour désigner l’une des catégories de supplétifs en Algérie, les membres de la “Force de police auxiliaire” mise en place par Maurice Papon, police spéciale commandée par des militaires, n’étaient pas des “harkis”. Leur fonction était l’action policière contre le FLN, alors que la plupart des supplétifs en Algérie, liés par des contrats journaliers ou mensuels renouvelables, n’étaient pas armés et ne participaient à des opérations militaires ni de police. [Note de LDH-Toulon]