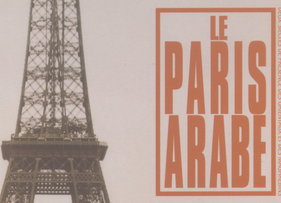Le livre France, terre d’immigration, publié en décembre 2024 par les éditions Philippe Rey rassemble des contributions d’auteurs connus pour leurs travaux sur divers aspects de l’immigration venue en France, depuis treize siècles, du Maghreb, de l’Egypte et de l’Orient arabe. Il est précédé d’une belle préface de Leïla Slimani, issue d’une famille où l’on parlait plusieurs langues et pratiquait diverses religions, ce qui l’a conduite à un intérêt pour cet Autre omniprésent qui dit toujours quelque chose de soi-même. Et qui lui a légué une habitude – dont se moquent ses enfants – à déceler un peu partout en Europe les traces infimes ou évidentes de la culture arabe. Telle est bien le sujet de ce livre : les présences arabes en France, humaines ou culturelles, que beaucoup de nos concitoyens, dans un contexte de racisme montant, ne veulent pas voir ni reconnaître ou qui leur font peur et douter d’eux-même. Il s’agit bien de ça, mais le titre ne le dit pas.
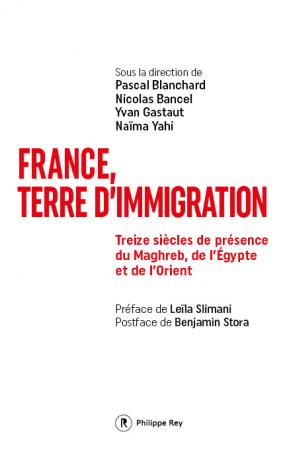
Le titre, France, terre d’immigration, semble choisi pour éviter de nommer le sujet de l’ouvrage, comme si, dans la France d’aujourd’hui, il ne fallait surtout pas qu’un livre comportant le mot arabe dans son titre puisse être vu dans la vitrine d’un libraire. Un sous-titre, en caractères nettement plus petits, précise simplement : « Treize siècle de présence du Maghreb, de l’Egypte et de l’Orient ».
Présenté comme un « travail collectif et collaboratif », c’est en fait la reprise de textes publiés en 2013 par les éditions La Découverte dans un album intitulé La France arabo-orientale, qui était lui-même, en grande partie, la reprise du livre Paris arabe, publié, dix ans plus tôt, par ce même éditeur en 2003. L’auteur principal de cette édition, le communicant Pascal Blanchard, possède un art éprouvé du recyclage et une propension à se présenter en porte-parole des travaux d’autres auteurs qu’il sollicite. L’album paru en 2003, Paris arabe, dirigé par Pascal Blanchard, Eric Deroo, Dris El Yazami, Pierre Fournié et Gilles Manceron, publiait des textes non signés mais, en l’occurance, écrits ou validés par les directeurs de l’ouvrage. Au moins son titre disait-il son sujet. Au début de celui publié en 2013, La France arabo-orientale, on trouve une longue liste de contributeurs, mais leurs textes ont été mixés et refondus par l’équipe éditoriale, à sa manière, sans qu’il n’apparaisse aucune signature qui puisse indiquer par qui tel ou tel texte a été écrit.
Cette technique éditoriale a cessé peu après d’être tolérée par le directeur, François Gèze, des éditions La Découverte. Celui-ci a participé en 2017 à la fondation de l’association Histoire coloniale et postcoloniale qui gère notre site histoirecoloniale.net après avoir quitté en 2014 la direction de cette maison d’édition. Et, au sein de notre équipe, il est devenu, jusqu’à son décès en août 2023, de plus en plus critique vis-à-vis des productions éditoriales ou audiovisuelles de Pascal Blanchard. Il s’est opposé à ce que La Découverte publie un livre proposé par lui et été scandalisé ensuite par le fait que l’ouvrage Histoire globale de la France coloniale, qu’il a fait paraître en 2022 chez Philippe Rey – dans lequel on retrouvait des textes signés de membres de l’équipe de notre site (Gilles Manceron et Alain Ruscio) – ne dise pas qu’il s’agissait pour l’essentiel d’une anthologie d’articles déjà publiés et non pas d’un ouvrage original. Si notre site, finalement, n’a pas repris publiquement sa critique, c’est dans le soucis de ne pas lancer de polémique inutile. Mais, sur le fond, François Gèze avait raison. Et la dérive croissante des entreprises éditoriales de Pascal Blanchard, accueillies désormais par l’éditeur Philippe Rey après avoir été refusées par les éditions La Découverte, en est la confirmation. Du moins, l’Histoire globale de la France coloniale (2022) rassemblait des textes signés par leurs auteurs, ce qui n’est pas le cas de ce dernier livre, France, terre d’immigration, publié par Pascal Blanchard chez Philippe Rey.
Rien d’inintéressant ni de nuisible dans un tel ouvrage. La postface demandée à Benjamin Stora contient des idées fortes. Deux membres de la rédaction de notre site, Alain Ruscio et Gilles Manceron, ont le plaisir d’y retrouver leurs noms dans la liste des contributeurs ; sans qu’il soit indiqué – et pour cause étant donnée la méthode de travail mise en oeuvre – quels textes ils y ont écrits. Leurs contributions, au demeurant, avaient été envoyées il y a une dizaine ou une vingtaine d’années et avaient déjà été « malaxées » et rendues anonymes dans l’album paru en 2013. Elles sont ici tout autant mêlées et refondues dans ce dernier livre, France, terre d’immigration, chez Philippe Rey, dont – fait plus grave encore – le titre semble avoir eu la crainte de désigner explicitement son objet.
Au-delà de son initiateur et de son éditeur, le fait que cet ouvrage n’ose pas avouer son sujet dans son titre nous dit aussi beaucoup des régressions qui caractérisent le climat de notre France actuelle.
Histoire coloniale et postcoloniale.
Présentation de l’éditeur
Sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Yvan Gastaud, Naïma Yahi
Préface de Leïla Slimani
Postface de Benjamin Stora
| Date de parution : | 02/01/2025 |
| ISBN : | 978-2-38482-211-9 |
| Format : | 15,3 x 24 cm |
| Pages : | 400 |
| Prix : | 23.00 € |
Du début du VIIIe siècle jusqu’au premier quart finissant du XXIe siècle, les relations nouées par la France avec les populations issues du monde maghrébo-oriental furent parfois conflictuelles, parfois fusionnelles, mais jamais rompues, tout en restant méconnues encore aujourd’hui. Dans cet ouvrage ambitieux, plus d’une trentaine de spécialistes unissent leurs savoirs pour explorer sur le temps long la permanence de ces liens avec une aire culturelle aux frontières mouvantes à travers l’histoire, et qui s’étend sur une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, des côtes de l’Atlantique à la Turquie, de l’Afrique du Nord à l’Arménie, du Liban au Sahara, de la péninsule arabique à l’Égypte.
Ce récit est riche d’une histoire forte des liens tissés avec ces nations et leurs populations, mais aussi des mouvements migratoires entretenus avec l’Hexagone, qui se densifient à partir du XIXe siècle et se développent au siècle suivant, notamment en provenance du Maghreb, d’abord d’Algérie puis de Tunisie et du Maroc.
Génération après génération, ces nouveaux arrivants diversifient la vie politique, sportive, économique, artistique et littéraire de la société française. Ce métissage n’est pas le fruit d’une secousse ponctuelle, mais bien le résultat de treize siècles d’histoire commune, faisant de la France une terre d’immigration.
Avec la contribution de : Rabah Aissaoui, Elkbir Atouf, Léla Bencharif, Rachid Benzine, Fatima Besnaci-Lancou, Gilles Boëtsch, Saïd Bouamama, Hassan Boubakri, Ahmed Boubeker, François Clément, Peggy Derder, Éric Deroo, Pierre Fournié, Julien Gaertner, Piero-D. Galloro, Bernard Heyberger, Florence Jaillet, Raymond Kévorkian, Smaïn Laacher, Sandrine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Gilles Manceron, Abdallah Naaman, Christine Peltre, Belkacem Recham, Véronique Rieffel, Alain Ruscio, Ralph Schor, Stéphane de Tapia & John Tolan.