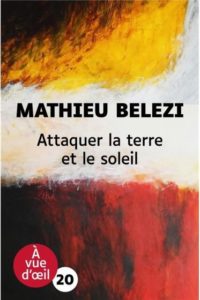Après la parution en 2022 de son livre, Attaquer la terre et le soleil, et la réédition en 2023 de Moi, le glorieux, le romancier Mathieu Belezi poursuit sa tétralogie consacrée à l’Algérie au temps de sa colonisation. Nous reprenons ci-dessous l’article de Muriel Steinmetz publié dans L’Humanité le 31 mai 2024 qui évoque la manière dont cet auteur dépeint une France prédatrice et violente dont les émissaires sont des ogres avides et jamais rassasiés. Une puissante évocation d’une période de l’histoire encore trop méconnue.
Colonisation en Algérie : « Mes livres ouvrent les portes d’un placard maudit », analyse Mathieu Belezi, auteur de « Moi, le glorieux »
par Muriel Steinmetz, publié dans L’Humanité le 31 mai 2024.
Mathieu Belezi s‘est fait un devoir d’écrire sur l’Algérie coloniale. Cette entreprise, de longue haleine, s’est affirmée avec un grand éclat avec la parution d’« Attaquer la terre et le soleil » (le Tripode, 2022), qui alternait la parole d’une femme colon débarquée sur des terres de misère battues par les vents où régnait le choléra, face à la parole collective de l’armée française de la conquête – ivre de vin, de sang et rompue aux crimes de guerre. Avec la publication de « Moi, le glorieux » 1, il révèle un personnage de colon outrancier, d’une avidité colossale, au fil d’une écriture d’une puissance prodigieuse. Il nous en parle.
L’Humanité : Dans « Moi, le glorieux », celui qui dit « je », figure gargantuesque néfaste, est l’image d’un « gros » colon français. Dans « Attaquer la terre et le soleil », on avait affaire aux sans-grade de la colonisation. Dans le massif de votre œuvre romanesque, quelle est la place de ce nouveau roman ?
Mathieu Belezi : « Moi, le glorieux » et « le Temps des crocodiles » 2, ces deux textes, inséparables, tiennent une place très importante dans ma tétralogie algérienne. À travers eux, c’est toute l’histoire de la colonisation algérienne, depuis la féroce conquête incarnée par le jeune capitaine Albert Vandel dans « le Temps des crocodiles », jusqu’à la fuite désespérée de Vandel, devenu ogre tout-puissant, et des quelques vieux fous de colons qui avaient fait fonctionner à leur profit une sorte de puissante satrapie coloniale.
Sous les yeux du lecteur s’agitent l’administrateur du Crédit foncier d’Algérie, le patron du Sphynx et de la Lune (prestigieux bordels), le concessionnaire exclusif de l’alfa (un des deux ou trois colons les plus riches d’Algérie), le grand minotier d’Alger, le maître des renseignements généraux, l’administrateur des phosphates de Constantine, l’administrateur de la Nord-Africaine des ciments Lafarge, l’armateur de l’Algérienne de navigation, le patron de la Fédération des maires.
Ces gens-là représentent le système colonial français, ils sont cette main de fer qui tenait jusqu’à l’étouffement la gorge de l’Algérie. Et la rage antisémite de la fin du XIXe siècle, et les discours racistes prononcés sans vergogne à l’occasion des fêtes du centenaire, et les débordements sexuels de ces hommes jamais rassasiés, tout est dans « Moi, le glorieux », tout ce que les gouvernements successifs de la France se sont efforcés de masquer.
Voilà pourquoi il me semble essentiel de placer « Moi, le glorieux » et « le Temps des crocodiles » en ouverture de ma tétralogie. Avec, pour cette réédition les peintures de l’artiste algérien Kamel Khélif, qui donne à voir ce que sa mémoire d’enfant a conservé précieusement de son pays natal. Ces deux livres ouvrent les portes d’un placard maudit.
À l’énormité du personnage répond la puissance dévorante d’une langue sans merci. Vous n’avez pas peur d’exagérer…
Le personnage d’Albert Vandel vient de ma fréquentation assidue des romans sud-américains, au temps des Garcia Marquez, Carpentier, Roa Bastos, Asturias, Rulfo. La démesure baroque, poétique, servie par une langue puissante, qui jamais ne s’assagit, m’a permis d’embrasser sans crainte cent trente-deux années de turpitudes coloniales. Je suis resté deux ans en compagnie de ce colon plus que centenaire et pesant 140 kg.
Sa voix tonitruante me hantait jour et nuit. L’emportement, le rythme de cette parole débridée, ce déchaînement verbal exigent presque de lire le texte à haute voix. Je me souviens de la lecture de Charles Berling au théâtre de l’Odéon. La voix de Vandel prenait toute sa force, ce personnage hors norme se faisait chair, monstrueusement.
La guerre d’Algérie n’est pas finie dans de nombreuses têtes. D’où vient votre acharnement à explorer en profondeur la conquête et la colonisation de ce pays ?
Lors du débarquement de 1830, l’armée française n’a pas été accueillie à bras ouverts par les populations autochtones. Il faut le dire et le répéter, puisque les pouvoirs de tous bords et l’université française, pendant longtemps, ont préféré ignorer la vérité historique de cette période. Je peux citer à ce sujet François Gèze (fondateur des Éditions de La Découverte) qui, en 2021, dans la revue « Mémoires en jeu », constatait « la méconnaissance générale à l’école comme à l’université de l’histoire coloniale ».
Il ajoutait : « Il y a plus d’historiens du colonialisme français aux États-Unis qu’en France. » Voilà pourquoi je m’acharne sur ce sujet, parce que rien n’est réglé, et qu’il faudra encore du temps pour que la République française accepte de reconnaître ses fautes. C’est en train de changer. Par exemple, les éditions Actes Sud, dans leurs publications scolaires 2024, proposent aux professeurs des lycées une étude de mon dernier roman, « Attaquer la terre et le soleil ». J’en suis très heureux. Mon travail, avant tout littéraire, a aussi pour fonction de réveiller les consciences.
Le soliloque « hénaurme » d’Alfred Vandel, espèce de roi Lear au bord du gouffre, vieil ogre insatiable qui ne regrette rien, risque de devenir un mythe littéraire. Le souhaitez-vous ? N’est-ce pas là le bonheur de l’écrivain ?
Lorsque je commence à écrire les premières phrases d’un roman, je ne sais jamais où va m’emporter l’écriture. Je n’ai pas d’ambition, ou alors j’ai celle, modeste, d’aller au bout de l’histoire, d’écrire enfin la dernière phrase, de faire taire la ou les voix qui m’ont hanté durant des mois, voire des années. Ma seule exigence est d’offrir à celle ou celui qui parle une liberté totale. Que les envolées, effectivement très shakespeariennes, de Vandel fassent de ce personnage une sorte de mythe littéraire, cela ne peut que me réjouir.
Par le truchement d’un texte, quel qu’il soit, l’écrivain a le désir secret d’atteindre à l’universel, c’est-à-dire de franchir avec des mots et une histoire les frontières étroites de son pays pour toucher la sensibilité de lecteurs américains, brésiliens ou turcs. Comment être sûr de la puissance magique d’un texte, quand il est si hasardeux pour des mots enfermés entre les pages d’un livre d’atteindre cette lumière-là ?
Écrire sur la barbarie coloniale en Algérie, cela ne revient-il pas, au bout du compte, à une prise de parti d’ordre politique ? La littérature, selon vous, est-elle à ce prix ?
Tout texte écrit a forcément quelques dimensions politiques. On écrit pour prendre position, pour refuser un quotidien qui abrutit, aveugle, qui vous force à la soumission. C’est parce qu’à 15 ans j’étais déjà en révolte, que je rêvais de renverser tous les pouvoirs, quels qu’ils soient, que naturellement j’ai pris un crayon, ouvert les pages blanches d’un cahier pour les noircir de textes qui n’épargnaient rien ni personne. À présent, j’allume l’écran d’un ordinateur, mais ma révolte est la même, toujours intacte. Et je ne conçois pas la littérature sans ce geste intact de révolte.