1882-1932 : les migrations vues à travers l’histoire des occupants du quartier de la Plaine-Saint-Denis
Publié par The Conversation le 21 décembre 2023, sous licence Creative Commons.
En portant son regard sur une » cité » d’habitation, au cœur de la Plaine-Saint-Denis, Fabrice Langrognet offre dans Voisins de passage (La Découverte, 2023) une passionnante histoire sociale et culturelle des migrations en France, du début de la IIIe République à la crise des années 1930. La Plaine-Saint-Denis est alors un immense quartier industriel où se croisent des myriades de migrants issus des classes populaires, d’origine provinciale, étrangère ou coloniale.

Photo Neurdein.
Fabrice Langrognet est historien des migrations à l’Université d’Oxford et à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, chercheur associé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de l’ouvrage « Voisins de passage – Une microhistoire des migrations » (éditions La Découverte, 2023) dans lequel, à travers une impressionnante analyse d’archives, il retrace l’histoire des occupants des immeubles des 96-102, avenue de Paris (devenue l’avenue du Président-Wilson) à la Plaine-Saint-Denis, entre 1882 et 1932. En nous livrant ainsi une microhistoire de ces nouveaux arrivants, il nous éclaire sur leurs relations interpersonnelles et sur la place qu’occupaient l’origine et la nationalité dans leur quotidien
Vous décrivez dans votre ouvrage les phénomènes de « francisation » qui s’opéraient chez les immigrés de la Plaine Saint-Denis. Peut-on pour autant parler d’assimilation à cette époque ?
F. L. : Du point de vue juridique, ce n’est qu’à partir de 1927 que les formulaires de naturalisation comportent des éléments d’appréciation relatifs à « l’assimilation » des étrangers et des étrangères qui aspirent à devenir des citoyens français. Ainsi, un formulaire de demande – parmi tant d’autres – renseigné à la Plaine-Saint-Denis en 1930 et signé par le commissaire de police du quartier indique, au sujet d’un ouvrier estrémègne d’une vingtaine d’années :
« Parle notre langue couramment/Est assimilé/Vit dans un milieu espagnol/Fréquente nos nationaux/Est susceptible d’une assimilation complète. »
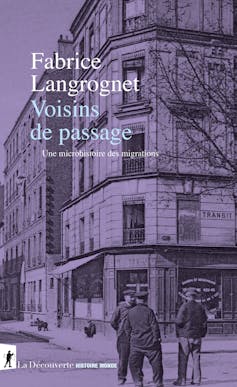
Pour autant, il ne faudrait pas en tirer de conclusions hâtives qui pécheraient par anachronisme : à l’époque, ces considérations ne constituent pas encore des critères d’accession à la nationalité ou au séjour sur le territoire national. L’analyse systématique des dossiers de naturalisation montre que ni une faible connaissance de la langue française, ni des fréquentations dans un milieu exclusivement étranger ne constituent alors des obstacles à la naturalisation.
Ce qui intéresse alors les autorités françaises, c’est avant tout le sexe et l’âge du demandeur – en vue de son service militaire – et la circonstance qu’il ait ou non des enfants mâles, qui seront les futurs conscrits de la République. Il n’y a guère qu’un casier judiciaire particulièrement fourni qui puisse entraver le processus de naturalisation ; à supposer, bien entendu, que l’administration parvienne à retrouver la trace des condamnations de l’intéressé, ce qui est loin d’être toujours le cas.
Votre livre souligne que la manière dont les gens venus d’ailleurs s’insèrent dans le tissu social du quartier que vous avez étudié ne se réduit pas à la seule question de la nationalité. Pouvez-vous dire un mot des logiques socioculturelles qui sont à l’œuvre ?
F. L. : Au tournant du XXe siècle, l’insertion sociale des nouveaux venus – provinciaux, étrangers, coloniaux – dans cette banlieue industrielle en effervescence qu’est la Plaine-Saint-Denis n’est que très imparfaitement corrélée à la citoyenneté juridique, qui est somme toute un enjeu assez marginal… jusqu’à ce que la guerre en fasse une question de vie ou de mort.
Ce qu’explore notamment mon ouvrage, c’est précisément que la transformation des hommes, des femmes et des enfants migrants en « gens d’ici » est complexe, réversible et tient à des paramètres multiples : réseaux de solidarité, ancienneté sur place, respectabilité (familiale, professionnelle, commerçante, militaire à l’issue de la Première Guerre mondiale), mais aussi contrastes qui peuvent se faire jour avec d’autres familles, notamment celles qui sont plus fraîchement arrivées. Le statut social inférieur de ces dernières favorise, dans les hiérarchies sociales et les représentations, l’intégration symbolique relative de celles qui les ont précédées, lesquelles deviennent du même coup moins étrangères, plus locales – et ce, quelle que soit leur nationalité.

Bien connu des sociologues et des anthropologues des migrations, ce mécanisme d’intégration relative n’est pas facile à documenter à plus d’un siècle de distance. Mais ces déplacements socioculturels sont essentiels car lorsqu’on combine leur analyse, comme je m’y suis employé, avec celle des déplacements des individus à travers l’espace, ils nous permettent d’enrichir et d’affiner notre compréhension des phénomènes migratoires de jadis, trop souvent réduits à des faits stylisés et désincarnés.
Avez-vous identifié des tensions particulières entre les immigrés issus des colonies françaises et les occupants déjà installés à la Plaine-Saint-Denis ?
F. L. : Si des sujets coloniaux originaires du Maghreb, notamment kabyles, sont présents à Paris dès les premières années du XXe siècle (où ils sont notamment employés au creusement des lignes du métro), il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que leur nombre s’accroisse de façon significative. Les autorités militaires françaises, comme au reste leurs homologues britanniques, recourent en effet largement à l’Empire pour se fournir en combattants, mais aussi pour répondre aux besoins considérables de main-d’œuvre d’une industrie de l’armement qui devient rapidement titanesque.
À la Plaine-Saint-Denis, en 1918, un dépôt de travailleurs tunisiens affectés au tri des vêtements militaires voisine avec les baraquements tout proches de recrues indochinoises chargées d’entretenir et de réparer les vois ferrées endommagées par les bombardements ennemis. Attestée par divers incidents, la xénophobie à l’égard de ces sujets coloniaux est réelle, mais elle ne doit pas être exagérée. Comme le livre le souligne, les sources gardent la trace de nombreuses relations amicales et amoureuses qui se nouent entre les « Plainards » bien établis et ces migrants venus de plus loin qu’auparavant.
Un élément intéressant à relever ici est qu’en l’espèce, le gouvernement français met en œuvre à l’égard des ouvriers issus de l’Empire colonial une politique délibérée de « non-intégration », pour ainsi dire. Dans l’espace urbain, ces hommes sont en effet ségrégués et soumis à un contrôle étroit : il ne faut surtout pas que les ressortissants de l’Empire (auxquels les ouvriers chinois sont assimilés, à leur grand dam), dont le séjour n’a pas vocation à se prolonger au-delà de la fin du conflit, se mêlent à la population locale. Il s’agit d’abord d’éviter qu’ils ne goûtent à une liberté qui pourrait leur donner des idées d’émancipation politique après la guerre. Ensuite, on veut faire obstacle à leur promiscuité sexuelle avec les femmes françaises, une question particulièrement sensible qui fait rejouer en métropole des enjeux de race et de genre qui avaient été jusque-là cantonnés au contexte colonial.
Vues comme rebelles vis-à-vis de l’autorité, les banlieues ont aujourd’hui une mauvaise image au sein de la société ; cela a-t-il toujours été le cas ?
F. L. : Ce n’est pas d’aujourd’hui que la banlieue fait l’objet de stéréotypes, souvent dépréciatifs. Mais il ne faut pas oublier qu’au XIXe siècle, ce sont longtemps les faubourgs parisiens de l’est et du sud qui cristallisent les peurs des élites, car c’est là que se hérissent régulièrement les barricades à partir de la Révolution française et que se concentre une population dense, migrante et très politisée, à laquelle on n’hésite pas à prêter toute une série de vices et de mœurs interlopes.
À partir de la construction des fortifications de Thiers au milieu du XIXe siècle et l’industrialisation de la petite couronne, la banlieue parisienne commence à exercer une fascination nouvelle. Par exemple, l’association entre délinquance juvénile et banlieue parisienne remonte au moins à la Belle Époque, lorsque les quotidiens nationaux décident de faire leurs choux gras des méfaits supposés de ceux qu’on appelle bientôt les « apaches ».

Les historiennes et les historiens ont depuis longtemps montré comment cette délinquance était largement surévaluée et participait d’une mythologie entretenue pour susciter la curiosité des lecteurs. Cette imagerie, qui perdura pendant de longues décennies – que l’on songe au fameux film Casque d’Or, de Jacques Becker, sorti en 1952 – se fondit après la Seconde Guerre mondiale dans de nouvelles représentations négatives, nourries par les bidonvilles puis la construction des grands ensembles de logements sociaux.
Sur ces questions, il faut renvoyer au travail précieux de l’Association pour un musée du logement populaire qui tâche de restituer, par la microhistoire, l’expérience vécue des habitantes et des habitants de la banlieue populaire à rebours des caricatures.
En ce qui concerne les forces de l’ordre, rien dans les sources du début du XXe siècle que j’ai consultées ne permet de détecter des différences significatives de traitement à raison de l’origine des individus, au contraire d’éléments relatifs à l’hygiène, au travail et à la moralité (entendez par là le rapport à l’alcool et à la sexualité réelle ou supposée) qui, eux, suscitent quantité de biais défavorables chez les représentants du système policier et judiciaire.
La nationalité a-t-elle une importance dans les revendications sociales des populations immigrées de l’époque ?
F. L. : Dans les diverses formes de protestation collective que l’on observe alors à Saint-Denis, l’origine géographique, ethnonationale ou raciale n’est jamais centrale, et encore moins revendiquée, au moins jusqu’à l’entre-deux-guerres et l’arrivée à Saint-Denis, à la toute fin des années 1930, de nombreux réfugiés républicains espagnols.
C’est là une différence intéressante avec l’histoire des migrations aux États-Unis, où l’origine ethnique joue par exemple un rôle important dans les grandes grèves du textile du Massachusetts de 1912.
En vérité, les questions identitaires auxquels les descendants d’immigrés sont aujourd’hui confrontés en France trouvent pour une bonne part leur matrice dans la décolonisation, qui n’intervient qu’après la Seconde Guerre mondiale. Les lectrices et les lecteurs peuvent à cet égard se tourner avec profit vers « Les trois “âges” de l’émigration algérienne en France », un texte d’Abdelmalek Sayad qui date des années 1970 mais demeure tout à fait fécond aujourd’hui.

