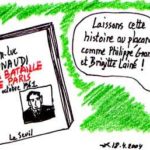L’Etat continue de cacher des preuves
[entretien avec Jean-Luc Einaudi 1
paru dans le Nouvel Observateur à la date du 17 octobre 2002.]
Que s’est-il passé le 17 octobre 1961?
Pour comprendre ce qui s’est passé le 17 octobre 1961, il faut remonter à une dizaine de jours plus tôt.
Le 5 octobre, le préfet de police, Maurice Papon, décide d’imposer un couvre-feu sélectif qui ne s’applique qu’à une partie de la population française: les Français musulmans d’Algérie. Cette décision discriminatoire, qui s’appuie sur l’apparence physique des personnes, est la réponse aux attentats commis par le FLN quelques jours avant et qui causé la mort de onze policiers.
Face à cette institutionnalisation du racisme, le FLN appelle à un grand rassemblement pacifique le 17 octobre. Bien sûr, cet appel est clandestin mais la police sera quand même au courant, la veille, qu’une manifestation doit avoir lieu.
Le jour même, des dispositifs de sécurité sont mis en place. De leur côté, les organisateurs fouillent les manifestants qui ne doivent avoir sur eux aucune arme. Et là, lorsque les deux camps se rencontrent, et je dis bien rencontrent et pas s’affrontent, c’est le massacre. Des milliers de personnes sont raflées, tabassées, violentées. Des centaines sont tuées dont plusieurs dizaines par noyade. Pour ma part, j’estime les noyés à une soixantaine de personnes et je pense qu’il y a eu en quelques jours environ 400 personnes tuées. Les morts et les violences policières s’étalent du mardi 17 octobre jusqu’au dimanche qui suit.
Quel a été le rôle de Maurice Papon?
Les dispositifs de sécurité ont été mis en place sous les ordres de Maurice Papon. Lorsque les rafles ont été commises, c’est lui qui a décidé de réquisitionner des autobus avec leurs chauffeurs pour pouvoir ramasser plus de monde. C’est aussi lui qui a permis de parquer les personnes raflées dans le palais des sports de la porte de Versailles ainsi qu’au stade Coubertin.
Il faut bien noter que les rafles étaient une pratique habituelle à l’époque et, surtout, que tous les policiers et gendarmes qui ont tapé et tué l’ont fait avec la conviction de l’impunité. Et cette impunité, c’est leur préfet qui leur a donnée. Enormément d’actes de violences ont eu lieu à l’intérieur même des cours des commissariats, ce qui engage la responsabilité du préfet.
De plus, Maurice Papon a aussi participé à l’entreprise de dissimulation de la vérité. C’est lui qui est à l’origine du communiqué mensonger diffusé dans la nuit du 17 au 18 octobre. Ce dernier affirmait que la police avait dû répliquer par des tirs à la violence des manifestants et faisait état de trois morts dont un métropolitain. Quand on sait que celui ci avait le crâne fracturé …
Comment a pu avoir lieu la reconnaissance officielle de ce massacre?
Dès le départ il y a eu un véritable travail de mise en œuvre de mensonge d’Etat. Comme le nombre de cadavres était important, il a bien fallu trouver une explication. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Roger Frey et Maurice Papon ont donc expliqué que ces morts étaient dues à des règlements de compte entre Algériens. Ensuite quand des commissions d’enquêtes ont été réclamées, le gouvernement de Michel Debré et de De Gaulle ont refusé de les mettre en place.
Evidemment, l’amnistie décrétée en mars 1962 a facilité le travail de mensonge puisqu’elle couvre tous les faits de cette époque concernant le maintien de l’ordre.
Tout ce qui cherchait à faire éclater la vérité était interdit et saisi comme le livre « Ratonnades à Paris » de Pierre Vidal-Nacquet.
Dans les années 1980, on a commencé à parler de ces événements puis en 1991 mon livre est sorti (« La bataille de Paris », ndlr). Les faits sont reconnus mais il est toujours impossible d’accéder aux archives des administrations d’Etat.
En fait, le vrai déclencheur a été le procès de Papon en 1997. Les parties civiles m’ont demandé de témoigner sur sa carrière et j’ai donc parlé du massacre d’octobre. Cela a eu un écho très important. C’est alors que Maurice Papon a décidé de m’attaquer en justice suite à un article publié dans la presse où je l’accusait nommément. Et là, la machine judiciaire c’est retournée contre lui. En février 1999, le procès permet pour la première fois que le 17 octobre soit examiné devant la justice. Et l’Etat, par l’intermédiaire de ses juges, a reconnu qu’il était légitime de parler de massacre.
L’année dernière, après de vifs débats au conseil municipal de Paris, les politiques ont décidé l’installation d’une plaque commémorative.
Mais attention, rien n’est fini ni acquis. Aujourd’hui, deux fonctionnaires [deux archivistes de la ville de paris, ndlr] sont victimes de brimades pour avoir dévoilé des archives accusant Maurice Papon. Je leur avait demandé de témoigner pendant mon procès. Et puis, certaines archives sont encore interdites d’accès. L’Etat continue de cacher des preuves. Par exemple, les notes prises dans les deux conseils de ministres qui ont suivi le 17 octobre ne sont pas toujours consultables, sur ordre de l’Elysée.
Propos recueillis par Laure Gnagbé

Octobre 61. L’historien Jean-Luc Einaudi revient sur cette sombre période et s’insurge contre l’interdiction d’accès aux archives.
[ entretien paru dans L’Humanité, 17 octobre 2000 ]
» Octobre 1961 est un crime contre l’humanité «
La préfecture de Paris vous a interdit l’accès aux archives relatives aux dramatiques événements d’octobre 1961. Quelles sont les raisons ?
Jean-Luc Einaudi. Pour mener mes recherches sur ces événements largement occultés par l’État français, j’avais demandé l’accès aux archives des administrations, particulièrement celles du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police. On m’a opposé le délai de soixante ans. Ce qui fait que j’ai écris la Bataille de Paris (1) avec toutes les sources disponibles dont j’avais pu disposer. Il est paru en 1991. Et puis, en octobre 1997, les parties civiles au procès de Papon devant la cour d’assises de Bordeaux m’ont demandé de venir témoigner. J’ai donc parlé en particulier du massacre d’octobre 1961…
D’où le procès que vous a intenté Maurice Papon en 1999 ?
Devant la cour, j’ai d’abord posé le problème politique de l’accès aux archives. Est-ce que, oui ou non, on veut que toute la lumière soit faite ? À la sortie du tribunal, on m’a dit que Mme Trautmann, alors ministre de la Culture et de la Communication, avait décidé l’ouverture de l’accès aux archives. Puis il y a eu le procès que m’a intenté Papon au mois de février 1999. Ce procès a été un échec pour Papon et, pour la première fois, il y a eu un début de reconnaissance par le parquet qu’il y avait eu un massacre en octobre 1961 à Paris. Entre-temps j’avais écris au premier ministre et au ministre de l’Intérieur. Et au mois de mai de l’année dernière, le premier ministre a dit qu’il demandait aux administrations concernées de faciliter le travail des chercheurs.
Alors que s’est-il passé ?
Le problème qui me concerne est que du côté du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police, il n’y avait aucun changement. Par contre, on a autorisé un autre universitaire, Jean-Paul Brunet, à avoir accès aux archives de la préfecture de police. Il en a sorti un livre, qui non seulement met en cause mon travail, mais est plutôt complaisant vis-à-vis de la version policière. Quant à moi, j’ai continué à demander à avoir accès aux archives. Finalement, la semaine dernière, le préfet de police, M. Massoni, m’a répondu négativement en invoquant le délai de soixante ans. De deux choses, l’une : ou bien ce délai s’impose à tout le monde, ou alors il ne s’impose à personne !
Selon vous, qu’est-ce qui explique ce refus sélectif ?
Je vais vous le dire franchement. Sur octobre 1961, il y a déjà eu des éléments publiés. Mais c’est mon livre, la Bataille de Paris, qui, malgré tout, a permis largement d’établir les faits. On a commencé à reconnaître quelque chose qui était nié jusque-là. Je pense donc que l’actuel préfet de police s’inscrit dans des réseaux de complicité qui vont de préfet à préfet.
Est-ce pour vous empêcher de découvrir des choses sur lui que l’accès aux archives vous a été interdit ?
Je dis que M. Massoni n’agit pas conformément aux orientations publiquement indiquées par le premier ministre, et je dis que sa démarche vise délibérément à m’empêcher de poursuivre mes recherches. J’ajoute qu’il a eu une partie importante de sa carrière liée à la préfecture de police sous Papon.
De façon générale, ne pensez-vous pas que par cette interdiction, on essaie d’empêcher l’indispensable travail de mémoire ?
Bien évidemment, je suis amené à considérer que c’est mon travail qui a permis de sortir cette affaire de l’oubli, et qu’on vise à entraver le travail d’élucidation. Le procès que m’a intenté Papon, l’année dernière, s’inscrivait dans cette ligne, me faire taire.
Pour en revenir à octobre 1961, partagez-vous l’idée, développée par beaucoup, qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité ?
Oui, je partage ce point de vue. C’est ce que j’ai dit devant le tribunal correctionnel, en présence de Papon. Et dans cette affaire-là, aussi scandaleux que ce soit, c’était moi le prévenu. Le procès s’est renversé. En définitive, c’est l’action policière sous les ordres de Papon qui a été mise en accusation. À mon sens, donc, il y a eu crime contre l’humanité : en octobre 1961 à Paris, il y a eu une véritable chasse à l’homme. Des gens ont été blessés, très gravement, des gens ont été tués, des gens ont été méprisés, en fonction d’un critère, celui de l’apparence physique, c’est-à-dire en fonction de critères racistes, et en fonction de leur appartenance réelle ou supposée à une communauté humaine, en l’occurrence la communauté algérienne. Alors je dis que ça entre dans le cadre des crimes contre l’humanité.
Le chiffre de 200 morts à Paris est contesté…
Moi, j’ai constaté qu’il y avait eu au moins 200 morts. Vous savez, un pouvoir d’État, qui veut dissimuler un crime commis par lui-même, dispose de moyens extrêmement importants. Il y a eu des Algériens qui ont été tués au Palais des Sports, dont on ignore ce qu’il est advenu de leurs corps. D’autres qui sont morts noyés dans la Seine, etc. Je maintiens l’évaluation du nombre de victimes que j’ai formulé jusque-là.
39 ans après ces faits, l’anniversaire d’octobre 1961 coïncide avec les accusations de torture contre les généraux Massu et Bigeard durant la guerre d’Algérie. Partagez-vous l’idée qu’il faut les juger, comme le demande Louisette Ighilahriz ?
Soyons très clair. Ce qui est assourdissant dans cette affaire-là, comme cela été le cas il y a quelques années sur Le Pen, c’est le silence de nos gouvernants. Tout de même ! Bigeard, ancien général, » grande gloire militaire française « , ancien ministre, qui justifie l’usage de la torture, c’est-à-dire d’une pratique criminelle interdite par la loi, Est-ce que vous avez entendu l’actuel ministre de la Défense ou quelque autre autorité politique officielle intervenir ? Autrement dit, on est toujours, en définitive, dans la même situation qu’en 1956. Eh bien, tout se passe comme si rien n’avait existé. En 1956, justement, le socialiste Guy Mollet disait que tout cela n’était que mensonge, et aujourd’hui on se tait. Je considère le fait que nos gouvernants continuent de se taire comme quelque chose d’extrêmement nocif pour une démocratie. Ça signifie à mon sens que des pratiques criminelles ayant eu lieu peuvent continuer à se perpétuer dans les mentalités.
Partagez-vous le point de vue de Nicole Dreyfus, ancienne avocate des détenus du FLN pendant la guerre d’Algérie, qui a estimé que l’État français devrait faire un geste comme il l’a fait pour les crimes de Vichy ?
Concernant Vichy, la France l’a fait 50 ans après, vous vous imaginez, 50 ans après ! Pour répondre à votre question, je dirais qu’il s’agit d’une nécessité d’un double point de vue : du point de vue de la société française elle-même, par rapport à tous ces enfants issus de l’émigration algérienne, qui sont français et dont les familles ont très souvent été meurtries par ces années de guerre, et qui fait que cela continue d’agir dans la mémoire consciente ou inconsciente. Et du point de vue de sa fidélité à ses principes proclamés, qui sont les droits de l’homme. Ce sera extrêmement important, également, du point de vue des relations franco-algériennes.
Revenons à la question de tout à l’heure. Approuvez-vous Louisette Ighilahriz qui demande le jugement de Massu et Bigeard ?
Très franchement, je ne me suis jamais situé sur le terrain judiciaire. Je me situe sur celui de la recherche des faits, sur le terrain de l’histoire. Mais il est tout à fait légitime que les victimes et leurs familles veuillent que les crimes commis soient jugés. Le problème est qu’en mars 1962 un décret amnistiant les crimes commis durant la guerre d’Algérie a été promulgué. Ce qui fait qu’il n’y a jamais eu un quelconque militaire ou policier jugé pour avoir pratiqué la torture.
Selon vous que faut-il faire ?
Allons donc, un massacre a eu lieu à Paris, au cour de la capitale française, commis par des forces de police françaises, et le pouvoir politique resterait muet ? Il faut à la fois poursuivre les travaux de recherche, que les administrations impliquées dans ces événements ouvrent leurs archives, qu’elles les mettent à la disposition des Archives de France – ce qui n’a pas toujours été le cas -, et que se développe une action citoyenne en faveur de la recherche de la vérité pour que le pouvoir politique prenne ses responsabilités.
Entretien réalisé par Hassane Zerrouky.