Le spectacle performance « Dispak Dispac’h », inspiré d’une session du Tribunal permanent des peuples consacrée aux violations des droits des personnes migrantes, qui a été donné au Festival d’Avignon 2023 au Gymnase du lycée Mistral, porte sur la crise de l’hospitalité en France et sur la révolte nécessaire pour faire changer les choses.
Lors de la dernière représentation de « Dispak Dispac’h », le 21 juillet 2023, il a été proposé aux spectateurs de participer à un « crépuscule européen » où ils ont exprimé leur refus de cette fermeture des cœurs à l’œuvre en Europe et en France. Et où ils dit leur volonté de se mobiliser pour y mettre fin. « Dispac’h Dispak » se jouera les 2 et 3 juin 2025 à la scène nationale de Cergy et ensuite dans le cadre du Festival Latitude Contemporaine à Villeneuve d’Ascq et à Lille.

Voir la présentation de ce spectacle performance sur le site du Festival d’Avignon 2023
Propos recueillis par Cheikh Sakho, le 27 mai 2024, pour histoirecoloniale.net
• Patricia Allio, pourriez-vous nous parler du titre de votre spectacle ?
Patricia Allio : Dispak Dispac’h, c’est en breton. Dispak ça veut dire ouvert, défait, déplié. Dispac’h signifie : agitation, révolte, révolution. Cela renvoie aux deux pôles qu’il y a dans ce spectacle en termes de dramaturgie.
Dispak, c’est la question de l’hospitalité, de l’ouverture du cœur. C’est aussi l’idée de déplier les perceptions, les émotions. Dans la scénographie, dans l’espace, c’est déplier des cartes géographiques qui sont au sol. Dispac’h, c’est la révolte, la révolution. J’avais envie que dans ce spectacle, ce soit aussi un appel à se mobiliser, à s’engager. Cette forme théâtrale est à la fois un constat, un diagnostic de tout ce qui ne va pas dans les politiques migratoires européennes et française, et aussi une ouverture à la révolte, à la possibilité d’agir, en invitant les personnes de la société civile à y réagir.
• À la sortie d’une représentation, à Paris, au Théâtre Silvia Montfort, des spectateurs regrettaient ce titre en breton. Disant qu’il n’était pas assez incitatif ou ne suggérait pas les thématiques de la pièce, les textes européens sur la migration et l’asile, la loi Immigration en France, les droits humains…
P. A. : Je ne savais pas que des spectateurs ou spectatrices regrettaient ce titre. Je pense que, de toutes façons, un titre ne doit pas trop expliquer, être didactique. Je pense que c’est assez beau, vu que c’est un projet très politique et très engagé, qu’il ait un titre assez énigmatique. Et pour moi le breton est lié à une langue perdue et à une oppression étatique française. C’est déjà un geste de révolte et d’ouverture que de prendre conscience du fait que cette langue existe. La plupart des Français et Françaises ne savent pas que le breton a été une langue très usitée, qu’elle existe encore et ils ne connaissent pas très bien cette histoire. Quand je réfléchissais au titre, j’avais pensé évidemment à des choses autour de No border, de la place de l’anglais, et puis, en fait, j’ai eu un sentiment de révolte contre l’anglais et sa domination.
• En janvier 2018 vous découvrez le Tribunal permanent des peuples et assistez, au CICP (Centre international de culture populaire, à Paris) à une session consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées. Racontez-nous.
P. A. : J’entends parler de cette session du tribunal permanent des peuples en tant que citoyenne et militante et sensible aux questions migratoires et donc je décide d’y aller. Quant au CICP, je connaissais déjà ce haut-lieu du militantisme à Paris et en région parisienne puisque j’avais découvert en 2016 les luttes du collectif Adama. En juillet 2016, j’étais au CICP, donc je me dis « Ah, ça doit sûrement être intéressant ». Je n’avais jamais entendu parler de ce tribunal permanent des peuples. Moi, je viens quand même beaucoup de la philosophie, des réflexions sur la philosophie politique, sur la démocratie etc. Donc, la question d’un tribunal citoyen, d’un tribunal indépendant, alors même que l’on est face aux violations systématiques d’un État, je trouve ça très passionnant. Comment il y a une auto-organisation, alors même que l’on est face à des causes perdues, puisque le tribunal permanent des peuples existe depuis 1979. Il y a une session consacrée à la Palestine, une autre à l’Arménie. Donc, on est souvent face à des endroits de violation assez systématique et répétée des droits des peuples. Donc, je me rends là-bas et je découvre que des témoins prennent la parole, on entend un acte d’accusation rédigé par le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés) ainsi que d’autres nombreuses associations. Il y a donc un travail collectif et un reflet de la diversité des formes de résistance parce qu’on peut y entendre, par exemple, Damien Carême qui, à l’époque, est maire de la ville de Grande-Synthe, il n’était pas encore député européen. On peut y entendre Cédric Herrou qui a organisé les luttes dans la vallée de la Roya, on peut y entendre à la fois des personnes connues, des hommes et des femmes politiques mais aussi des personnes inconnues mais qui ont eu affaire à la violation de leurs droits. Et donc je trouve ça très opérant, et ce qui me frappe c’est que c’est très intime, c’est comme une petite mise en scène de théâtre, parce que les gens jouent leur propre rôle. On invite les accusés qui ne viennent évidemment pas. Et moi, je me dis à ce moment-là que ce serait très intéressant de poursuivre cette dimension théâtrale, en l’amplifiant, parce que là on est très intimes, dans un tout petit cercle de personnes concernées. Alors que si on déplace cela sur une scène de théâtre avec des lycéens, ou avec des personnes engagées, ou encore avec des personnes qui n’ont jamais eu l’occasion d’être confrontées à ça, cela pourrait, peut-être, générer autre chose et peut-être que c’est une façon de renouer avec un théâtre politique notamment avec la question de l’agora.
• Et c’est là que vous avez rencontré certains de vos témoins.
P. A. : Tout à fait, je rencontre notamment Marie-Christine Vergiat, qui est, à l’époque, députée européenne et qui est ensuite devenue vice-président de la Ligue des droits de l’Homme. Elle milite depuis des années pour d’autres politiques migratoires, pour changer notre regard sur les exilés (ou ceux que l’on appelle les migrants, mais que l’on n’a plus envie d’appeler comme cela dans les associations), pour les droits humains en général et surtout pour l’égalité des droits. J’ai donc, souvent écouté Marie-Christine Vergiat quand on répétait et elle fait partie du projet depuis trois ans. Je rencontre d’autres témoins, mais surtout, je veux aller à la rencontre d’autres personnes dans les villes où je répète. Lorsque je répète au Théâtre de Lorient, je rencontre le cofondateur d’Utopia 56, Gaël Manzi. Je vais à Besançon, je rencontre Stéphane Ravacley, le boulanger qui a fait la grève de la faim. Et ce processus continue puisqu’avant-hier, j’étais à Valence, j’y ai joué trois fois et chaque jour il y avait des témoins différents. J’ai notamment rencontré la communauté guinéenne. Ils ont créé une association, l’AGVS (Association Guinéenne de Valence pour la Solidarité), ce sont des jeunes Guinéens qui ont vécu le pire sur leur trajet migratoire et qui ont vécu aussi le pire parfois en arrivant en France alors qu’ils pensaient que, enfin, leur malheur allait s’arrêter et qu’en fait ça ne s’st pas arrêté puisqu’ils ont été mis dehors en plein hiver. Ils ont été épaulés par des associations locales et, à leur tour, en grandissant, ils se sont dit : « on va essayer de se constituer en force de résistance » (un peu comme le Tribunal permanent des peuples), « créer une association guinéenne et on ira au-devant des jeunes qui arrivent pour leur éviter de vivre ce que nous, on a vécu ». Thiam et Fofana, qui viennent de Guinée, ont témoigné… c’était très très fort.

Et je continue ce processus, la semaine prochaine je serai à Saint-Brieuc et j’invite Mariam et Boubacar qui sont deux personnes qui ont vécu l’exil et le racisme en traversant les frontières. C’est vraiment un processus permanent d’ouverture aux témoins dans chaque ville et chaque région. Il y avait par exemple, à Rennes, pendant une semaine, Régine Komokoli, la première femme sans-papiers devenue élue de la République française et qui est déléguée aux parentalités et à l’enfance en Ille-et-Vilaine, elle qui est habituée à défendre l’importance du témoignage pour changer les mentalités, les opinions et les engagements politiques des municipalités.
• Une des particularités de la pièce, c’est que vos témoins, qui ne sont pas des comédiens professionnels, se mêlent aux actrices et acteurs de métier. De la même manière, spectatrices et spectateurs se retrouvent avec la troupe dans un dispositif scénique non-frontal et sans séparation. Qu’apportent ces deux choses ?
P. A. : Je pense que la question de la rencontre est au cœur du spectacle : c’est comment on se rencontre ? Peut-être que, déjà, rassembler des personnes qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer, justement. Par exemple, un boulanger gréviste de la faim qui a été très médiatisé et qu’on a vu à la télé ou qu’on a entendu à la radio. Tout d’un coup, il est là, et puis il danse. Ça change notre regard sur « qui a le droit de faire un spectacle, qui peut danser, qui a une parole digne d’être entendue ? ». Et c’est une façon de mêler art et non-art. Pour moi, c’est une approche qui questionne vraiment la démocratie et se demande comment l’art peut être social et politique et contribuer à plus de démocratisation puisqu’on peut dire que la démocratie est une utopie non réalisée. Cette approche s’interroge sur la question de la représentativité, de l’égalité des droits…
Je pense que le théâtre, un certain type de théâtre, a un rôle majeur à jouer. Parce que, aujourd’hui, on a du mal à se rencontrer et à s’écouter, parce qu’on est saturé d’informations, contrairement à il y a trente ou quarante ans, ou plus avant. On est ultra-connectés mais on est ultra-séparés et coupés. Du coup, on a plein d’infos sur Instagram, Facebook, les mails et SMS, les MMS, on répond à cinq messages en même temps… En fait, exercer une attention et une écoute est devenu rare.
L’espace théâtral est un des rares espaces collectifs aujourd’hui ou des personnes venues d’origines et de milieux socio-professionnels différents peuvent se rencontrer, se regarder et s’écouter, surtout, justement, dans un dispositif non-frontal. On rentre dans l’agora, on se déchausse, ce n’est pas parce que c’est la messe ou un espace sacré… c’est pour amener une intimité, comme si on était un peu « à la maison, dans un grand salon », quelque chose de souple pour les corps et quelque chose aussi qui produit de l’égalité. On est assis au même niveau, il n’y a personne qui est dans une relation de suprématisme, une star que d’autres regardent sur des scènes. On est tous un peu au même niveau, et il y a les bancs d’utopie[1] qui arrivent, et on invente une écoute attentive, grâce à un dispositif qui permet qu’on se regarde toutes et tous.
• Les bancs d’utopie, réalisés par un artiste contemporain…
P. A. : Il s’appelle Francis Cape, et c’est une œuvre prêtée par le FRAC de Besançon Franche-Comté, car ce projet a un lien avec la ville de Besançon qui a une grande histoire politique d’engagement et d’invention d’utopie. Stéphane Ravacley vient de là-bas. L’actrice, Élise Marie, qui porte l’acte d’accusation rédigé par le GISTI, en première partie du spectacle, vient de Besançon. On a répété à Besançon et j’ai rencontré la directrice du FRAC qui a trouvé ce projet très intéressant et cela lui faisait penser à une œuvre acquise par le FRAC. Elle m’a montré les bancs d’utopie de Francis Cape où chaque banc correspond un banc qui existe dans une communauté utopique aux États-Unis ou en Europe et qui a une fonction conversationnelle. C’est une œuvre relationnelle, et la pièce Dispak je l’ai conçue comme cela, c’est entre l’art et le militantisme et je cherchais une forme conversationnelle… ils nous ont prêté cette œuvre depuis un an.
• Vous parlez de « nécropolitiques migratoires européennes et française », que peut-on dire de l’attitude de certains pays du Sud, par exemple la Tunisie ou encore le Rwanda ?
P. A. : Aujourd’hui, la plupart des pays sont engagés dans des politiques répressives à l’encontre des exilés, ce n’est évidemment pas l’apanage des pays européens, c’est partout dans le monde ; et il y a un racisme à l’égard des exilé.es, des demandeuses et demandeurs d’asile ou des réfugiés subsahariens qui est généralisé. Dans le cadre des politiques d’externalisation des frontières, des accords sont passés avec le Rwanda, ou la Tunisie, mais en vrai avec énormément de pays. Des pays africains reçoivent énormément d’argent comme la France reçoit de l’argent de l’Angleterre pour bloquer les frontières. Évidemment, ce n’est pas binaire : les politiques migratoires européennes s’externalisent, elles changent les pratiques migratoires africaines puisqu’en fait, énormément d’immigrations internationales à l’intérieur du continent africain ne peuvent plus avoir lieu comme avant. L’année dernière, quand j’ai joué la pièce au festival d’Avignon, on a invité Moctar dan Yayé, fondateur d’Alarm Phone Sahara[2], il est venu à Avignon parler de la situation autour du Sahara et du drame qui se joue là. Il s’agit de la répression abominable et raciste qui se passe en Tunisie où on déporte des exilés sub-sahariens parce qu’ils sont noirs, il faut bien le dire, la question du racisme est au cœur aussi de ce projet, de cette réflexion, parce que finalement, Marie-Christine Vergiat le dit très bien : on a accueilli quasiment 6 millions d’Ukrainiens en déclenchant un dispositif européen qui pourrait être déclenché aussi pour les Érythréens, les Soudanais puisqu’on parle de pays en guerre. En très peu de temps, il y a eu le droit au logement, le droit au travail etc. Donc, cela devrait pouvoir être déclenché pour les Érythréens, les Soudanais, qui arrivent d’un pays en guerre, les Syriens… le nombre de personnes qui meurent alors qu’elles fuient la guerre ! c’est une violation fondamentale des droits.
• Le cinéma s’empare de plus en plus en plus des expériences migratoires (par exemple Io capitano, de Matteo Garrone ou L’histoire de Souleymane, film primé à Cannes, de Boris Lojkine), le théâtre serait-il en retard, en France, du moins ?
P. A. : Je ne pense pas que le théâtre soit en retard parce qu’il y a souvent eu des choses, il y en a régulièrement. Mais contrairement à plein de choses qui se font, ce qui m’intéresse, ce n’est pas faire une pièce sur l’exil, le récit migratoire… Je ne veux pas faire de la fiction, je ne veux faire un spectacle du côté des exilés parce que tout le monde se repaît de ces histoires, j’ai voulu faire un spectacle, une aventure qui soit « du côté » des Français et des Européens des Européennes pour obliger à changer le regard. J’invite des personnes qui ont vécu l’exil ou qui le vivent encore, qui ont subi la violation de leurs droits.
• Comme Mortaza Behboudi[3] ?
P. A. : Oui, Mortaza, journaliste franco-afghan, ou des témoins comme le poète Falmarès, poète guinéen, qui a failli être expulsé… alors qu’il était bien inséré comme la plupart. J’invite des personnes qui ont vécu la violation de leurs droits, ou menacées de mort… Ce qui m’intéresse, contrairement à d’autres spectacles, c’est vraiment de créer une expérience esthético-politique où l’on est n’est pas juste ému par une histoire, encore moins par une fiction inspirée de réelles traversées. Mais une expérience dans laquelle on est amené plutôt à réfléchir sur notre commune humanité, grâce à ce dispositif dont on vient de parler, égalitariste, et où on est amené à prendre conscience de la gravité des politiques de nos pays.
Je pense que c’est très important de défendre un « art situé », ce n’est pas moi qui vais parler à la place d’un exilé. Ce n’est pas moi qui vais mettre en scène une pièce de théâtre sur le passage de la frontière, pour moi cela n’aurait pas de sens. Je pense que c’est à une personne anciennement demandeur ou demandeuse d’asile, si elle a envie de parler de son histoire aujourd’hui, de le faire, c’est beaucoup plus fort. En revanche, je pense que c’est pertinent et urgent que l’on s’interroge sur nos politiques migratoires et que l’on se serve de l’art comme d’un levier de résistance. Car le théâtre a un rôle à jouer pour ouvrir, non seulement nos esprits mais nos cœurs, créer une sorte de continuité, peut-être, entre un milieu associatif militant et le reste de la société. Et surtout, faire des liens entre des personnes concernées (toutes celles que l’on a citées), mais aussi toutes les personnes qui, à un moment donné, ont vécu, soit dans la rue, soit dans des traversées migratoires parfois épouvantables. C’est hyper important qu’elles soient aussi présentes dans le spectacle Dispak, pour amener aussi leur regard parce que, d’un coup, dans la deuxième partie du spectacle, c’est saisissant parce qu’on vient d’entendre pendant une heure un acte d’accusation très long et que, d’un coup, on a besoin d’entendre des voix de personnes, d’humains qui ont vécu cela. Finalement, ce qui m’intéresse là-dedans, ce sont des rencontres, justement, la rencontre humaine et la question de nos humanités, de l’hospitalité.
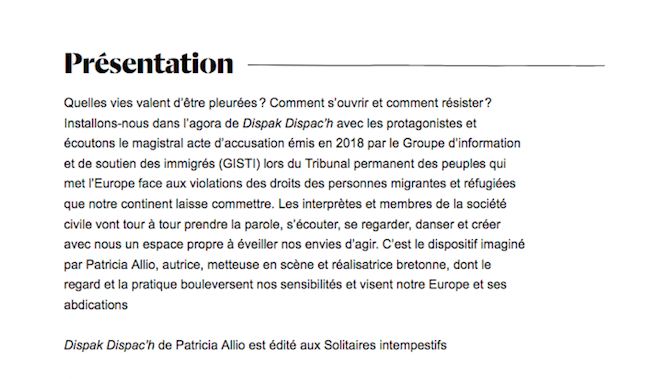
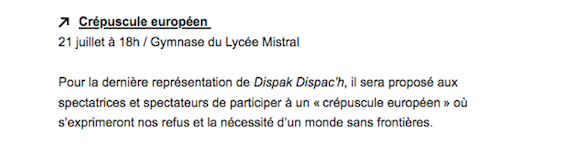
[1] https://www.frac-franche-comte.fr/fr/francis-cape-bancs-dutopie-we-sit-together
[2] https://alarmephonesahara.info/fr/blog/posts/info-tour-alarme-phone-sahara-2022
[3] L’équipe d’actrices et d’acteurs lors de la représentation au Théâtre Silvia Montfort comprenait : Patricia Allo, Mortaza Behboudi, Falmarès, Gaël Manzi, Élise Matie, Bernardo Montet, Stéphane Ravacley et Marie-Christine Vergiat.

